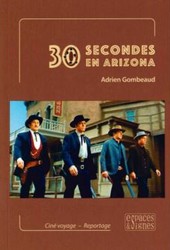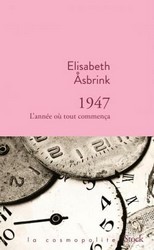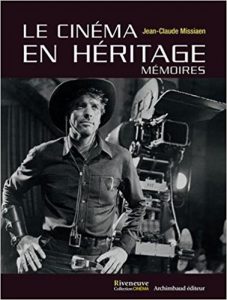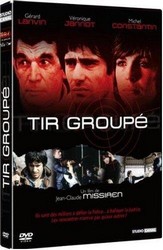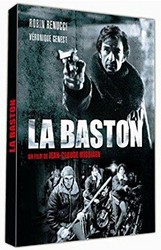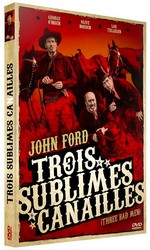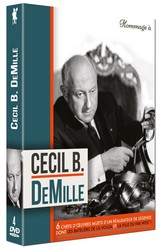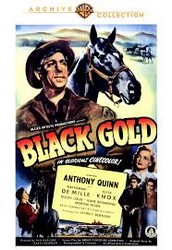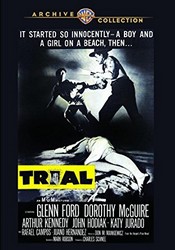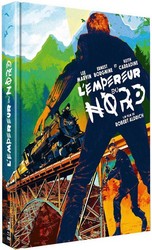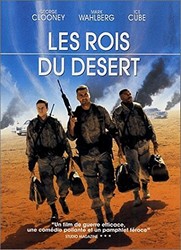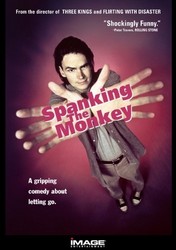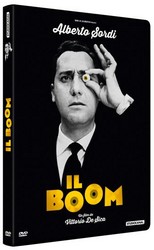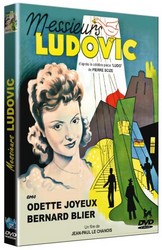MUETS
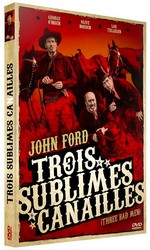 TROIS SUBLIMES CANAILLES (3 Bad Men) : Dernier western muet de Ford et, à la suite de l’échec du film, sa dernière incursion dans le genre avant STAGECOACH, 13 ans plus tard, 3 BAD MEN se caractérise par un ton plus détendu, plus familier que celui d’IRON HORSE. Et qui flirte souvent avec la comédie, aussi bien dans les intertitres souvent marrants « Mike Costigan et Spade Allen n’étaient pas vraiment des voleurs mais ils avaient tendance à trouver des chevaux que personne n’avait perdu », que dans des gags, voire des séquences entières, qui paraissent improvisés et viennent adroitement contrebalancer le pathos, la tension dramatique de certaines péripéties. Notamment ce long moment où Costigan et Allen dont les trognes ont dû inspirer le Giraud de Blueberry, cherchent un fiancé pour la jeune orpheline Lee Carleton (« pas un Chinois, ils se font tuer, trop vite »), en dégotent un que leur demande traumatise et qui se disloque littéralement. Le ressort comique, amusant au départ (les airs terrifiés de « l’élu » sont cocasses), tire en longueur et devient insistant, comme quelques autres gags rustiques typiques de Ford qui est mieux inspiré lors de la rencontre entre Dan et Lee qui flirte avec la comédie américaine. La jeune fille lui balance des vannes jusqu’à ce qu’il se décide à ajuster une nouvelle roue sur le chariot. Cet humour picaresque et surtout cette familiarité avec les personnages permettent de revitaliser un scénario et des protagonistes sortis des feuilletons les plus routiniers. Le rapport avec les Indiens dont on vole les terres, est évacué, les trois « sublimes canailles » se révèlent peu efficaces et se font tuer bêtement en se séparant alors qu’ensemble ils pouvaient tenir tête à la bande de malfrats que dirige l’horrible shérif Hunter (Lou Tellegen impressionnant) dont les airs de dandy vampire qui meurt dans une caverne, annoncent John Carradine. « Il est représenté, non sans ironie, selon McBride, comme une exagération satirique du méchant de western ».
TROIS SUBLIMES CANAILLES (3 Bad Men) : Dernier western muet de Ford et, à la suite de l’échec du film, sa dernière incursion dans le genre avant STAGECOACH, 13 ans plus tard, 3 BAD MEN se caractérise par un ton plus détendu, plus familier que celui d’IRON HORSE. Et qui flirte souvent avec la comédie, aussi bien dans les intertitres souvent marrants « Mike Costigan et Spade Allen n’étaient pas vraiment des voleurs mais ils avaient tendance à trouver des chevaux que personne n’avait perdu », que dans des gags, voire des séquences entières, qui paraissent improvisés et viennent adroitement contrebalancer le pathos, la tension dramatique de certaines péripéties. Notamment ce long moment où Costigan et Allen dont les trognes ont dû inspirer le Giraud de Blueberry, cherchent un fiancé pour la jeune orpheline Lee Carleton (« pas un Chinois, ils se font tuer, trop vite »), en dégotent un que leur demande traumatise et qui se disloque littéralement. Le ressort comique, amusant au départ (les airs terrifiés de « l’élu » sont cocasses), tire en longueur et devient insistant, comme quelques autres gags rustiques typiques de Ford qui est mieux inspiré lors de la rencontre entre Dan et Lee qui flirte avec la comédie américaine. La jeune fille lui balance des vannes jusqu’à ce qu’il se décide à ajuster une nouvelle roue sur le chariot. Cet humour picaresque et surtout cette familiarité avec les personnages permettent de revitaliser un scénario et des protagonistes sortis des feuilletons les plus routiniers. Le rapport avec les Indiens dont on vole les terres, est évacué, les trois « sublimes canailles » se révèlent peu efficaces et se font tuer bêtement en se séparant alors qu’ensemble ils pouvaient tenir tête à la bande de malfrats que dirige l’horrible shérif Hunter (Lou Tellegen impressionnant) dont les airs de dandy vampire qui meurt dans une caverne, annoncent John Carradine. « Il est représenté, non sans ironie, selon McBride, comme une exagération satirique du méchant de western ».
Le film fut mutilé par la Fox, notamment le personnage de Millie, la sœur de Bull Stanley qui est amoureuse du shérif. Une scène brutale où ce dernier la fouettait fut coupée. Ce qui survécut reste exceptionnel. On reste stupéfait devant la beauté sidérante de très nombreuses scènes, qu’il s’agisse du début avec cette file de charriots sur la ligne d’horizon, du rapport entre une action au premier plan – une rencontre, un enterrement aux cadrages si fordiens – et ce qui se passe à l’arrière-plan, de ces cavaliers cadrés à travers une maison en flammes. Cette beauté ne paraît pas composée, imposée, elle surgit naturellement. La caméra semble contemporaine de l’action, de l’Histoire qui est en train de s’écrire (Tom Santschi qui joue Bull Stanley a l’air de sortir d’une photo de Matthew Brady) aussi bien dans ces plans larges foisonnants, étonnants que dans ces petits instantanés quotidiens où le moindre figurant sonne juste : le directeur de journal avec sa presse dans la rue ou sur un chariot ; un Indien abat un arbre ce qui révèle tout un camp en ébullition ; dans un coin de l’image derrière un chariot, on voit les colons progresser.
De multiples détails familiers permettent d’échapper aux conventions. Il faut dire que la collaboration entre Ford et George Schneiderman (22 films) produit des miracles que ce soit dans des plans avec des noirs très contrastés (l’attaque de la maison du pasteur avec des charriots enflammés), des clairs-obscurs ou des lumières douces, à l’aube ou au crépuscule. Et la ligne d’horizon, selon un principe cher à Ford, n’est jamais au centre de l’image. On ne peut pas passer sous silence cette « ruée vers les terres » (land rush) qui s’ouvre par un extraordinaire panoramique sur les participants qui ne semble ne jamais se terminer. La course qui suit reste l’une des plus spectaculaires séquences de l’histoire du cinéma, supérieure à celle de COVERED WAGONS et de CIMARRON avec ce mélange de plans large extraordinaires, dont plusieurs en mouvement, ces cascades, ce chariot qui s’écrase et la roue qui part de son côté, et ces petits inserts (tournés après) sans oublier le plan controversé mais stupéfiant du bébé qu’un bras cueille juste avant qu’il se fasse écraser. Un chef d’œuvre.
LES BATELIERS DE LA VOLGA
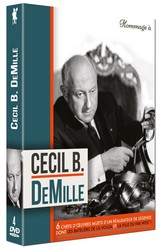 Pour faire mentir des commentaires sur ce blog, signalons que Bach Films dans son coffret consacré à DeMille diffuse cette œuvre dans une très belle copie teintée avec une musique qui s’inspire de ce qui avait été écrit à l’époque. Après le générique, on peut lire que « nos mots ne plaident pas une cause, ne prennent pas parti… Nous ne voulions pas expliquer la Révolution. Aucun homme ne le peut ». La révolution en question est celle d’Octobre 17 et il est vrai que THE VOLGA BOATMAN en dresse un portrait plus nuancé, moins à charge qu’on n’aurait pu l’attendre de DeMille. Certes, les Rouges dès qu’ils s’emparent d’un domaine, d’un château, le saccagent allègrement mais les Blancs ne se conduisent pas mieux. Fêtards, buveurs, ils traitent les paysans, les pauvres avec une morgue, un mépris qui inspirent à DeMille des scènes puissantes notamment quand le Prince Nikita marque au fouet le torse du héros pour avoir refusé de lui nettoyer ses bottes. Il va renvoyer dos à dos les révolutionnaires et les aristocrates faisant condamner dans un effet de miroir ces derniers à tirer les bateaux sur la Volga, filmée sur la rivière Sacramento. Les deux camps malmènent aussi brutalement l’héroïne, la princesse Vera (Elinor Fair, excellente). Les Rouges l’ayant condamné à mort, c’est le batelier Féodor – William Boyd, le futur Hopalong Cassidy – qui doit l’exécuter (« Vous n’avez pas besoin d’une armée pour exécuter une femme seule », fait-elle remarquer). Il en résulte une scène magistrale, typique du réalisateur dans cette façon de mêler ironie et pathos, héroïsme et détails très quotidiens, une scène très bien écrite par Leonore Coffee dont c’est le premier travail pour DeMille. On a donné 5 minutes à Vera pour faire ses prières. Elle commence par jouer le chant des Bateliers au piano, puis avance les aiguilles de la pendule : « Je n’aime pas attendre. » Ce qui lui attire une réponse magistrale de Féodor en remettant la pendule à l’heure : « Voilà cinq cent ans que nous attendons notre liberté, vous pouvez bien attendre cinq minutes. » Elle arrache sa robe et juste au-dessus du sein, se dessine une croix pour l’aider à viser, ce qui le fait craquer et tomber amoureux. Ce coffret comprend un autre film essentiel de DeMille, the GODLESS GIRL (LES DAMNÉS DU CŒUR), qui commence comme une charge contre l’athéisme rendu responsable de tous les maux et bifurque tout à coup vers une dénonciation assez forte du système pénitentiaire et du traitement qu’il inflige aux jeunes.
Pour faire mentir des commentaires sur ce blog, signalons que Bach Films dans son coffret consacré à DeMille diffuse cette œuvre dans une très belle copie teintée avec une musique qui s’inspire de ce qui avait été écrit à l’époque. Après le générique, on peut lire que « nos mots ne plaident pas une cause, ne prennent pas parti… Nous ne voulions pas expliquer la Révolution. Aucun homme ne le peut ». La révolution en question est celle d’Octobre 17 et il est vrai que THE VOLGA BOATMAN en dresse un portrait plus nuancé, moins à charge qu’on n’aurait pu l’attendre de DeMille. Certes, les Rouges dès qu’ils s’emparent d’un domaine, d’un château, le saccagent allègrement mais les Blancs ne se conduisent pas mieux. Fêtards, buveurs, ils traitent les paysans, les pauvres avec une morgue, un mépris qui inspirent à DeMille des scènes puissantes notamment quand le Prince Nikita marque au fouet le torse du héros pour avoir refusé de lui nettoyer ses bottes. Il va renvoyer dos à dos les révolutionnaires et les aristocrates faisant condamner dans un effet de miroir ces derniers à tirer les bateaux sur la Volga, filmée sur la rivière Sacramento. Les deux camps malmènent aussi brutalement l’héroïne, la princesse Vera (Elinor Fair, excellente). Les Rouges l’ayant condamné à mort, c’est le batelier Féodor – William Boyd, le futur Hopalong Cassidy – qui doit l’exécuter (« Vous n’avez pas besoin d’une armée pour exécuter une femme seule », fait-elle remarquer). Il en résulte une scène magistrale, typique du réalisateur dans cette façon de mêler ironie et pathos, héroïsme et détails très quotidiens, une scène très bien écrite par Leonore Coffee dont c’est le premier travail pour DeMille. On a donné 5 minutes à Vera pour faire ses prières. Elle commence par jouer le chant des Bateliers au piano, puis avance les aiguilles de la pendule : « Je n’aime pas attendre. » Ce qui lui attire une réponse magistrale de Féodor en remettant la pendule à l’heure : « Voilà cinq cent ans que nous attendons notre liberté, vous pouvez bien attendre cinq minutes. » Elle arrache sa robe et juste au-dessus du sein, se dessine une croix pour l’aider à viser, ce qui le fait craquer et tomber amoureux. Ce coffret comprend un autre film essentiel de DeMille, the GODLESS GIRL (LES DAMNÉS DU CŒUR), qui commence comme une charge contre l’athéisme rendu responsable de tous les maux et bifurque tout à coup vers une dénonciation assez forte du système pénitentiaire et du traitement qu’il inflige aux jeunes.
CLASSIQUES
Phil Karlson
 Il est bon de faire le point sur Karlson puisque va enfin sortir chez Sidonis THUNDERHOOF/L’ÉTALON SAUVAGE, l’un des westerns les plus ambitieux de la première partie de la carrière de Phil Karlson : 3 personnages, deux hommes, une femme et quelques chevaux, un tournage entièrement en extérieurs, en dehors d’un ou deux décors peu importants. Karlson utilise remarquablement ces paysages arides, rocailleux, escarpés, qui traduisent la violence intérieure des protagonistes : un travelling latéral surplombe de plus en plus Preston Foster et William Bishop, des contreplongées très larges isolent les personnages qui se découpent au sommet d’une crête, durant une bagarre, on passe brutalement d’un cadre serré à un plan d’ensemble. On a le droit à un pugilat teigneux, signature de Karlson, assez vite interrompu et à deux cascades spectaculaires lors de la capture de l’étalon, dont une chute de cheval devant ce dernier. Le scénario, très dépouillé, tourne autour de la capture d’un étalon sauvage (c’est la version minimaliste de The MISFITS), symbole de succès et de richesse, qui va opposer les deux hommes. Les personnages sont plus complexes que d’habitude et tous ont leur zone d’ombre, leurs accès d’égoïsme et de violence (les deux hommes sont tour à tour sympathiques et antipathiques) et le dialogue insiste sur les frustrations, les jalousies, la tentation sexuelle, avec même un petit interlude musical où Bishop fredonne entre autres, The girl he left behind, chère à Ford. Foster est meilleur que Bishop mais Marie Stuart campe une héroïne plutôt originale. Malheureusement la conclusion, soldée, n’est pas à la hauteur de ce qui précède. A noter que THUNDERHOOF sortit en copie sépia.
Il est bon de faire le point sur Karlson puisque va enfin sortir chez Sidonis THUNDERHOOF/L’ÉTALON SAUVAGE, l’un des westerns les plus ambitieux de la première partie de la carrière de Phil Karlson : 3 personnages, deux hommes, une femme et quelques chevaux, un tournage entièrement en extérieurs, en dehors d’un ou deux décors peu importants. Karlson utilise remarquablement ces paysages arides, rocailleux, escarpés, qui traduisent la violence intérieure des protagonistes : un travelling latéral surplombe de plus en plus Preston Foster et William Bishop, des contreplongées très larges isolent les personnages qui se découpent au sommet d’une crête, durant une bagarre, on passe brutalement d’un cadre serré à un plan d’ensemble. On a le droit à un pugilat teigneux, signature de Karlson, assez vite interrompu et à deux cascades spectaculaires lors de la capture de l’étalon, dont une chute de cheval devant ce dernier. Le scénario, très dépouillé, tourne autour de la capture d’un étalon sauvage (c’est la version minimaliste de The MISFITS), symbole de succès et de richesse, qui va opposer les deux hommes. Les personnages sont plus complexes que d’habitude et tous ont leur zone d’ombre, leurs accès d’égoïsme et de violence (les deux hommes sont tour à tour sympathiques et antipathiques) et le dialogue insiste sur les frustrations, les jalousies, la tentation sexuelle, avec même un petit interlude musical où Bishop fredonne entre autres, The girl he left behind, chère à Ford. Foster est meilleur que Bishop mais Marie Stuart campe une héroïne plutôt originale. Malheureusement la conclusion, soldée, n’est pas à la hauteur de ce qui précède. A noter que THUNDERHOOF sortit en copie sépia.
Et enfin, tous les éloges que nous décernions dans 50 ANS DE CINEMA AMERICAIN à BLACK GOLD en citant Doug McLeland se révèlent tout à fait justifiés. Outre cette peinture chaleureuse d’un couple d’Indiens, assez unique dans le cinéma de l’époque (comme est original le fait que le héros meure avant le dénouement), Karlson filme avec sympathie un jeune Chinois, dont le père comme celui de Quinn, a été assassiné par les Blancs et qui sera en butte à une hostilité raciste à l’école et sur le champ de course : « un cheval monté par un Indien et un Chinois ». Et ajoute des touches assez noires (la mort de Blackhawk) pour une œuvre « familiale ».
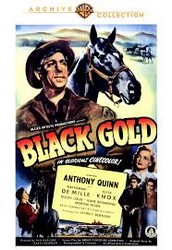

On retrouve les mêmes ambitions sociales dans le passionnant THE BIG CAT qui décrit une petite communauté rurale dans une région dévastée par la sécheresse. De plus le bétail est décimé par un couguar que Preston Foster, acteur cher à Karlson, va essayer de tuer, sujet qui évoque le TRACK OF THE CAT de Wellman. A plusieurs reprises, le cinéaste filme le couguar et ses poursuivants dans le même plan et on a même droit à une bataille entre le fauve et un chien dont je connais peu d’exemples. Karlson décrit un service religieux en plein air mais dirige aussi une de ces bagarres teigneuses qui sont sa spécialité, entre Foster et l’excellent Forrest Tucker. Début de Skip Homeier. Le seul DVD à peu près visible est celui qui prétend offrir une copie restaurée ce qui est faux mais nous fait regretter cette absence car les extérieurs paraissent splendides.

On retrouve les préoccupations sociales de Karlson dans ce splendide western dense, dépouillé, très bien mis en scène et joué (Van Heflin est sensationnel et Tab Hunter trouve son meilleur rôle – à noter qu’il chante une chanson écrite par Richard Quine -) qu’est LE SALAIRE DE LA VIOLENCE dont on a trop peu parlé dans ce blog extrêmement bien écrit par le scénariste de Ford, Frank Nugent et dans SAIPAN, film de guerre qui dénonçait le racisme envers les Nisei, les Japonais américains.
Revoyez THE MOB, petit polar superbement dialogué par William Bowers (l’arrivée de Broderick Crawford dans un hôtel miteux et ses échanges avec Jay Adler, acteur fétiche de Parrish, sont hilarants). La première scène d’action sous la pluie, est superbement découpée. De même que la séquence finale. Il est intéressant de comparer cette œuvre avec SUR LES QUAIS que j’ai revu et qui me déçoit toujours après un premier tiers brillant. Le scénario glisse insidieusement de la chronique sociale à l’évocation apologétique d’un cas personnel et le ton devient de plus en plus christique. On sent que les auteurs veulent s’absoudre eux-mêmes de leur délation. Plus que Brando, c’est Eva Marie Saint qui illumine le film.
Mark Robson
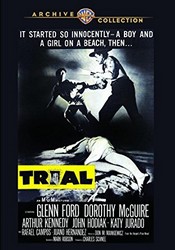 TRIAL (LE PROCÈS) est une œuvre passionnante que nous voulions revoir dans sa vraie version (4 minutes de plus), après la défense de Rivette et qui confirme de manière positive la remarque de Yordan reprochant à Robson de vouloir s’en prendre à l’establishment et d’être obsédé par la critique sociale. On se demande même si le titre, au-delà de son contenu judiciaire (la défense d’un jeune Mexicain accusé de meurtre), n’a pas une portée métaphorique plus large tant les auteurs mettent en cause tout ce qui déchire, ravage les Etats-Unis en 1947 : le racisme qui gangrène non seulement les citoyens mais certaines institutions, la corruption policière, les pressions sur la Justice, la manipulation orchestrée par un parti politique, le parti communiste, pour fabriquer une cause et obtenir un martyr. Sans oublier la Commission des activités anti-américaines qui renait et s’en prend dans une séquence brutale à Glenn Ford, l’avocat du jeune Mexicain parce qu’il s’est rendu à un meeting orchestré par les Communistes. La description de la communauté blanche haineuse, bigote dépasse « l’anti-racisme de complaisance ». On y voit des suprémacistes blancs qui organisent un lynchage et veulent attaquer la prison à la nitroglycérine. Le shérif ne leur parle qu’après avoir été payé par Ford et les désarme en leur promettant une « pendaison humaine ».
TRIAL (LE PROCÈS) est une œuvre passionnante que nous voulions revoir dans sa vraie version (4 minutes de plus), après la défense de Rivette et qui confirme de manière positive la remarque de Yordan reprochant à Robson de vouloir s’en prendre à l’establishment et d’être obsédé par la critique sociale. On se demande même si le titre, au-delà de son contenu judiciaire (la défense d’un jeune Mexicain accusé de meurtre), n’a pas une portée métaphorique plus large tant les auteurs mettent en cause tout ce qui déchire, ravage les Etats-Unis en 1947 : le racisme qui gangrène non seulement les citoyens mais certaines institutions, la corruption policière, les pressions sur la Justice, la manipulation orchestrée par un parti politique, le parti communiste, pour fabriquer une cause et obtenir un martyr. Sans oublier la Commission des activités anti-américaines qui renait et s’en prend dans une séquence brutale à Glenn Ford, l’avocat du jeune Mexicain parce qu’il s’est rendu à un meeting orchestré par les Communistes. La description de la communauté blanche haineuse, bigote dépasse « l’anti-racisme de complaisance ». On y voit des suprémacistes blancs qui organisent un lynchage et veulent attaquer la prison à la nitroglycérine. Le shérif ne leur parle qu’après avoir été payé par Ford et les désarme en leur promettant une « pendaison humaine ».
Nous ne connaissons aucun film de cette époque qui s’en prenne aussi frontalement à autant de thèmes brûlants et on aurait pu s’y perdre. Mais Robson orchestre le scénario de Don Mankiewicz (I WANT TO LIVE) avec une rigueur, une force de conviction assez remarquable qui n’exclut pas la subtilité : le personnage du juge noir incarné par Juano Hernandez fait apparaître les limites de l’anti-racisme de Ford (dont la déstabilisation nous vaut un plan magnifique). TRIAL évoque de manière prémonitoire et avec une grande justesse comment une cause (et donc la politique) se transforme en spectacle lors de la scène du meeting communiste, l’une des plus spectaculaires, des plus brillantes que Robson ait jamais tourné, avec des changements de plan, d’axes qui n’ont rien à envier à ELMER GANTRY. Arthur Kennedy en avocat manipulateur y est sensationnel et ses méthodes semblent très proches de celles des prédicateurs fondamentalistes. On peut regretter les motivations superficielles données par Dorothy McGuire, par ailleurs, excellente, pour justifier son adhésion au Parti et surtout les 10 dernières minutes qui sacrifient aux travers des films de procès (avalanche de coups de théâtre) et à une vision plus univoque et conservatrice, défaut courant dans les productions Dore Schary. Partition moderne, inventive et discrète de Daniele Amfiteatrof. Proche de celle de THE HARDER THEY FALL.
Revus du coup LES PONTS DE TOKO-RI que nous avions expédié avec condescendance dans 50 ANS. Le film vaut mieux que cela. C’est une chronique plutôt désenchantée d’un épisode de la guerre de Corée et le ton n’est ni exaltateur ni cocardier. Au contraire. Le film comprend dès le début des péripéties assez sombres : les avions se crashent dans l’Océan, Holden ne comprend pas pourquoi on fait cette guerre et même les explications de l’amiral très bien joué par Fredric March ne le convainquent pas. March est lui-même comme miné par la mélancolie. On le sent désillusionné. Et lors des séquences finales brillamment filmées et orchestrées par Robson, Holden déclare : « Mauvaise guerre, mauvais endroit. » LES PONTS DE TOKO-RI contiennent aussi de très beaux plans d’appontage. Il faut revenir sur Robson qui semble n’avoir jamais totalement renoncé à l’engament social ou esthétique de ses premiers films, sensibles dans BEDLAM, THE SEVENTH VICTIM (et aussi le curieux YOUTH RUNS WILD), THE CHAMPION ou HOME OF THE BRAVE. Cela dit ROUGHSHOD est un western moyen que rehausse la présence de Gloria Grahame.
EMPEROR OF THE NORTH
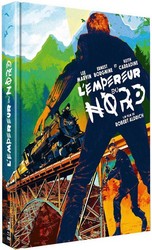 EMPEROR OF THE NORTH concentre, regroupe dans une sorte d’épure minimaliste impressionnante un grand nombre d’obsessions, de thématiques chères à Aldrich de THE BIG KNIFE à HUSTLE, d’ATTACK à THE LONGEST YARD, ULZANAH’S RAID : l’existence vue comme un exercice de survie, un affrontement sans merci, filmé avec colère, avec rage, entre le marginal, l’outsider et le représentant, le défenseur de l’ordre, du système qui est souvent un névropathe de la pire espèce. Schack qu’incarne Ernest Borgnine dans EMPEROR bat tous les records de brutalité, de mépris, de sadisme. Il ne vit que pour mutiler, éliminer, par tous les moyens les vagabonds qui tentent de voyager sur « son » train, aidé par un nervi demeuré. Il dispose d’un arsenal impressionnant de chaînes, de marteaux, de matraques plombées qu’il fait rebondir pour casser la colonne vertébrale de ceux qui s’accrochent aux essieux. C’est un bloc de haine, une haine animale qu’Aldrich, refusant toute psychologie, n’essaie jamais de justifier, d’expliquer, de corriger par une touche humaniste (reprocher que ce personnage manque de nuance équivaut, comme dirait Burt Lancaster dans ULZANA’S RAID, à se plaindre que le désert soit aride). C’est l’une des interprétations les plus physiques de Borgnine qui ne cesse de courir sur le toit des wagons, de sauter des locomotives. En face, A no1, le chemineau anarchiste que joue avec une rare économie Lee Marvin, veut réussir à voyager sur ce train et il s’ensuivra un duel à mort que rien ne paraît justifier, sauf l’orgueil des deux hommes, la colère qui les habite et le code de l’honneur de A no 1. Leur rivalité, leur affrontement survolte le film, lui communiquant une puissance d’abord mise à mal par une pénible chanson d’ouverture. Comme souvent chez Aldrich l’action est circonscrite dans un lieu clos (la maison de CHARLIE CASTLE, celle de BABY JANE, la prison de THE LONGEST YARD), parfois située comme ici (et ULZANA’S RAID ou FLIGHT OF THE PHOENIX) dans d’immenses espaces qui sont perçus comme une forme différente de prison. Les extérieurs ne sont ici comme dans ULZANA ni cathartiques ni libérateurs.
EMPEROR OF THE NORTH concentre, regroupe dans une sorte d’épure minimaliste impressionnante un grand nombre d’obsessions, de thématiques chères à Aldrich de THE BIG KNIFE à HUSTLE, d’ATTACK à THE LONGEST YARD, ULZANAH’S RAID : l’existence vue comme un exercice de survie, un affrontement sans merci, filmé avec colère, avec rage, entre le marginal, l’outsider et le représentant, le défenseur de l’ordre, du système qui est souvent un névropathe de la pire espèce. Schack qu’incarne Ernest Borgnine dans EMPEROR bat tous les records de brutalité, de mépris, de sadisme. Il ne vit que pour mutiler, éliminer, par tous les moyens les vagabonds qui tentent de voyager sur « son » train, aidé par un nervi demeuré. Il dispose d’un arsenal impressionnant de chaînes, de marteaux, de matraques plombées qu’il fait rebondir pour casser la colonne vertébrale de ceux qui s’accrochent aux essieux. C’est un bloc de haine, une haine animale qu’Aldrich, refusant toute psychologie, n’essaie jamais de justifier, d’expliquer, de corriger par une touche humaniste (reprocher que ce personnage manque de nuance équivaut, comme dirait Burt Lancaster dans ULZANA’S RAID, à se plaindre que le désert soit aride). C’est l’une des interprétations les plus physiques de Borgnine qui ne cesse de courir sur le toit des wagons, de sauter des locomotives. En face, A no1, le chemineau anarchiste que joue avec une rare économie Lee Marvin, veut réussir à voyager sur ce train et il s’ensuivra un duel à mort que rien ne paraît justifier, sauf l’orgueil des deux hommes, la colère qui les habite et le code de l’honneur de A no 1. Leur rivalité, leur affrontement survolte le film, lui communiquant une puissance d’abord mise à mal par une pénible chanson d’ouverture. Comme souvent chez Aldrich l’action est circonscrite dans un lieu clos (la maison de CHARLIE CASTLE, celle de BABY JANE, la prison de THE LONGEST YARD), parfois située comme ici (et ULZANA’S RAID ou FLIGHT OF THE PHOENIX) dans d’immenses espaces qui sont perçus comme une forme différente de prison. Les extérieurs ne sont ici comme dans ULZANA ni cathartiques ni libérateurs.
DAVID O. RUSSELL
3 KINGS/LES ROIS DU DÉSERT
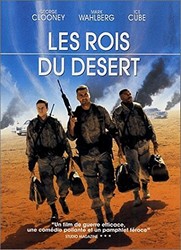 A la fin de la première guerre du Golfe, un soldat américain, Troy, marchant dans le désert, voit au loin sur un monticule un individu qui agite les bras avec un chiffon. Il demande s’il doit tirer… Autour de lui, des petits groupes de militaires ne se sentent pas du tout concernés par sa question, et se concentrent sur un grain de sable dans un œil. Croyant voir une arme, il tire et tue quelqu’un qui voulait se rendre avec un drapeau blanc. « C’est mon premier melon mort », constate placidement Conrad (Spike Jonze), un des copains de Troy. Le ton est donné. David O. Russell et son coscénariste John Ridley (12 YEARS A SLAVE) entendent faire voler en éclat tout le vernis de cette guerre médiatique, un sacré merdier s’abritant sous des couleurs humanistes. Et ils n’épargnent personne : ni les médias (qui sont tenus par l’Armée qui les aiguille sur de faux scoops), ni les symboles (on danse et on se saoule devant les drapeaux, en déconnant au son de God Bless America) ni le racisme qui sévit chez les soldats et les officiers. L’adjudant Elgin, venu de Detroit aux frais de l’Armée précise un carton, que joue Ice Cube, entend corriger le vocabulaire de Conrad : « Je me fous qu’il soit de Johannesburg. Je ne veux pas entendre « bamboula des dunes » ou « nègre des sables » » – « Mais le Capitaine utilise ces expressions. » Troy intervient : « Ça n’est pas le propos, Conrad. Il existe de très bons substituts comme « melons » ou « sauteur de chameaux » Elgin : « Exactement. » Plus tard, Archie Gates (George Clooney) résumera la morale de ce conflit : « Bush a dit au peuple de se soulever contre Saddam. Ils pensaient qu’on allait les soutenir. Je t’en fous. Et maintenant ils se font massacrer. » On a envie de créditer David O. Russell, au vu de ses œuvres précédentes, pour le ton déjanté du film, pour les continuels changements de ton. On a l’impression que chaque scène contredit, voire annule la précédente, brouille les pistes ou bifurque dans une direction inattendue. Comme si le scénario s’inventait sous nos yeux (ce qui, dans une aventure guerrière, paraît des plus réalistes) dans une atmosphère de chaos absolu. Les choses commencent de manière sérieuse pour buter sur une remarque hilarante (« Qu’est ce qui se passe avec Michael Jackson ? » surgit au milieu d’un interrogatoire plutôt violent), une parenthèse drolatique ou un gag de cartoon. Une série de vannes caustiques, cyniques, (on ressent même un vrai malaise devant cet égoïsme auto-proclamé) est interrompue de manière foudroyante par un plan où un militaire fait exploser la tête d’une femme irakienne devant sa fille. Durant leur raid, les quatre Rois (On se demande pourquoi le titre n’en retient que trois), traversent un pays ravagé, affamé et dans le premier bunker où ils comptaient trouver de l’or tombent sur une foule de prisonniers qui ont été torturé par les sbires de Saddam.
A la fin de la première guerre du Golfe, un soldat américain, Troy, marchant dans le désert, voit au loin sur un monticule un individu qui agite les bras avec un chiffon. Il demande s’il doit tirer… Autour de lui, des petits groupes de militaires ne se sentent pas du tout concernés par sa question, et se concentrent sur un grain de sable dans un œil. Croyant voir une arme, il tire et tue quelqu’un qui voulait se rendre avec un drapeau blanc. « C’est mon premier melon mort », constate placidement Conrad (Spike Jonze), un des copains de Troy. Le ton est donné. David O. Russell et son coscénariste John Ridley (12 YEARS A SLAVE) entendent faire voler en éclat tout le vernis de cette guerre médiatique, un sacré merdier s’abritant sous des couleurs humanistes. Et ils n’épargnent personne : ni les médias (qui sont tenus par l’Armée qui les aiguille sur de faux scoops), ni les symboles (on danse et on se saoule devant les drapeaux, en déconnant au son de God Bless America) ni le racisme qui sévit chez les soldats et les officiers. L’adjudant Elgin, venu de Detroit aux frais de l’Armée précise un carton, que joue Ice Cube, entend corriger le vocabulaire de Conrad : « Je me fous qu’il soit de Johannesburg. Je ne veux pas entendre « bamboula des dunes » ou « nègre des sables » » – « Mais le Capitaine utilise ces expressions. » Troy intervient : « Ça n’est pas le propos, Conrad. Il existe de très bons substituts comme « melons » ou « sauteur de chameaux » Elgin : « Exactement. » Plus tard, Archie Gates (George Clooney) résumera la morale de ce conflit : « Bush a dit au peuple de se soulever contre Saddam. Ils pensaient qu’on allait les soutenir. Je t’en fous. Et maintenant ils se font massacrer. » On a envie de créditer David O. Russell, au vu de ses œuvres précédentes, pour le ton déjanté du film, pour les continuels changements de ton. On a l’impression que chaque scène contredit, voire annule la précédente, brouille les pistes ou bifurque dans une direction inattendue. Comme si le scénario s’inventait sous nos yeux (ce qui, dans une aventure guerrière, paraît des plus réalistes) dans une atmosphère de chaos absolu. Les choses commencent de manière sérieuse pour buter sur une remarque hilarante (« Qu’est ce qui se passe avec Michael Jackson ? » surgit au milieu d’un interrogatoire plutôt violent), une parenthèse drolatique ou un gag de cartoon. Une série de vannes caustiques, cyniques, (on ressent même un vrai malaise devant cet égoïsme auto-proclamé) est interrompue de manière foudroyante par un plan où un militaire fait exploser la tête d’une femme irakienne devant sa fille. Durant leur raid, les quatre Rois (On se demande pourquoi le titre n’en retient que trois), traversent un pays ravagé, affamé et dans le premier bunker où ils comptaient trouver de l’or tombent sur une foule de prisonniers qui ont été torturé par les sbires de Saddam.
On a beaucoup dit que le sujet – quatre militaires vont monter une opération pour piquer l’or que Saddam avait volé au Koweit – faisait penser à un mélange de KELLY’S HEROES (qui a moyennement bien vieilli) et de M.A.S.H. Ce n’est pas faux et sans doute que John Ridley, auteur du sujet original, y a pensé. Mais on doit aussi remarquer que les deux guerres servant de cadre à ces œuvres étaient plus lointaines, plus abstraites pour le public (même si la Corée renvoyait au Vietnam) que celle, quasi contemporaine de THREE KINGS. Et le propos du film est nettement plus direct, les allusions beaucoup plus précises. Lors de la longue séquence d’interrogatoire de Troy, le Capitaine Saïd (Saïd Taghmaoui, formidable de dignité et de conviction), retourne, réfute, balaye de manière imparable tous les arguments de l’Américain, tout un discours officiel justifiant cette guerre tout en condamnant Saddam Hussein.
THREE KINGS a reçu un accueil hostile de la part de certains donneurs de leçons cléricaux jugeant éculée cette dénonciation de l’absurdité de la guerre (pourtant le film, loin de dénoncer l’absurdité de la Guerre, s’en prend aux caractéristiques concrètes d’une guerre spécifique, aux mensonges, aux calculs, aux faux prétextes qui l’ont provoquée) et critiquant les partis pris visuels « antipathiques », esthétisants (caméra en mouvement qui vous plonge au milieu de l’action, montage éclaté, suppression du bain de blanchiment dans l’image). Ils s’appuient surtout sur les dernières scènes, les plus faibles, les plus discutables, où Clooney et ses potes vont aider des réfugiés irakiens à franchir une frontière. Ce rachat, souligné par des ralentis qui sont, là, intempestifs (dans le reste du film, Russell les utilise de manière magistrale) est à la fois lourd et contre-productif. On a l’impression que les auteurs ont eu peur que leurs personnages révulsent le public (ce qui s’est un peu passé, le film n’a pas été un succès) et qu’ils ont voulu les racheter en sacrifiant à l’effet ROCKY. A la toute fin, clin d’œil ironique, ils font de Clooney un conseiller pour les scènes d’action hollywoodiennes. On peut constater que la plupart des films qui ont voulu mêler à des sujets « sérieux » la comédie et l’aventure ont été souvent reçus avec le même genre d’arguments à commencer par M.A.S.H. décrié par ceux-là même qui s’en servent contre THREE KINGS et avec des arguments identiques. Ce n’est jamais la bonne manière d’aborder la guerre surtout si vous affichez des ambitions progressistes, toujours récupérées. Il est bon de rappeler que TO BE OR NOT TO BE fut accusé d’exploiter et de faire rire bassement au détriment de l’invasion de la Pologne et Lubitsch prit la peine de répondre à un critique de Philadelphie. ARISE, MY LOVE connut le même sort. Michel Chion a par ailleurs brillamment retoqué cette approche critique qui consistait à prendre un ou deux points plus faibles pour annihiler tout un film qui survit brillamment à cette péripétie inutile.
Je n’ai guère aimé I HEART HUCKABEES de Russell où toutes les ambitions me paraissent plombées par un esprit de sérieux et ratent leurs cible.
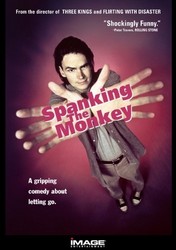 En revanche, SPANKING THE MONKEY me paraît plus réussi malgré quelques faux-pas. Débuts prometteurs pour David O. Russell avec cette pseudo comédie de teenagers (qui coûta 80 000 dollars) qui parle de sexe mais pas comme on s’y attend. Le titre, métaphore argotique pour la masturbation, renvoie à plusieurs scènes où Ray, jeune étudiant en médecine très prometteur, tente vainement de se masturber dans les toilettes, bloqué chaque fois par le barouf du chien dont il est censé s’occuper. En fait de sexe, le film aborde un sujet plus scabreux et pratiquement tabou. Ray se voit contraint par son père, un vendeur de vidéos pingre, obsessionnel jusqu’à l’autisme et qui profite de ses voyages pour tromper sa femme, de s’occuper de sa mère, clouée au lit par une fracture. Il doit l’amener aux toilettes, à la douche et cette proximité qui n’est jamais filmée de manière émoustillante, entraîne des rapports étranges, malsains qui vont basculer vers l’inceste et l’on pense au SOUFFLE AU CŒUR de Louis Malle. En fait et le père et la mère traitent leur fils comme leur propriété personnelle sans chercher ni à l’aider ni même à le connaître. David O. Russell traite ces rapports sur un ton personnel, original, à la fois intime, pince sans rire et marqué par un humour décalé. Lors de leur première rencontre, le père impose à son fils un entassement de règles aussi tortueuses qu’aberrantes mais la séquence est jouée sérieusement, avec conviction, pas du tout comme une scène de comédie, ce qui en accroît la drôlerie, l’étrangeté et la vérité. Il nous fait sentir l’instabilité des rapports entre Ray et sa mère et, ce qui en décuple la tension, on sent que les scènes peuvent aller dans n’importe quelle direction. Le film doit beaucoup à l’interprétation tranquille, nuancée, à la douleur sous-jacente de Jeremy Davies et à celle, bouillonnante, tourmentée d’Alberta Watson qui, elle, blesse avec une désinvolture aveugle, minée par le déni, anesthésiée par ce que lui a fait subir son mari.
En revanche, SPANKING THE MONKEY me paraît plus réussi malgré quelques faux-pas. Débuts prometteurs pour David O. Russell avec cette pseudo comédie de teenagers (qui coûta 80 000 dollars) qui parle de sexe mais pas comme on s’y attend. Le titre, métaphore argotique pour la masturbation, renvoie à plusieurs scènes où Ray, jeune étudiant en médecine très prometteur, tente vainement de se masturber dans les toilettes, bloqué chaque fois par le barouf du chien dont il est censé s’occuper. En fait de sexe, le film aborde un sujet plus scabreux et pratiquement tabou. Ray se voit contraint par son père, un vendeur de vidéos pingre, obsessionnel jusqu’à l’autisme et qui profite de ses voyages pour tromper sa femme, de s’occuper de sa mère, clouée au lit par une fracture. Il doit l’amener aux toilettes, à la douche et cette proximité qui n’est jamais filmée de manière émoustillante, entraîne des rapports étranges, malsains qui vont basculer vers l’inceste et l’on pense au SOUFFLE AU CŒUR de Louis Malle. En fait et le père et la mère traitent leur fils comme leur propriété personnelle sans chercher ni à l’aider ni même à le connaître. David O. Russell traite ces rapports sur un ton personnel, original, à la fois intime, pince sans rire et marqué par un humour décalé. Lors de leur première rencontre, le père impose à son fils un entassement de règles aussi tortueuses qu’aberrantes mais la séquence est jouée sérieusement, avec conviction, pas du tout comme une scène de comédie, ce qui en accroît la drôlerie, l’étrangeté et la vérité. Il nous fait sentir l’instabilité des rapports entre Ray et sa mère et, ce qui en décuple la tension, on sent que les scènes peuvent aller dans n’importe quelle direction. Le film doit beaucoup à l’interprétation tranquille, nuancée, à la douleur sous-jacente de Jeremy Davies et à celle, bouillonnante, tourmentée d’Alberta Watson qui, elle, blesse avec une désinvolture aveugle, minée par le déni, anesthésiée par ce que lui a fait subir son mari.
Lire la suite »
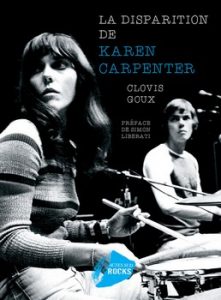 LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER de Clovis Gout est le récit très poignant, très direct d’une autodestruction, celle de Karen Carpenter qui va mourir d’anorexie. Mais le livre trace aussi un portrait fort de l’époque et de l’Amérique en proie à ses contradictions. Durant les années 1970, The Carpenters est le groupe le plus populaire aux États-Unis. Un immense succès (100 millions de disques vendus) qui s’explique par l’alchimie unique entre ses deux membres fondateurs, Richard et Karen Carpenter, un frère et une sœur. Ces deux enfants de la classe moyenne imposent un retour à l’ordre musical après la révolution psychédélique, avec des hits aussi romantiques que réactionnaires, tels Close to you, We’ve Only Just Begun ou Rainy Days and Mondays. Mais derrière cette success story se cache une tragédie. La Disparition de Karen Carpenter raconte cette histoire, nous amenant à porter un regard de côté sur les grands phénomènes socio-culturels qui marquèrent l’Amérique de l’époque. Evitez la préface de Simon Liberati qui réduit le propos du livre et sa force.
LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER de Clovis Gout est le récit très poignant, très direct d’une autodestruction, celle de Karen Carpenter qui va mourir d’anorexie. Mais le livre trace aussi un portrait fort de l’époque et de l’Amérique en proie à ses contradictions. Durant les années 1970, The Carpenters est le groupe le plus populaire aux États-Unis. Un immense succès (100 millions de disques vendus) qui s’explique par l’alchimie unique entre ses deux membres fondateurs, Richard et Karen Carpenter, un frère et une sœur. Ces deux enfants de la classe moyenne imposent un retour à l’ordre musical après la révolution psychédélique, avec des hits aussi romantiques que réactionnaires, tels Close to you, We’ve Only Just Begun ou Rainy Days and Mondays. Mais derrière cette success story se cache une tragédie. La Disparition de Karen Carpenter raconte cette histoire, nous amenant à porter un regard de côté sur les grands phénomènes socio-culturels qui marquèrent l’Amérique de l’époque. Evitez la préface de Simon Liberati qui réduit le propos du livre et sa force. LE MONDE LIBRE d’Aude Lancelin est un portrait au scalpel des errements du Nouvel Observateur (surnommé L’Obsolète) en proie aux repreneurs et notamment de Jean Daniel (alias Jean Joel) dont Aude Lancelin saisit toutes les contradictions. Sans oublier un gigantesque égocentrisme. Je n’ai jamais oublié le moment où il s’est imposé dans une émission sur les Appelés après LA GUERRE SANS NOM et qu’il a tenu à squatter l’écran pour raconter ses séjours à l’hôpital, privant de parole des gens qui n’étaient jamais interviewés. Dans le récit caustique, aigu d’Aude Lancelin, on admire la force assassine du portrait de Matthieu Croissandeau, comme l’écrit Libération, alias «Matthieu Lunedeau», le directeur de la rédaction de l’Obs qui l’a congédiée. Un «garçon» d’un «naturel inconséquent», décrit comme l’homme de paille des actionnaires, plus porté sur les séminaires de management que sur la réflexion théorique, et pour qui «être de gauche, [c’est] avant tout ne pas être de droite». Lunedeau/Croissandeau fournirait un très bon personnage de fourbe, toujours en accord avec le plus fort au second plan, à Lubitsch ou Billy Wilder. Ou Monicelli : j’ai pensé à Sordi dans UN HÉROS DE NOTRE TEMPS. Certains ont trouvé qu’Aude Lancelin s’absolvait parfois assez facilement mais cela ne change rien aux dérives qu’elle dénonce aussi bien à l’Observateur qu’à Marianne. Seul bémol, son enthousiasme – ou au moins son soutien – qu’on peut juger plus que discutable pour Alain Badiou, le défenseur des Khmers Rouges.
LE MONDE LIBRE d’Aude Lancelin est un portrait au scalpel des errements du Nouvel Observateur (surnommé L’Obsolète) en proie aux repreneurs et notamment de Jean Daniel (alias Jean Joel) dont Aude Lancelin saisit toutes les contradictions. Sans oublier un gigantesque égocentrisme. Je n’ai jamais oublié le moment où il s’est imposé dans une émission sur les Appelés après LA GUERRE SANS NOM et qu’il a tenu à squatter l’écran pour raconter ses séjours à l’hôpital, privant de parole des gens qui n’étaient jamais interviewés. Dans le récit caustique, aigu d’Aude Lancelin, on admire la force assassine du portrait de Matthieu Croissandeau, comme l’écrit Libération, alias «Matthieu Lunedeau», le directeur de la rédaction de l’Obs qui l’a congédiée. Un «garçon» d’un «naturel inconséquent», décrit comme l’homme de paille des actionnaires, plus porté sur les séminaires de management que sur la réflexion théorique, et pour qui «être de gauche, [c’est] avant tout ne pas être de droite». Lunedeau/Croissandeau fournirait un très bon personnage de fourbe, toujours en accord avec le plus fort au second plan, à Lubitsch ou Billy Wilder. Ou Monicelli : j’ai pensé à Sordi dans UN HÉROS DE NOTRE TEMPS. Certains ont trouvé qu’Aude Lancelin s’absolvait parfois assez facilement mais cela ne change rien aux dérives qu’elle dénonce aussi bien à l’Observateur qu’à Marianne. Seul bémol, son enthousiasme – ou au moins son soutien – qu’on peut juger plus que discutable pour Alain Badiou, le défenseur des Khmers Rouges.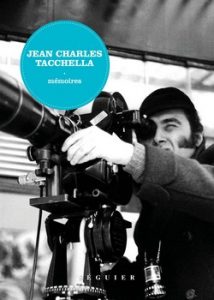 Jean-Charles Tacchella a écrit ses souvenirs qu’il a sobrement intitulés MÉMOIRES. C’est une chronique chaleureuse et pudique, sans effets de manche, d’un passionné de cinéma, qui sèche les cours en fin de matinée pour attraper la première séance et ceux de l’après midi mais qui passe son Bac, qui échappe au STO. Tacchella ne glorifie jamais ses actions mais fait revivre tout un quotidien tissé d’actes remplis de dignité. Et pour gagner sa vie, il écrit pour l’Ecran Français. Ce qui lui permet d’évoquer les combats contre les accords Blum-Byrnes, voit plusieurs fois Erich Von Stroheim qui pleure à volonté pour se libérer d’une personne importune, Chico Marx qui analyse en détail tous les gags des Marx Brothers, emmène Bazin rencontrer Wyler (pendant cinq heures et on n’enregistrait pas les interviews à cette époque). J’ai un faible pour la rencontre avec Laurel et Hardy où Laurel donne une leçon de mise en scène. On est charmé, passionné tant par la modestie du propos (mais ne croyez pas que ce soit mal écrit). Comme l’écrit Vincent Roussel : « Dans mes quatorze films, j’ai essayé de débanaliser la vie. Lui donner d’autres couleurs pour mieux l’apprécier. J’ai imaginé des personnages, des petites gens pour la plupart, qui veulent échapper au quotidien. Le regard m’importe plus que le style. La légèreté, la dérision, la fantaisie et l’émotion, je ne peux m’en passer. »Il faut attendre la fin du livre (la page 852 (!) exactement) pour que le cinéaste Jean-Charles Tacchella ose cette sorte de profession de foi en forme de bilan artistique. Et il est tentant d’appliquer ces mots à ces mémoires passionnants puisque, là aussi, le cinéaste préfère « le regard » au « style ». Non pas que le livre soit « mal écrit » (bien au contraire) mais il est dénué de fioritures ou d’effets de manche. Tacchella s’efface et nous propose un regard léger, amusé et parfois mélancolique sur une vie bien remplie, entièrement dédiée au cinéma.
Jean-Charles Tacchella a écrit ses souvenirs qu’il a sobrement intitulés MÉMOIRES. C’est une chronique chaleureuse et pudique, sans effets de manche, d’un passionné de cinéma, qui sèche les cours en fin de matinée pour attraper la première séance et ceux de l’après midi mais qui passe son Bac, qui échappe au STO. Tacchella ne glorifie jamais ses actions mais fait revivre tout un quotidien tissé d’actes remplis de dignité. Et pour gagner sa vie, il écrit pour l’Ecran Français. Ce qui lui permet d’évoquer les combats contre les accords Blum-Byrnes, voit plusieurs fois Erich Von Stroheim qui pleure à volonté pour se libérer d’une personne importune, Chico Marx qui analyse en détail tous les gags des Marx Brothers, emmène Bazin rencontrer Wyler (pendant cinq heures et on n’enregistrait pas les interviews à cette époque). J’ai un faible pour la rencontre avec Laurel et Hardy où Laurel donne une leçon de mise en scène. On est charmé, passionné tant par la modestie du propos (mais ne croyez pas que ce soit mal écrit). Comme l’écrit Vincent Roussel : « Dans mes quatorze films, j’ai essayé de débanaliser la vie. Lui donner d’autres couleurs pour mieux l’apprécier. J’ai imaginé des personnages, des petites gens pour la plupart, qui veulent échapper au quotidien. Le regard m’importe plus que le style. La légèreté, la dérision, la fantaisie et l’émotion, je ne peux m’en passer. »Il faut attendre la fin du livre (la page 852 (!) exactement) pour que le cinéaste Jean-Charles Tacchella ose cette sorte de profession de foi en forme de bilan artistique. Et il est tentant d’appliquer ces mots à ces mémoires passionnants puisque, là aussi, le cinéaste préfère « le regard » au « style ». Non pas que le livre soit « mal écrit » (bien au contraire) mais il est dénué de fioritures ou d’effets de manche. Tacchella s’efface et nous propose un regard léger, amusé et parfois mélancolique sur une vie bien remplie, entièrement dédiée au cinéma.