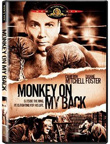J’ai revu avec plaisir CAROLINE CHÉRIE, film très agréable même si Martine Carol parait un peu âgée et déphasée par rapport aux critères d’érotisme actuel (elle a de fort jolis seins mais le film est assez pudique et moins sensuel ou libertin que le roman de Cecil Saint-Laurent, fort bon). L’épisode de la maison de santé du Docteur Belhomme est particulièrement réussi, d’une surprenante dureté de ton accentuée par la sobriété de la réalisation de Richard Pottier (qui préserve le film des ravages du temps) et la causticité, cinglante des dialogues d’Anouilh (moins inspirés dans ses allusions anachroniques et blagueuses au 14 Juillet, un peu lourdes). Au-delà des vacheries anti révolutionnaires, Anouilh dresse un portrait sombre des mégères, des concierges dénonciatrices qui peut évoquer l’Occupation et ne peint pas sous un jour glorieux la conduite des Princes face aux Chouans.
J’ai revu avec plaisir CAROLINE CHÉRIE, film très agréable même si Martine Carol parait un peu âgée et déphasée par rapport aux critères d’érotisme actuel (elle a de fort jolis seins mais le film est assez pudique et moins sensuel ou libertin que le roman de Cecil Saint-Laurent, fort bon). L’épisode de la maison de santé du Docteur Belhomme est particulièrement réussi, d’une surprenante dureté de ton accentuée par la sobriété de la réalisation de Richard Pottier (qui préserve le film des ravages du temps) et la causticité, cinglante des dialogues d’Anouilh (moins inspirés dans ses allusions anachroniques et blagueuses au 14 Juillet, un peu lourdes). Au-delà des vacheries anti révolutionnaires, Anouilh dresse un portrait sombre des mégères, des concierges dénonciatrices qui peut évoquer l’Occupation et ne peint pas sous un jour glorieux la conduite des Princes face aux Chouans.
 LE MARIAGE DE CHIFFON est un vrai chef d’œuvre que ne ternissent pas quelques scratches au début, une chute dans la bande son et la musique pléonastique, peu inspirée de Roger Desormière (meilleur chef d’orchestre que compositeur) qui ne trouve sa place que quand elle cite ou brode des variations sur Fascination. Le scénario d’Aurenche est magistral et cela dès le premier dialogue nonsensique entre André Luguet et la marchande de journaux, magistrale introduction. Aurenche joue avec les accessoires (les chaussures donnent lieu à des variations éblouissantes) pour nous faire découvrir les personnages. C’est une leçon de comédie. Le film souvent inspiré (les travellings ophulsiens dans les pièces vides) se teinte peu à peu d’émotion, de nostalgie, de tendresse. Chaque fois que j’entends Odette Joyeux dire que ces boucles d’oreilles offertes par Jacques Dumesnil ont causé ses deux grands moments de chagrin et de peine « quand je les ai reçues et quand je les redonne », j’ai le cœur serré.
LE MARIAGE DE CHIFFON est un vrai chef d’œuvre que ne ternissent pas quelques scratches au début, une chute dans la bande son et la musique pléonastique, peu inspirée de Roger Desormière (meilleur chef d’orchestre que compositeur) qui ne trouve sa place que quand elle cite ou brode des variations sur Fascination. Le scénario d’Aurenche est magistral et cela dès le premier dialogue nonsensique entre André Luguet et la marchande de journaux, magistrale introduction. Aurenche joue avec les accessoires (les chaussures donnent lieu à des variations éblouissantes) pour nous faire découvrir les personnages. C’est une leçon de comédie. Le film souvent inspiré (les travellings ophulsiens dans les pièces vides) se teinte peu à peu d’émotion, de nostalgie, de tendresse. Chaque fois que j’entends Odette Joyeux dire que ces boucles d’oreilles offertes par Jacques Dumesnil ont causé ses deux grands moments de chagrin et de peine « quand je les ai reçues et quand je les redonne », j’ai le cœur serré.
Pour rester dans le cinéma français, j’ai envie de parler de deux films que tout paraît séparer, opposer : LE BLÉ EN HERBE de Claude Autant-Lara et D’AMOUR ET D’EAU FRAICHE d’Isabelle Czajka.
 Le premier est une adaptation assez raide de Colette (la mise en scène est moins gracieuse que dans CHIFFON), plombée par l’interprétation d’Edwige Feuillère, congelée dans le style grande Dame du cinéma français et de Pierre-Michel Beck, catastrophique (même si plusieurs silhouettes sont assez réussies, en particulier le forain projectionniste campé par de Funès, dont le pianiste est Claude Berri).Le second est une chronique moderne de l’errance d’une jeune fille.
Le premier est une adaptation assez raide de Colette (la mise en scène est moins gracieuse que dans CHIFFON), plombée par l’interprétation d’Edwige Feuillère, congelée dans le style grande Dame du cinéma français et de Pierre-Michel Beck, catastrophique (même si plusieurs silhouettes sont assez réussies, en particulier le forain projectionniste campé par de Funès, dont le pianiste est Claude Berri).Le second est une chronique moderne de l’errance d’une jeune fille.
 Deux jeunes actrices unissent ces deux œuvres si dissemblables : Nicole Berger et Anaïs Demoustier. Toutes deux sont éblouissantes de justesse, de grâce, d’intelligence. Dès qu’elles sont là, la vie fait irruption, s’empare de l’écran même s’il y d’autres acteur talentueux et bons dans D’AMOUR ET D’EAU FRAICHE. Nicole Berger fut un météore, disparue trop jeune. Elle est la justesse, la vérité même et son interprétation fait exploser les cadres rigides de Lara et démodent plusieurs de ses partenaires (pas Renée Devillers). Elle amène une vraie fraicheur et l’on ressent ses espoirs, son amour, ses souffrances et son personnage ne prend pas une ride. C’est par là qu’elle tend la main, qu’elle retrouve Anaïs Demoustier qui elle aussi, plonge au plus profond des émotions de son personnage sans jamais tricher avec ses zones d’ombre, ses faiblesses, ses tâtonnements, ses écorchures. C’est l’émotion en mouvement. Elle entraîne le film dans son sillage.
Deux jeunes actrices unissent ces deux œuvres si dissemblables : Nicole Berger et Anaïs Demoustier. Toutes deux sont éblouissantes de justesse, de grâce, d’intelligence. Dès qu’elles sont là, la vie fait irruption, s’empare de l’écran même s’il y d’autres acteur talentueux et bons dans D’AMOUR ET D’EAU FRAICHE. Nicole Berger fut un météore, disparue trop jeune. Elle est la justesse, la vérité même et son interprétation fait exploser les cadres rigides de Lara et démodent plusieurs de ses partenaires (pas Renée Devillers). Elle amène une vraie fraicheur et l’on ressent ses espoirs, son amour, ses souffrances et son personnage ne prend pas une ride. C’est par là qu’elle tend la main, qu’elle retrouve Anaïs Demoustier qui elle aussi, plonge au plus profond des émotions de son personnage sans jamais tricher avec ses zones d’ombre, ses faiblesses, ses tâtonnements, ses écorchures. C’est l’émotion en mouvement. Elle entraîne le film dans son sillage.
Ajoutons qu’il faut porter au crédit d’Autant-Lara qu’il réutilisa Nicole Berger, magnifique dans EN CAS DE MALHEUR (et aussi dans TIREZ SUR LE PIANISTE. Je ne m’en souviens pas dans les Dragueurs), où Edwige Feuillère était bien meilleure. Et qu’il est intéressant de découvrir dans les bonus les controverses, les remous que suscita le BLÉ EN HERBE qui traitait pourtant des rapports sexuels entre un jeune homme et une femme plus âgée avec pudeur, sans complaisance ni voyeurisme. L’évêque de Caen lança même contre les spectateurs de la première un commando de judokas catholiques (sic) qui furent mis en déroute par ceux-ci.
 Changeons de registre, de ton avec TOUCHEZ PAS A LA HACHE de Jacques Rivette, adaptation épurée, exigeante, janséniste, retenue de la Duchesse de Langeais de Balzac, déjà portée à l’écran par Baroncelli et Jean Giraudoux. C’est une œuvre tendue, fascinante, toujours centrée sur l’essentiel (les personnages secondaires sont réduits au minimum encore que Nicolas Bouchaud soit assez marquant).
Changeons de registre, de ton avec TOUCHEZ PAS A LA HACHE de Jacques Rivette, adaptation épurée, exigeante, janséniste, retenue de la Duchesse de Langeais de Balzac, déjà portée à l’écran par Baroncelli et Jean Giraudoux. C’est une œuvre tendue, fascinante, toujours centrée sur l’essentiel (les personnages secondaires sont réduits au minimum encore que Nicolas Bouchaud soit assez marquant).
Dans des pièces vides où l’on peut voir parfois au cours d’une fête, quelques vagues silhouettes, Antoinette de Langeais, Jeanne Balibar touchante, et le général de Montriveau se livrent une bataille sans merci, alternant les déclarations, les refus, les atermoiements, les élans et les revirements sous l’œil scrutateur de la Princesse de Blamont et du Vidame de Pamiers, incarnés magistralement par Bulle Ogier et Michel Piccoli. Quand ils sont là, plus besoin de figurants ; ils remplissent les appartements, les pièces, occupent l’espace. Guillaume Depardieu est admirable en général amoureux, possédé par cette passion qui le dévore et son claudiquement augmente encore le tragique du personnage
Il était aussi magnifique aux côtés de la magnifique Judith Chemla, dans VERSAILLES le premier film de Pierre Schoeller qui vient de tourner le remarquable L’EXERCICE DE L’ÉTAT et il est bon de rappeler ce film.
Pour finir, j’ai ressenti un grand plaisir devant le nouveau film de Julie Delpy THE SKYLAB (qui n’est pas encore en vidéo il est vrai). Un plaisir et aussi de la fierté. C’est que j’ai connu Julie si jeune quand elle jouait le rôle-titre de LA PASSION BEATRICE, son premier film avec MAUVAIS SANG de Leos Carax. Et j’ai vu, au fil des années, cette comédienne habitée, brillante, dingo, hypocondriaque et courageuse, qui domptait ses peurs et ne cédait jamais devant Bernard Pierre Donnadieu.
Je l’ai vu devenir scénariste (elle co-écrit le délicieux BEFORE SUNSET, cette déambulation rohmerienne), chanteuse avec un fort bon disque, compositrice (elle écrivit la musique de son second film), puis réalisatrice. Nous avions couronné à la SACD le très savoureux TWO DAYS IN PARIS, exploration savoureuse des différences culturelles, sexuelles, alimentaires entre les français et les américains (Ah la scène du lapin !). LA COMTESSE, œuvre brave, féministe, était plus didactique, plus inégale, faute de moyens mais je lui tire mon chapeau devant la manière dont elle sut utiliser les quelques figurants et les deux ou trois chevaux qu’on lui avait octroyé.
Lire la suite »

 LE CYGNE (pas terrible) et THÉ ET SYMPATHIE de Minnelli (bien meilleur) sont diffusés en 4/3 alors que sur Warner Archives US, il s’agit des 2.35, 16/9 remastérisés. Comme l’écrit un internaute : « Si vous voulez que cette collection soit pérenne même à un prix élevé, merci de fournir des masters corrects sachant qu’en plus, ils existent. Merci également de fournir les bonnes informations aux cinéphiles qui prennent le risque de commander vos produits ».
LE CYGNE (pas terrible) et THÉ ET SYMPATHIE de Minnelli (bien meilleur) sont diffusés en 4/3 alors que sur Warner Archives US, il s’agit des 2.35, 16/9 remastérisés. Comme l’écrit un internaute : « Si vous voulez que cette collection soit pérenne même à un prix élevé, merci de fournir des masters corrects sachant qu’en plus, ils existent. Merci également de fournir les bonnes informations aux cinéphiles qui prennent le risque de commander vos produits ». Je reviens sur quelques titres, revus avec plaisir : L’INEVITABLE MONSIEUR DUBOIS de Pierre Billon (comédie à l’américaine vraiment amusante et rythmée, avec une Annie Ducaux inattendue) ; J’ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE (Edwige Feuillère est parfaite dans le rôle de comédie qui la dégèle quelque peu) ; TONI (dont j’ai déjà parlé, un des meilleurs Renoir) ; L’ALIBI (un policier talentueux de Pierre Chenal avec un Stroheim étonnamment sobre, un Jouvet retenu. La fin, hélas, fut imposé par le producteur) ; SIGNÉ ARSENE LUPIN (l’un des premiers scénarios de Jean-Paul Rappeneau, astucieux, inventif. Yves Robert, Jacques Dufilho sont irrésistibles : il faut entendre ce dernier dire : « Monsieur donne trop ». Robert Lamoureux ne s’en sort pas mal du tout. Ce n’est pas indigne du Becker.) ; SANS LENDEMAIN, UN PAPILLON SUR L’ÉPAULE (l’un des Deray les plus personnels) ; LES ABYSSES ; ALLEMAGNE ANNÉE ZERO (un Rossellini majeur) ; LA VERITÉ SUR BÉBÉ DONGE (un chef d’œuvre) ; LE DERNIER DES 6 (que j’avais trouvé brillant) ; ANTOINE ET ANTOINETTE (un très bon Becker). Je dois revoir MOLLENARD, un Siodmak très fort, très âpre, SANS LENDEMAIN.
Je reviens sur quelques titres, revus avec plaisir : L’INEVITABLE MONSIEUR DUBOIS de Pierre Billon (comédie à l’américaine vraiment amusante et rythmée, avec une Annie Ducaux inattendue) ; J’ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE (Edwige Feuillère est parfaite dans le rôle de comédie qui la dégèle quelque peu) ; TONI (dont j’ai déjà parlé, un des meilleurs Renoir) ; L’ALIBI (un policier talentueux de Pierre Chenal avec un Stroheim étonnamment sobre, un Jouvet retenu. La fin, hélas, fut imposé par le producteur) ; SIGNÉ ARSENE LUPIN (l’un des premiers scénarios de Jean-Paul Rappeneau, astucieux, inventif. Yves Robert, Jacques Dufilho sont irrésistibles : il faut entendre ce dernier dire : « Monsieur donne trop ». Robert Lamoureux ne s’en sort pas mal du tout. Ce n’est pas indigne du Becker.) ; SANS LENDEMAIN, UN PAPILLON SUR L’ÉPAULE (l’un des Deray les plus personnels) ; LES ABYSSES ; ALLEMAGNE ANNÉE ZERO (un Rossellini majeur) ; LA VERITÉ SUR BÉBÉ DONGE (un chef d’œuvre) ; LE DERNIER DES 6 (que j’avais trouvé brillant) ; ANTOINE ET ANTOINETTE (un très bon Becker). Je dois revoir MOLLENARD, un Siodmak très fort, très âpre, SANS LENDEMAIN. Et SOUS LE SIGNE DU TAUREAU de Gilles Grangier que j’hésitais à voir (vu les autres Grangier de l’époque et qui fut une découverte et une très plaisante surprise). Au début, il faut passer outre une certaine esthétique qui prédomine dans les derniers Alain Poire : photo vraiment plate de Walter Wottiz où tout est trop éclairé, décors typique Vème République (cela constitue presque un constat). Le sujet (François Boyer, Grangier, Audiard) intrigue et petit à petit se dégage une amertume (les rapports avec Susanne Flon), une colère qui vont grandissantes. Le rapport de Gabin à son métier est écrit sans fioritures, sans acrobaties verbales. La scène avec le génial Alfred Adam est du meilleur Audiard : la description de la manière dont on pouvait s’enrichir sous l’Occupation est savoureuse. Mais surprise, il dépasse le constat bienveillant et oppose à Adam, un Gabin sobre dont une réplique au moins parait très autobiographique : « et toi qu’est-ce que tu faisais ? » – » Moi, j’étais sur les plages ».
Et SOUS LE SIGNE DU TAUREAU de Gilles Grangier que j’hésitais à voir (vu les autres Grangier de l’époque et qui fut une découverte et une très plaisante surprise). Au début, il faut passer outre une certaine esthétique qui prédomine dans les derniers Alain Poire : photo vraiment plate de Walter Wottiz où tout est trop éclairé, décors typique Vème République (cela constitue presque un constat). Le sujet (François Boyer, Grangier, Audiard) intrigue et petit à petit se dégage une amertume (les rapports avec Susanne Flon), une colère qui vont grandissantes. Le rapport de Gabin à son métier est écrit sans fioritures, sans acrobaties verbales. La scène avec le génial Alfred Adam est du meilleur Audiard : la description de la manière dont on pouvait s’enrichir sous l’Occupation est savoureuse. Mais surprise, il dépasse le constat bienveillant et oppose à Adam, un Gabin sobre dont une réplique au moins parait très autobiographique : « et toi qu’est-ce que tu faisais ? » – » Moi, j’étais sur les plages ».
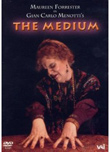 Je pense à REMPARTS D’ARGILE, de Jean-Louis Bertucelli, évoqué dans la première chronique ; au MEDIUM de Menotti, le seul opéra filmé, dirigé par son compositeur ; au magnifique PRIDE OF THE MARINES de Delmer Daves avec John Garfield, l’un des meilleurs films humanistes, démocratiques, tournés sur la seconde guerre mondiale. Sa scène de bataille, si originale, rivalise avec celle de MONKEY ON MY BACK d’André de Toth qui continue à passer inaperçue.
Je pense à REMPARTS D’ARGILE, de Jean-Louis Bertucelli, évoqué dans la première chronique ; au MEDIUM de Menotti, le seul opéra filmé, dirigé par son compositeur ; au magnifique PRIDE OF THE MARINES de Delmer Daves avec John Garfield, l’un des meilleurs films humanistes, démocratiques, tournés sur la seconde guerre mondiale. Sa scène de bataille, si originale, rivalise avec celle de MONKEY ON MY BACK d’André de Toth qui continue à passer inaperçue.