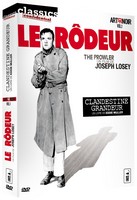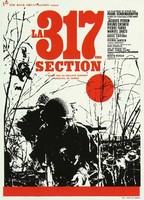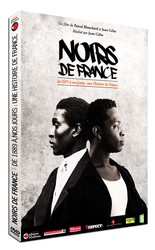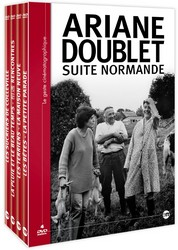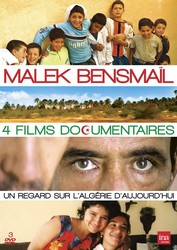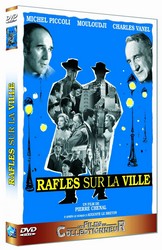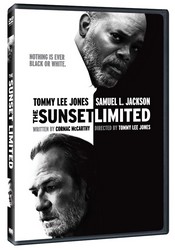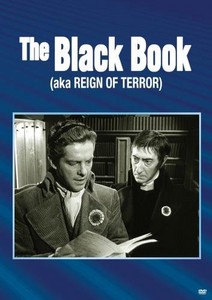Voici le texte publié sur le site de la SACD le 20 mars dernier en hommage à Pierre Schoendoerffer, disparu le 14 mars :
« Cela fait plusieurs jours que je reviens sur ce texte pour la SACD sur Pierre Schoendoerffer. Dès que j’écris une phrase, un paragraphe, malgré moi, ils passent à la première personne. Je n’arrive pas à garder le ton qui sied à un hommage objectif. Oui, bien sûr, je peux dire qu’on doit à Pierre Schoendoerffer une série de films remarquables, uniques, au ton si personnel. Des films qui s’interpellent les uns les autres, se répondent, se complètent, qui occupent une place à part dans le cinéma français. Pierre, tu étais en marge de tout. On ne te rattacha pas à la Nouvelle Vague bien que la photo de Raoul Coutard pour LA 317ème SECTION soit aussi innovatrice, révolutionnaire que celle d’A BOUT DE SOUFFLE (et que dire de celle du CRABE TAMBOUR, de ces fabuleux plans de mer) ni à ses adversaires qui appréhendaient tes chroniques de Grandeur et Servitudes militaires. Tu ne faisais partie d’aucun clan, d’aucune clique. Surtout politique. Tu m’as si souvent répété que l’homme politique pour qui tu avais le plus d’estime était Pierre Mendès France.
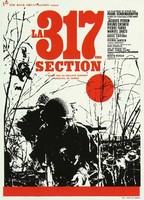

Revoir LA 317ème SECTION au festival de Lyon fut un très grand moment. C’est un chef d’œuvre que je mets sur le même plan que LES FORÇATS DE LA GLOIRE de Wellman et LES FEUX DANS LA PLAINE de Kon Ichikawa. Tu te souviens, Pierre, tu me parlais sans cesse de ce terrible film japonais quand je préparais le dossier de presse de LA 317ème SECTION, quand je me demandais comment contourner les préjugés d’une certaine critique, persuadée de l’idéologie d’un film qui ne pouvait selon elle être que colonialiste et militariste. Dans un article sublime de l’Observateur, Michel Cournot avait anéanti à tout jamais ces fadaises. Il parlait du son du film, de la manière dont était filmée la jungle, la Nature : « Ce film a été fait cent fois, avec une autre section décimée dans une autre guerre. Il est presque une spécialité des cinéastes américains. Pourquoi celui-ci est-il un chef-d’oeuvre ? D’abord, parce qu’il est vrai. Tous les gestes sont vrais. Tous les mots sont vrais. Tous les regards, toutes les voix, tous les bruits sont vrais. C’est le premier film de guerre vrai… Chaque détail se trouvait à sa place, dans sa lumière, dans son élan… La mémoire n’est pas une faculté donnée à tout le monde. La mémoire du réel est rare. Aussi rare d’ailleurs que la perception. Un homme a su dévisager la guerre, il a su l’écouter, et elle est là… LA 317ème SECTION est d’autre part un chef-d’oeuvre, parce que la guerre n’y est pas, comme d’habitude, démontrée ou présentée. Elle n’est pas apportée sur un plateau d’argent. Elle n’est pas soulignée, indiquée. Elle n’est pas non plus espionnée, vue de dos, comme dans les bandes d’actualités de guerre. Elle n’est pas cadrée. »
Relire ce texte (que l’on pourrait appliquer aux scènes batailles de DIEN BIEN PHU) fait remonter tant d’émotion. J’ai assisté au retour de Pierre, malade, miné par le palu. Il était aussi amaigri que Jacques Perrin, aussi épuisé que les personnages du film. J’ai suivi le montage, j’ai vu naître ce chef d’œuvre, la belle musique de Pierre Janssen et j’ai su que le lieutenant Torrens et l’adjudant Willsdorff faisaient partie de ma vie. Pierre m’a demandé de faire la bande annonce, d’en écrire le texte qui est dit par son monteur, mon futur monteur, le merveilleux Armand Psenny.
Et on ne s’est plus quitté.



J’adorais Pierre Schoendoerffer. J’aimais sa franchise, sa loyauté, sa fidélité. Je me suis battu pour OBJECTIF 500 MILLIONS, œuvre sous-estimée qu’il faudrait redécouvrir (avec à coté du formidable Cremer, un acteur génial, Jean-Claude Rolland) et qui fait partie de ces films de casses exécutés par les militaires entre LA MAISON DE BAMBOU et, version plus rose, THE LEAGUE OF GENTLEMEN. J’ai suivi toute l’épopée du CRABE TAMBOUR à travers aussi les récits de Jean Rochefort et de Claude Rich. J’ai adoré LA SECTION ANDERSON, ce très beau documentaire sur un groupe d’Américains durant la guerre du Vietnam. Tu te souviens, Pierre, de ce dîner avec Howard Hawks, grand admirateur du documentaire, qui voulait te demander de faire toute la seconde équipe, tout ce qui se passait au Vietnam, dans le film qu’il préparait. Je te revois, médusé en l’entendant décrire certaines scènes, essayant de lui expliquer qu’il n’y avait pas de camps de prisonniers (tu parlais en connaissance de cause, toi qui a été prisonnier du Vietminh), ni d’éléphants au Vietnam. Je revois ta tête quand il déclara que le conseiller militaire serait le général Westmoreland que tu ne portais pas dans ton cœur. Et cet autre dîner avec John Milius, le coscénariste d’APOCALYPSE NOW, qui était venu à Paris, à ses frais, pour adapter (pour toi au début) ton beau roman, L’ADIEU AU ROI, si conradien, tant il l’adorait. Il m’avait demandé d’organiser un rendez-vous, t’avait pris en moto et vous vous étiez cassé la gueule près du restaurant. Repas chaleureux, arrosé et inoubliable.
Il y a donc tous ces souvenirs et tant d’autres. Il y a ces films que je vais revoir comme L’HONNEUR D’UN CAPITAINE. Il y a LÀ-HAUT, film fragile, de fêlures et de mélancolie avec un personnage de femme dans un rôle moteur et qui m’avait beaucoup touché par tout ce qu’il disait en creux. Et cette magnifique adaptation de TYPHON de Conrad que Harvey Keitel voulait tant jouer. J’ai essayé de te donner un coup de main, après Daniel Toscan du Plantier mais nous avons échoué. Enorme regret. Quelle belle adaptation tu avais écrite. Et cet hommage à Conrad constituait la vraie clé pour comprendre, apprécier ton œuvre.
Tout cela est tellement fort, tellement vivant que je ne parviens pas à accepter ta disparition, à écrire ce texte au passé. Tu es comme le Crabe Tambour et Willsdorff : tu survis à tout et je t’imagine quelque part entre la brousse et ta chère Bretagne, dialoguer avec Wellman et Fuller et Roman Karmen, ce cinéaste russe que tu avais rencontré au Vietnam. Et éclater de rire en parlant de l’enfer, du diable, en inventant une kyrielle de proverbes et de dictons tout en refaisant sur une carte avec Lucien Bodard et Edouard Behr les derniers combats de la guerre du Vietnam. »
Pour oublier cette disparition qui s’ajoute à celle de Michel Duchaussoy que j’avais dirigé dans LA VIE ET RIEN D’AUTRE où il était formidable (« Alors Dellaplane, toujours dreyfusard ? « ) et que je viens de voir royal en Mitterrand usé, matois, roublard dans l’AFFAIRE GORDJI du talentueux Guillaume Nicloux (revoyez UNE AFFAIRE PRIVÉE et CETTE FEMME-LÀ), je voudrais signaler quelques beaux film. Et tout d’abord des documentaires, genre que pratiqua Pierre Schoendoerffer.
DOCUMENTAIRES
 A l’occasion de la sortie du poignant VOL SPÉCIAL de Fernand Melgar, j’écrivais :
A l’occasion de la sortie du poignant VOL SPÉCIAL de Fernand Melgar, j’écrivais :
» Commençons par le scandale puisque scandale il y a eu. Lors d’une conférence de presse qui suivait le palmarès, au festival de Locarno, le producteur Paolo Branco traita VOL SPÉCIAL d’œuvre fasciste. La raison de ce qualificatif ? Elle est très simple pour Branco. A aucun moment, selon lui, Fernand Melgar ne juge, ne questionne les gardiens du Centre de rétention, qui s’occupent de tous ces étrangers en voie d’expulsion, sur le bien fondé de leur travail. Il ne les pointe pas du doigt, ne leur accole aucune épithète et ne les dénonce pas.
Comme le note Edouard Waintrop : « Et vlan!
C’est ainsi que ce film excellent, disons le tout de go, et absolument pas fasciste, a été labellisé par un homme que l’on a connu plus fin analyste… »
Oublions donc la polémique et regardons le film. Qui est remarquable. Il est vrai que comparé aux descriptions qu’a donné la Cimade des centres de rétention en France et du traitement qu’on inflige à tous ceux qui y sont détenus, l’institution que décrit Melgar, sans un mot de commentaire, a l’air d’un cinq étoiles. Personnel attentif, compatissant, humain, nourriture abondante, cuisinée par les futurs expulsés, propreté et hygiène des lieux, possibilité de faire un peu de sport dans des enclos grillagés. C’est vrai qu’on a des leçons à prendre.
Mais au delà de la premières impression, un malaise insidieux s’installe. Tout d’abord, contrairement aux grévistes de la faim que j’ai filmés dans HISTOIRES DE VIES BRISÉES, plusieurs, parmi ces étrangers ne semblent pas avoir commis de délit, de crime… Ici, on les expulse « simplement » (si j’ose dire) pour des raisons administratives plus ou moins obscures ou oiseuses, parce qu’ils sont sans-papiers. Et ces prisonniers dont beaucoup travaillent ou vont obtenir un emploi et qui refusent l’expulsion, attendent le vol spécial qui doit les déporter. On les découvre peu à peu, on découvre leur histoire, leur vie, leur personnalité. On rentre en empathie avec eux.
Et peu à peu le décor s’impose, prend toute sa forces. Ces couloirs grillagés où déambulent les détenus comme des rats de laboratoires. Ces portes qu’on ferme à clef. Cet univers qui devient de plus en plus oppressant et que Melgar filme sans jamais le dramatiser, souvent en plan large, sans ajouter le moindre commentaire musical (on entend juste les chansons que jouent les prisonniers ou qu’ils écoutent). On a toujours l’impression d’être au milieu des personnages, avec eux, à leur écoute. On apprend leurs histoires complexes, douloureuses. La caméra ne les juge pas, ne leur donne pas de leçon, les laisse vivre.
La manière dont ils refusent cette expulsion, dont ils se heurtent à une administration polie, certes, mais totalement, froidement indifférente, abstraite, vous serre le coeur. La confrontation avec une juge qui ne veut (ne peut ?) rien entendre, rien comprendre, est un moment glaçant, terrible dans son indifférence désincarnée. Et encore plus ce dialogue avec un fonctionnaire qui se contente de détailler la procédure, de se réfugier derrière elle, qui répond article de loi quand on parle d’humanité. Il pourrait au moins refuser de faire ce travail. Non, il l’accomplit, tranquillement, doucement, sans sadisme apparent. On se dit que c’est ainsi que de braves douaniers ou policiers ont du refuser à des juifs de pouvoir se réfugier en Suisse. Avec la même politesse.
Et le découpage de ces deux séquences est exemplaire. Les cadres, précis, n’étouffent pas les personnages, ne surlignent pas les intentions, ne contiennent aucun élément de jugement. On évite les très gros plans, toutes les figures de style qui révéleraient les partis pris de l’auteur. La distance semble ici toujours juste.
Eh bien, on retrouve ces mêmes qualités dans LA FORTERESSE qui vient de sortir en DVD chez Blaq Out. Le sujet, abordé par Melgar, tourne une fois encore autour de l’immigration. Les personnes qui vivent dans ce « centre » attendent un permis de séjour et se heurtent à la même attitude, au même mélange d’attention et de respect strict des articles de loi, des codes de vraisemblance (on renvoie un Ethiopien malgré ses blessures car son récit ne paraît pas vraisemblable à quelqu’un qui ignore que des gens ont pu marcher des jours avec une jambe mutilée). Même absence de commentaire et de musique.

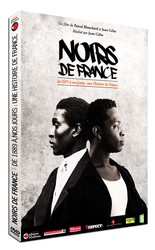
La série NOIRS DE FRANCE de Juan Gelas est tout à fait passionnante et devrait être utilisée dans les écoles et les collèges.
Je voudrais signaler le coffret consacré aux documentaires d’Ariane Doublet (j’avais vu deux films en salle qui m’avaient impressionné). Voilà quelqu’un qui sait filmer les paysans, les ouvriers. Et celui consacré aux films de Malek Bensmail qui met à jour de manière aigüe les contradictions, les déchirures, les ombres qui hantent l’Algérie actuelle.
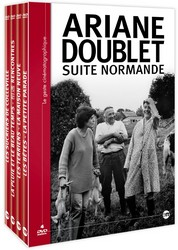
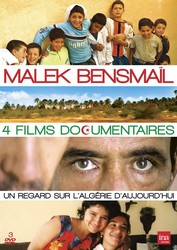
On parle si peu des musiciens de film que je ne peux que saluer cette collection qui nous propose des documentaires sur Gabriel Yared, Georges Delerue, Maurice Jarre. On y aperçoit évidemment l’indispensable Stéphane Lerouge qui joua, enfant, du tuba chez Jacques Hélian.
FICTIONS
D’UN PAYS L’AUTRE
Il faut saluer les éditeurs courageux, passionnés qui viennent de nous offrir un Blu-ray somptueux du magnifique, envoutant IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANATOLIE de Nuri Bilge Ceylan et de L’ASSOIFFÉ du grand Guru Dutt, cinéaste admirable et méconnu.


Et je redis une fois de plus toute l’admiration que j’éprouve pour la magnifique trilogie d’Alex Corti, WELCOME IN VIENNA écrite de manière très autobiographique par Georg Stefan Troller et qui raconte l’odyssée de quelques jeunes autrichiens entre la Nuit de Cristal de 38 et le retour dans leur patrie soi-disant dénazifiée.
FRANCE/AMÉRIQUE
 Passons au cinéma français pour dire tout le bien qu’il faut penser de la réédition par Studio Canal et Carlotta de LA GRANDE ILLUSION dans une sublime copie. J’en ai revu une heure et le début, la première scène, m’a bouleversé : Gabin qui fredonne et qui vous rend immédiatement perceptible son personnage, sa situation sociale, son rapport au groupe, la manière dont il a apprivoisé la situation. Rendre tout cela sans l’exprimer ni le dire, c’est du grand art. Je m’attarde sur cette scène, en apparence moins brillante, que les affrontements avec Stroheim, car je la trouve typique du génie de Renoir.
Passons au cinéma français pour dire tout le bien qu’il faut penser de la réédition par Studio Canal et Carlotta de LA GRANDE ILLUSION dans une sublime copie. J’en ai revu une heure et le début, la première scène, m’a bouleversé : Gabin qui fredonne et qui vous rend immédiatement perceptible son personnage, sa situation sociale, son rapport au groupe, la manière dont il a apprivoisé la situation. Rendre tout cela sans l’exprimer ni le dire, c’est du grand art. Je m’attarde sur cette scène, en apparence moins brillante, que les affrontements avec Stroheim, car je la trouve typique du génie de Renoir.
LCJ a eu la très bonne idée de sortir enfin RAFLES SUR LA VILLE, un remarquable film noir de Pierre Chenal (cinéaste que j’aime beaucoup), avec une belle musique de jazz de Michel Legrand (sa deuxième musique de film). Chenal utilise Vanel à contre-emploi dans un rôle de salopard tortueux et sadique et il y est génial. Piccoli est impressionnant et c’est là que Godard le remarqua et le choisit pour LE MÉPRIS. Il y joue un anti-héros absolu, un flic qu’on pourrait voir chez Ferrara ou Tarantino. Malheureusement pas de bonus.
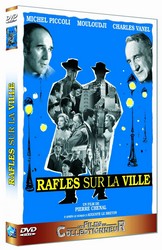

J’ai revu avec un certain plaisir LE JOUR ET L’HEURE de René Clément. Le sujet et la forme peuvent paraître classiques mais Clément utilise diablement bien le décor (ces appartements où se terre Stuart Whitman dans son meilleur rôle avec RIO CONCHOS), l’espace, les extérieurs, dirige de manière serrée Simone Signoret. Et la scène du train reste un morceau de bravoure inoubliable.
 Carlotta a eu la géniale idée de sortir enfin PORTRAIT D’UNE ENFANT DÉCHUE, le premier chef d’œuvre de Jerry Schatzberg, bouleversante dissection au scalpel (mais avec quelle compassion, quelle tendresse) des sentiments, des tourments de ce mannequin, l’un des plus grands rôles de Faye Dunaway. Elle s’y montre fragile, capricieuse, blessée, irresponsable, enfantine, narcissique, en proie au mal d’aimer. Ce film fut littéralement sauvé de l’oubli qui le menaçait (la critique américaine avait été sotte et atroce) par Pierre Rissient et je n’oublierai jamais le choc ressenti lors de la première projection à la Paramount, à Paris, quand il fallait arracher une sortie française.
Carlotta a eu la géniale idée de sortir enfin PORTRAIT D’UNE ENFANT DÉCHUE, le premier chef d’œuvre de Jerry Schatzberg, bouleversante dissection au scalpel (mais avec quelle compassion, quelle tendresse) des sentiments, des tourments de ce mannequin, l’un des plus grands rôles de Faye Dunaway. Elle s’y montre fragile, capricieuse, blessée, irresponsable, enfantine, narcissique, en proie au mal d’aimer. Ce film fut littéralement sauvé de l’oubli qui le menaçait (la critique américaine avait été sotte et atroce) par Pierre Rissient et je n’oublierai jamais le choc ressenti lors de la première projection à la Paramount, à Paris, quand il fallait arracher une sortie française.
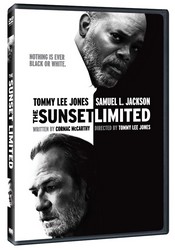 Un petit saut dans le temps. En zone 1, vient de sortir SUNSET LIMITED, produit et réalisé par Tommy Lee Jones. Il s’agit de l’adaptation fidèle d’une pièce de Cormac McCarthy. A plusieurs reprises durant DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE, Tommy Lee Jones m’avait parlé avec admiration de cet écrivain qu’il adorait, avec qui il était lié. Il avait voulu adapter MÉRIDIEN DE SANG. Il a donc demandé à Cormac McCarthy d’adapter sa pièce et on le voit, dans les bonus, très présent durant le tournage, discutant sur des nuances du dialogue avec les acteurs. L’action se déroule presque entièrement dans une pièce, décor astucieusement construit par Merideth Boswell qui donne une grande importance à la porte (ultra-barricadée) et à la fenêtre, à ce qu’on devine au-delà. Il n’y a que deux personnages et les acteurs, Tommy Lee (professeur de philo en proie à des désirs suicidaires) et Samuel Jackson (ancien taulard devenu prédicateur), se délectent des moindres nuances d’un texte tendu, souvent drôle, cocasse. Ils s’affrontent pour savoir si la Bible est le meilleur livre du monde (et sinon quels sont les autres) et dans un moment mémorable, sur le fait de prononcer le mot nègre quand on parle des détenus ultra-dangereux dans un établissement pénitentiaire. Le professeur interrompt le récit que fait le taulard en lui disant que le terme est insultant et l’autre, qui était en train de décrire comment il avait lardé de coups de surin, rentre dans une rage folle. On a vraiment affaire à deux poids lourds, deux monstres sacrés, au sommet de leur forme, qui prennent un immense plaisir à jouer ensemble, à respecter le texte et Tommy Lee Jones metteur en scène partage la même ferveur. Son travail est simple, jamais intrusif, clair, dépouillé. J’ai appris incidemment que Nicolas Saada avait voulu monter la pièce en France.
Un petit saut dans le temps. En zone 1, vient de sortir SUNSET LIMITED, produit et réalisé par Tommy Lee Jones. Il s’agit de l’adaptation fidèle d’une pièce de Cormac McCarthy. A plusieurs reprises durant DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE, Tommy Lee Jones m’avait parlé avec admiration de cet écrivain qu’il adorait, avec qui il était lié. Il avait voulu adapter MÉRIDIEN DE SANG. Il a donc demandé à Cormac McCarthy d’adapter sa pièce et on le voit, dans les bonus, très présent durant le tournage, discutant sur des nuances du dialogue avec les acteurs. L’action se déroule presque entièrement dans une pièce, décor astucieusement construit par Merideth Boswell qui donne une grande importance à la porte (ultra-barricadée) et à la fenêtre, à ce qu’on devine au-delà. Il n’y a que deux personnages et les acteurs, Tommy Lee (professeur de philo en proie à des désirs suicidaires) et Samuel Jackson (ancien taulard devenu prédicateur), se délectent des moindres nuances d’un texte tendu, souvent drôle, cocasse. Ils s’affrontent pour savoir si la Bible est le meilleur livre du monde (et sinon quels sont les autres) et dans un moment mémorable, sur le fait de prononcer le mot nègre quand on parle des détenus ultra-dangereux dans un établissement pénitentiaire. Le professeur interrompt le récit que fait le taulard en lui disant que le terme est insultant et l’autre, qui était en train de décrire comment il avait lardé de coups de surin, rentre dans une rage folle. On a vraiment affaire à deux poids lourds, deux monstres sacrés, au sommet de leur forme, qui prennent un immense plaisir à jouer ensemble, à respecter le texte et Tommy Lee Jones metteur en scène partage la même ferveur. Son travail est simple, jamais intrusif, clair, dépouillé. J’ai appris incidemment que Nicolas Saada avait voulu monter la pièce en France.
Lequel Nicolas Saada vient de m’envoyer le test comparatif entre la version VCI de REIGN OF TERROR, ce chef d’œuvre d’Anthony Mann et celle que vient de sortir Columbia sous le titre THE BLACK BOOK :
THE BLACK BOOK versus REIGN OF TERROR
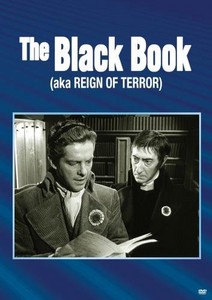

Who says this blog is afraid to answer the tough questions, to boldly tackle the really burning issues of the day ?
To wit : Given that VCI Entertainment issued a not-all-that bad DVD version of Anthony Mann’s delightful French Revolution pop-noir 1948 Reign of Terror AKA The Black Book, is the new version of the Mann film recently released by the burn-on-demand Sony subsidiary Columbia Classics worth a look, let alone an investment of 20 bucks or thereabouts?
Well, we’ve delved into the question and the answer is, HELL YEAH.
The relative enthusiasm with which the VCI release was met with back in 2008 was of course relative to the fact that prior video iterations of the film looked like sock puppet theater, on account of their being quasi-bootlegs of the title which had fallen into the slough of despond known as public domain. The VCI version was made from undeniably soft materials, but transferred with care. If the magnificent chiaroscuros concocted by Mann and his most crucial collaborator, cinematographer John Alton, were clearly not all that they could be, well, they were enough to extrapolate from. Given the state of affairs concerning the film’s provenance and such, DVD Beaver reviewers Gregory Meshman and Gary W. Tooze said of the release, « This may be as good as it gets. »
This was of course before the burn-on-demand DVD marketing scheme got going. My suspicion is that some cinephile at Sony knew that the studio had some very superior materials in the vault, and that the only way to get them released would be through just such a corporate sidebar as was pioneered by the Warner Archive. Alas, Jeanine Basinger’s otherwise quite thorough Mann biography doesn’t go into how Reign of Terror got its name changed to The Black Book, but I suspect it was retitled after the independent low-budget production was picked up for distribution by Columbia.
Lire la suite »
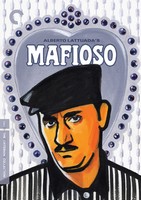 Changeons de continent et passons à l’Italie avec deux films qu’on peut qualifier d’extrêmement rares. Le premier MAFIOSO fait pourtant partie du catalogue de Studio Canal qui pour d’obscures raisons semble vouloir s’obstiner à ne pas le sortir, peut-être pour privilégier leur série MAFIOSA. Plus certainement parce qu’ils doivent penser que le cinéma italien n’est plus du tout à la mode et que ce film, un sommet pourtant, est totalement inconnu. Pourtant le film est archi-défendu par Martin Scorsese. Aux USA, en Zone 1, Criterion a sorti une splendide édition.
Changeons de continent et passons à l’Italie avec deux films qu’on peut qualifier d’extrêmement rares. Le premier MAFIOSO fait pourtant partie du catalogue de Studio Canal qui pour d’obscures raisons semble vouloir s’obstiner à ne pas le sortir, peut-être pour privilégier leur série MAFIOSA. Plus certainement parce qu’ils doivent penser que le cinéma italien n’est plus du tout à la mode et que ce film, un sommet pourtant, est totalement inconnu. Pourtant le film est archi-défendu par Martin Scorsese. Aux USA, en Zone 1, Criterion a sorti une splendide édition.