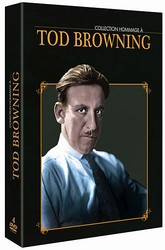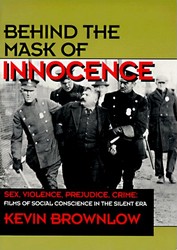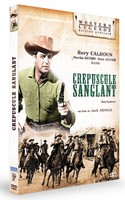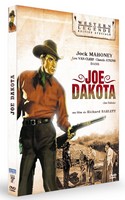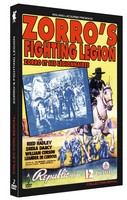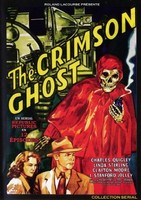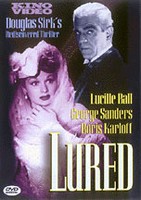FILMS MUETS
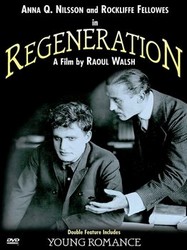 REGENERATION (1915 – Zone 1 couplé avec YOUNG ROMANCE comédie amusante écrite par William deMille sur deux jeunes employés travaillant dans la même boîte qui vont, à l’insu l’un de l’autre, se faire passer pour des aristocrates pendant une semaine. Charmant et un peu mécanique.)
REGENERATION (1915 – Zone 1 couplé avec YOUNG ROMANCE comédie amusante écrite par William deMille sur deux jeunes employés travaillant dans la même boîte qui vont, à l’insu l’un de l’autre, se faire passer pour des aristocrates pendant une semaine. Charmant et un peu mécanique.)
REGENERATION est le premier long métrage de Raoul Walsh, à 28 ans et son premier chef d’œuvre. Tourné la même année que NAISSANCE D’UNE NATION et tout aussi, sinon plus, révolutionnaire. Un chef d’œuvre qui innove dans bien des domaines et annonce les grands films de la Warner, entre autres. Le réalisme incroyable des extérieurs new-yorkais surprend encore aujourd’hui (Martin Scorsese disait qu’on les filmerait exactement de la même façon), tout autant que le choix des seconds rôles et des figurants (que Walsh alla recruter dans les bouges du Bowery), tous criants de vérité. Certains intérieurs renvoient à Frank Norris ou à Dickens.
Accessoirement, REGENERATION, est peut être aussi le premier film de gangsters de l’Histoire du cinéma et Walsh a déjà trouvé la pulsation rythmique qui fera la force de PURSUED ou de WHITE HEAT : il utilise un découpage très rapide, très sec, le montage parallèle, qu’il associe avec des gros plans, des plans très larges et des mouvements d’appareils. Ceux-ci, fait très rare, ne sont pas uniquement fonctionnels : dans une scène de repas, en se rapprochant du jeune Owen et en l’isolant, un travelling rapide nous fait sentir ce qu’il pense. Ils accentuent, dynamisent, par un mouvement contrarié, l’entrée d’Anna Nilsson dans le repaire du gangster, nous faisant ainsi partager son angoisse, son état d’urgence. Ils nous replacent à l’intérieur de l’histoire et des émotions qui la traversent. Walsh se sert aussi des mouvements circulaires des danseurs pour cacher, rendre plus chaotique une panique créée par un incendie, séquence brillamment dirigée mais à laquelle il confère trop d’importance dans ses Mémoires, omettant des trouvailles plus profondes.
Les premiers plans, incroyablement aigus et rapides, par exemple, sont encore plus innovateurs : le jeune héros est seul dans une pièce quasi-nue où l’on enlève un cercueil. On coupe sur un corbillard dans la rue et puis on voit le gamin aller à la fenêtre. Plan suivant, on voit ce qu’il regarde : le corbillard filmé de son point de vue, ce qui nous attache immédiatement à lui. C’est peut être le premier plan avec point de vue de l’Histoire du cinéma et il crée une grande émotion. Walsh fait d’ailleurs passer tout au long de ce film de gangsters une mélancolie romantique qu’on a souvent sous-estimée. Elle est magnifiquement traduite par la photo du français Georges Benoît qui éclaira les Walsh suivants et que Maurice Tourneur, qui admirait ses films, reprit pour AU NOM DE LA LOI et JUSTIN DE MARSEILLE (Benoît travailla aussi avec Guitry et Pagnol sur LA FEMME DU BOULANGER). Par l’interprétation si moderne de Rockliffe Fellowes qui préfigure le Brando de ON THE WATERFRONT et celle, délicate et sensible, de Anna Q. Nilsson. On regrette d’autant plus que des œuvres ultérieures du cinéaste comme CARMEN que vantait Maurice Tourneur, THE SERPENT, PEER GYNT, PILLARS OF SOCIETY, THE HONOUR SYSTEM, placé très haut par Ford, aient disparu.
THE MYSTERY OF THE LEAPING FISH (1916 – coffret Bach films consacré à Todd Browning. Zone 2)
Ce court métrage est un des films les plus bizarres de l’histoire du cinéma muet. Bizarre par son sujet : un détective, Coke Ennyday, se bat contre les trafiquants de drogue, lutte contre l’importation de cocaïne alors qu’il en consomme une quantité industrielle. Son horloge pointe quatre quartiers : sommeil, nourriture, boisson, drogue. Bizarre ensuite par le choix de Douglas Fairbanks dans un rôle inhabituel pour lui : dans sa première apparition, il dort dans une position extravagante et semble littéralement en extase dès qu’il s’injecte de l’opium ou de la coke à l’aide d’une des nombreuses seringues attachées à sa poitrine ou qui pendent à portée de main. C’est dans cet état d’ailleurs qu’il trouve les déguisements les plus farfelus. Fairbanks détestait tellement le film qu’il essaya de le faire retirer de la circulation. Pourtant, ce qui est un comble, il fut tourné deux fois, une fois par Christy Cabanne et puis entièrement refait par John Emerson (pourquoi pas Browning ?) et enregistré, le mot convient mieux que filmé, assez platement. Le résultat est plus curieux que vraiment dôle et c’est surtout son absence de toutes précautions moralisatrices qui laisse pantois. Par ailleurs, on y voit peut être la première télévision de l’Histoire du cinéma.
Bizarre parce que ce sujet, conçu par Todd Browning (titres d’Anita Loos et on dit que Griffith aurait collaboré au sujet), est traité de manière comique. Faire rire de l’addiction à une drogue dure semble très étrange aujourd’hui. Connaissait-on les effets de la cocaïne ? Il semble que oui puisque de nombreux films de 1916 recensés par Kevin Brownkow dans Behind the Mask of Innocence, dénoncent les ravages de la drogue dont THE DIVIDEND (Walter Edwards), THE DEVIL’S NEEDLE (Chester Whitey également scénariste), ROMANCE OF THE UNDERWORLD (James Kirkwood, 1918, le plus réaliste). Mais sur Internet des amateurs du film disent que la coke était supposée, dans la Californie des années 20, avoir des effets bénéfiques, que Browning et Fairbanks en consommaient et qu’1 malade sur 5 était un drogué. Sa partenaire est ici Bessie Love qui joua dans un autre film sur la drogue, HUMAN WRECKAGE.
THE WHISPERING CHORUS (soit en zone 2 avec Bach Films sous le titre LE RACHAT SUPRÊME, soit en zone 1 dans un DVD Image de meilleure qualité)
Ce chœur chuchotant est celui des voix qui nous soufflent de faire le bien ou le mal et qui, dans ce film, arrivent périodiquement sur l’écran grâce au miracle de la double exposition. L’originalité du procédé, d’ailleurs utilisé avec modération, renforce l’étrange et paradoxale cohésion de ce film, l’un des meilleurs DeMille dont on ne parvient pas à savoir s’il est réussi en dépit ou grâce à certaines conventions dramatiques. Comme Sidney Carton dans A TALE OF TWO CITIES, John Trimble (écrit Tremble dans la copie française), l’infortuné protagoniste, se sacrifie et se laisse exécuter (la chaise électrique remplace la guillotine), pour préserver sa femme. Trimble, employé de banque misérablement payé, accablé de dettes, avait détourné une somme d’argent puis, craignant d’être arrêté, avait fui et pris l’identité d’un mort dont il avait trouvé le cadavre. Après des années, on l’accuse du meurtre de ce dernier et il ne veut pas révéler sa véritable identité, sa femme s’étant remariée, risque d’être accusée de bigamie. Il choisit de mourir sur la chaise électrique.
Ce récit qui conjugue faute, rédemption, sacrifice, amour, notions chères à DeMille s’inspire, se nourrit même, de conventions héritées du théâtre de Mélodrames. Mais la mise en scène est purement cinématographique : réalisation sèche et rapide, découpage vif, inventif, audaces visuelles. La manière dont DeMille utilise tout le long des montages parallèles (le monde de la banque et le héros en fuite), notamment lors de l’ascension sociale de son ex-femme, paraît vraiment moderne. L’apparition subite du cadavre dans un lac serait à sa place dans un film noir des années 40. Et la fleur que garde le héros, symbole de son amour, paraît anticiper sur la rose de QUESTION DE VIE ET DE MORT. Certains défenseurs du film y ont même vu des résonnances brechtiennes, ce qui aurait tétanisé le cinéaste. Jeanie MacPherson, scénariste de presque tous les films de DeMille depuis 1916, signe le scénario d’après un roman de Perley Poore Sheehan. La copie restaurée par la George Eastman House est superbe.
Toujours DeMille avec APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS (en zone 2 chez Bach Films, en zone 1 sous le titre DON’T CHANGE YOUR HUSBAND), une de ces comédies matrimoniales dans lesquelles il excella à l’époque du muet. Ici, une épouse (Gloria Swanson bien sûr), lassée du peu d’intérêt que lui porte son mari (qui a la manie de manger des oignons, gag récurrent dans le film), le quitte, convole avec un autre homme et découvre qu’il est pire et de plus sordidement intéressé. Le ton est vif, léger, caustique, brillant. Il faut découvrir tous ces DeMille plus inventifs que ses films parlants. La traduction des intertitres français est fantaisiste : hun, qui signifie boche, est traduit par nazi, ce qui ferait de DeMille, en 1919, un cinéaste visionnaire.
DADDY-LONG-LEGS (1919, Bach Films)
 Le triomphe de ce film poussa, encouragea Mary Pickford à créer avec Douglas Fairbanks et Chaplin, une société de production indépendante, un mini-studio. Il faut dire que DADDY- LONG-LEGS semble taillé sur mesure pour exploiter toutes les facettes, toutes les qualités de la comédienne. Cette histoire d’orpheline littéralement jetée, bébé, dans une poubelle, recueillie dans un épouvantable orphelinat, permet à Mary Pickford de changer constamment de registre : elle est mutine, éplorée, farceuse même dans des moments dramatiques (elle essaie de faire rire des enfants malades), clownesque, révoltée : elle va voler une poupée pour la donner quelques secondes à une petite fille mourante. Les auteurs n’évitent pas toujours les effets trop mignons (le chien saoul). D’autant que Marshall Neilan lui oppose le destin d’une autre petite fille, riche, protégée, égoïste. Le choix de leurs deux prénoms donne lieu d’ailleurs à une fort bonne séquence.
Le triomphe de ce film poussa, encouragea Mary Pickford à créer avec Douglas Fairbanks et Chaplin, une société de production indépendante, un mini-studio. Il faut dire que DADDY- LONG-LEGS semble taillé sur mesure pour exploiter toutes les facettes, toutes les qualités de la comédienne. Cette histoire d’orpheline littéralement jetée, bébé, dans une poubelle, recueillie dans un épouvantable orphelinat, permet à Mary Pickford de changer constamment de registre : elle est mutine, éplorée, farceuse même dans des moments dramatiques (elle essaie de faire rire des enfants malades), clownesque, révoltée : elle va voler une poupée pour la donner quelques secondes à une petite fille mourante. Les auteurs n’évitent pas toujours les effets trop mignons (le chien saoul). D’autant que Marshall Neilan lui oppose le destin d’une autre petite fille, riche, protégée, égoïste. Le choix de leurs deux prénoms donne lieu d’ailleurs à une fort bonne séquence.
Dans la seconde partie du film, Judy devient collégienne, grâce à l’appui, la protection d’un homme plus âgé qui veut rester anonyme et se fait appeler John Smith. Elle ne l’entrevoit qu’en ombre chinoise et c’est là qu’elle lui trouve son surnom. Le jeu, l’allure de Mary Pickford change du tout au tout. Elle fait preuve d’une grâce, d’une délicatesse romantique, d’une retenue tout à fait moderne. Peu à peu, au collège, où elle fréquente une société beaucoup plus huppée (deux de ses condisciples, filles de milliardaires, pleurnichent sur leur sort dans la première séquence, fort amusante) elle découvre l’amour. Tous les décors de cette seconde partie sont très luxueux (les portes font le double ou le triple des personnages) et le film endosse deux thèmes majeurs américains : la volonté, la détermination, la prise en main de son destin et le philanthropisme. A noter que les principaux personnages sont tous assimilés visuellement à des fleurs ou des plantes : des cactus et de l’ail sauvage pour la directrice de l’orphelinat et son aide, une rose de serre pour la petite fille riche.
SPARROWS (DVD zone 2 chez Les Films du Paradoxe)
 Ceux qui ne connaissent que la dernière partie de la carrière de William Beaudine (surnommé « One Shot Beaudine ») qui comprend des titres aussi pittoresques que BELA LUGOSI MEETS A BROOKLYN GORILLA, BILLY THE KID VS DRACULA ou JESSE JAMES MEETS FRANKENSTEIN’S DAUGHTER éprouveront un choc devant la beauté visuelle, l’audace lyrique de SPARROWS, l’un des meilleurs Mary Pickford. C’est que Beaudine fut un metteur en scène très important pendant le muet, un des mieux payés à Hollywood. THE CANADIAN, par exemple, a une très bonne réputation et il travailla plusieurs fois avec Mary Pickford (LITTLE ANNIE ROONEY, autre film brillant) qui appréciait sa manière de diriger les enfants. Il fut ruiné par la crise de 29 et ne se releva jamais. On lui doit de multiples films de série Z, un western honorable pour Disney (WESTWARD HO, THE WAGONS !) et un film d’exploitation qui fit des recettes astronomiques, MOM AND DAD, sorti en France sous le titre LES FAUSSES PUDEURS.
Ceux qui ne connaissent que la dernière partie de la carrière de William Beaudine (surnommé « One Shot Beaudine ») qui comprend des titres aussi pittoresques que BELA LUGOSI MEETS A BROOKLYN GORILLA, BILLY THE KID VS DRACULA ou JESSE JAMES MEETS FRANKENSTEIN’S DAUGHTER éprouveront un choc devant la beauté visuelle, l’audace lyrique de SPARROWS, l’un des meilleurs Mary Pickford. C’est que Beaudine fut un metteur en scène très important pendant le muet, un des mieux payés à Hollywood. THE CANADIAN, par exemple, a une très bonne réputation et il travailla plusieurs fois avec Mary Pickford (LITTLE ANNIE ROONEY, autre film brillant) qui appréciait sa manière de diriger les enfants. Il fut ruiné par la crise de 29 et ne se releva jamais. On lui doit de multiples films de série Z, un western honorable pour Disney (WESTWARD HO, THE WAGONS !) et un film d’exploitation qui fit des recettes astronomiques, MOM AND DAD, sorti en France sous le titre LES FAUSSES PUDEURS.
SPARROWS est le dernier film où Pickford joue, à 34 ans, une adolescente. Il s’ouvre sur un intertitre mémorable : « La part du diable dans la création du Monde, consista en un certain marécage sudiste – un chef d’œuvre d’horreur et le Seigneur qui savait apprécier le travail bien fait, l’accepta ». La suite est du même tonneau : « Et ensuite, le Diable se surpassa et fit vivre, dans ce marécage, Mr Grimes ». Le plan d’introduction de Grimes, personnage monstrueux, dépourvu de toute conscience, qui semble sorti de Dickens, est magistral : on le voit boiter dans les marais avec des moustiques qui volent autour de son visage aux yeux morts. Il acquiert une poupée pour la donner à une des orphelines qui vivent dans sa ferme/prison mais sur le chemin, lui arrache la tête et la jetant dans des sables mouvants, la regarde lentement se faire engloutir. Gustav Von Seyffertiz en fait une figure inoubliable, une icône du mal. Il exploite des orphelins et des orphelines qu’il a kidnappés avec l’aide de sa femme et de son fils (belles compositions de Charlotte Mineau et Spec O’donnell qui viennent pourtant de la comédie) et retient prisonniers dans ces marécages infestés d’alligators et truffés de sables mouvants.
Cet univers digne de Jérôme Bosch est admirablement recréé par le décorateur Harry Oliver et magnifiquement éclairé par un trio de grands chefs opérateurs : Charles Roscher, Hal Mohr et Karl Struss notamment dans la séquence tendue, forte, très efficace, de la fuite nocturne des enfants qui semble anticiper, jusque dans certaines notations religieuses, sur le mélange d’horreur et de féérie qui faisait le prix de LA NUIT DU CHASSEUR. Le Christ vient enlever l’âme d’un enfant et l’effet est moins sulpicien qu’on pourrait s’y attendre. Ce conte gothique inspiré renvoie à toute une littérature sudiste, voire même à DÉLIVRANCE, traitant de la Rédemption à travers l’horreur. Plus discutable est le dernier quart d’heure qui se perd dans des péripéties accessoires et superficielles.
VICTORY (1919, zone 2, Bach Films)
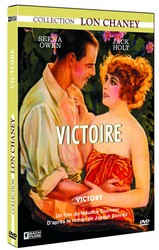 La seule adaptation filmique d’un de ses ouvrages que Joseph Conrad eut la possibilité de voir. Nul doute qu’il fut horrifié par la fin heureuse, qui arrive comme un cheveu sur la soupe et dont l’incongruité est soulignée par des intertitres d’une consternante solennité. Le scénario de Jules Furthman (sous le pseudonyme de Stephen Fox) reste encore prisonnier, tributaire des cartons beaucoup trop explicatifs. Il simplifie, théâtralise le livre (défaut encore accentué dans la version de William Wellman), le dépouille de sa métaphysique et transformant la seconde partie en une ébauche rapide de LA FORÊT PÉTRIFIÉE.
La seule adaptation filmique d’un de ses ouvrages que Joseph Conrad eut la possibilité de voir. Nul doute qu’il fut horrifié par la fin heureuse, qui arrive comme un cheveu sur la soupe et dont l’incongruité est soulignée par des intertitres d’une consternante solennité. Le scénario de Jules Furthman (sous le pseudonyme de Stephen Fox) reste encore prisonnier, tributaire des cartons beaucoup trop explicatifs. Il simplifie, théâtralise le livre (défaut encore accentué dans la version de William Wellman), le dépouille de sa métaphysique et transformant la seconde partie en une ébauche rapide de LA FORÊT PÉTRIFIÉE.
Etrangement, Maurice Tourneur qui produisit Victory ne paraît guère s’intéresser aux scènes d’extérieurs. La Nature, si importante chez Conrad, est quasiment éliminée ou traitée par-dessus la jambe si l’on excepte une ou deux plans durant un étrange flashback. Contrairement aux scènes d’intérieurs qui sont beaucoup plus soignées et témoignent de recherches cinématographiques souvent passionnantes où Tourneur incorpore la profondeur de champ, les diagonales (quand Jack Holt et Seena Owen s’avancent dans un couloir pendant que les branches d’arbres vues à travers les fenêtres bougent avec le vent), le hors champ. On voit Lon Chaney franchir un rideau de perles et regarder à droite Seena Owen dont le dos est entièrement nu. Il rentre dans la pièce, sortant du champ qui reste vide. La camera ne cadrant plus que le rideau. Tout à coup les deux personnages traversent le champ et se ruent dans une pièce à gauche. Etonnant moment de violence qui joue sur le voyeurisme, l’érotisme. Lon Chaney est d’ailleurs l’une des raisons majeures de voir ce film. Il compose un desperado pour reprendre le terme de Conrad, félin, bestial, sournois qui fout la trouille, qui a un rapport animal avec son couteau mais Bee Deeley est aussi très impressionnant en Mr Jones. Les moments d’action sont plutôt bien filmés (jet du couteau en un plan, mort très brutale) dans des plans brefs. Wallace Beery est assez marrant en aubergiste libidineux.
WINGS (1927, DVD/Blu-ray zone 1)
Un de ces rares classiques où tout ce qui l’a rendu célèbre à l’époque, lui permettant de remporter le premier Oscar comme Meilleur film (sans être nommé à la réalisation) paraît tout aussi excitant, vivant aujourd’hui : toutes les scènes de guerre, y compris les plans sur les tranchées, l’infanterie et surtout les combats aériens bien sûr, qui n’ont guère été égalés. On comprend les différentes tactiques, les ruses, les pièges. On partage les angoisses, l’exaltation des pilotes sans que cela brouille le sens du film. Wellman (que l’on voit brièvement en soldat dans le dernier combat où il est tué en lançant que ces vautours sont assez bons) veut montrer simultanément l’excitation et l’horreur, le côté épique et la brutalité et sa conclusion est sans ambiguïté. Ce message anti-guerre est bien dans l’air du temps et s’accorde avec l’isolationnisme. Ces séquences étaient souvent bruitées par les exploitants de cinéma qui les projetaient. Notamment par les jeunes Jo et Samy Siritzky, futurs patrons de ParaFrance, dans le cinéma de leur père. Toute aussi mythique est l’irruption de Gary Cooper qui devient une star en quelques plans. Visuellement le film reste splendide avec une impressionnante photo de Harry Perry. Il y a notamment une scène avec Richard Arlen et la charmante Jobyna Ralston dans un de ses rares rôles sans Harold Lloyd. En train de se balancer. La caméra est attachée à la balançoire. On voit Roger arriver dans le lointain. La balançoire s’arrête et la jeune femme court vers le nouvel arrivant tandis que la caméra reste en gros plan sur Arlen. Il y a plusieurs moments aussi forts dans cette partie sentimentale qui a été décriée un peu injustement. La fin est tout à fait émouvante jusque dans la manière dont le survivant réalise que le bonheur était à portée de main. Et Clara Bow est excellente, vive et nuancée.
THE TRAIL OF ’98
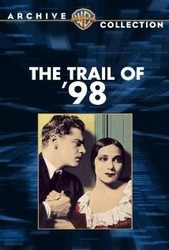 Clarence Brown fut un cinéaste très important au temps du muet. Et talentueux. Il suffit de penser à THE GOOSE WOMAN, œuvre audacieuse, à THE FLESH AND THE DEVIL avec Greta Garbo. TRAIL OF ’98 est une évocation épique de la ruée de 1898 vers le Klondike pour y trouver de l’or qui inspira aussi Chaplin. Les scénaristes Benjamin Glazier et Waldemar Young choisissent au début une structure chorale, avec de multiples personnages, figures emblématiques du genre – de jeunes gens sans expérience, un chauffeur de locomotive, un couple de commerçants, un jeune garçon, des aventuriers divers, des escrocs – qui, peu à peu, s’épure, se resserre autour de quelques destins. Ces personnages sont souvent ballotés, voire noyés, dans la foule, ce qui nous vaut de nombreuses scènes avec des multitudes de figurants, à la fois étonnantes de réalisme (elles sont truffées de détails pittoresques) et spectaculaires : embarquements sur des bateaux archi-combles, camps de chercheur d’or, villes champignons en proie à l’agitation, à la folie, l’ascension de la terrible Chilkoot Pass. Les intérieurs sont tout aussi soignés, du saloon rempli d’ivrognes et de joueurs aux décors misérables de cahutes, de cabanes où le héros abandonne sa fiancée, idée dramatique assez forte que son revirement ne parvient pas à combler.
Clarence Brown fut un cinéaste très important au temps du muet. Et talentueux. Il suffit de penser à THE GOOSE WOMAN, œuvre audacieuse, à THE FLESH AND THE DEVIL avec Greta Garbo. TRAIL OF ’98 est une évocation épique de la ruée de 1898 vers le Klondike pour y trouver de l’or qui inspira aussi Chaplin. Les scénaristes Benjamin Glazier et Waldemar Young choisissent au début une structure chorale, avec de multiples personnages, figures emblématiques du genre – de jeunes gens sans expérience, un chauffeur de locomotive, un couple de commerçants, un jeune garçon, des aventuriers divers, des escrocs – qui, peu à peu, s’épure, se resserre autour de quelques destins. Ces personnages sont souvent ballotés, voire noyés, dans la foule, ce qui nous vaut de nombreuses scènes avec des multitudes de figurants, à la fois étonnantes de réalisme (elles sont truffées de détails pittoresques) et spectaculaires : embarquements sur des bateaux archi-combles, camps de chercheur d’or, villes champignons en proie à l’agitation, à la folie, l’ascension de la terrible Chilkoot Pass. Les intérieurs sont tout aussi soignés, du saloon rempli d’ivrognes et de joueurs aux décors misérables de cahutes, de cabanes où le héros abandonne sa fiancée, idée dramatique assez forte que son revirement ne parvient pas à combler.
Voilà une des œuvres – il n’y en a pas tant que cela – qui renvoie à l’univers de Jack London. On sent le froid dans ces plans de marche à travers la neige, la boue, l’eau glacée même si Brown doit parfois faire appel à des raccords en studio. Il y eut plusieurs morts durant le tournage, « le plus difficile, le plus exténuant de toute ma carrière » déclara le réalisateur. Il y a des plans stupéfiants lors de la descente des rapides du Yukon qui tourne un peu court. La violence, elle, est filmée avec une grande rapidité, une vraie sécheresse (le premier mort dans un saloon) ou traitée de manière elliptique, ce qui la renforce (la manière dont on apprend la mort du jeune garçon). Même le combat final, plus attendu, abonde en coups en traître et se conclut brutalement par un des protagonistes qui se transforme en brasier humain. Principal bémol : la fadeur de Ralph Forbes et le jeu, souvent explicatif, outré, de Dolores Del Rio, actrice assez limitée. Je voudrais citer d’autres films de Brown, plaisants comme WIFE VS SECRETARY, inspiré, comme l’émouvant THE YEARLING ou les brillants POSSESSED ou A FREE SOUL, relativement audacieux comme INTRUDER IN THE DUST d’après Faulkner. Tous ces films existent en DVD en zone 1.
Lire la suite »