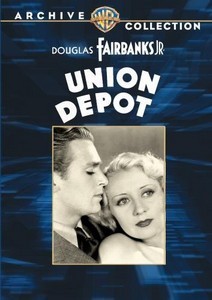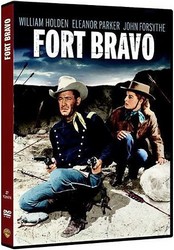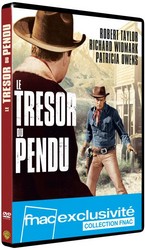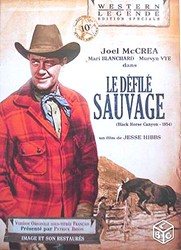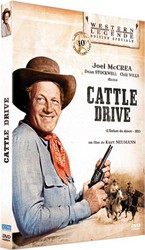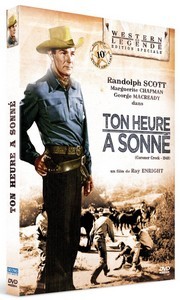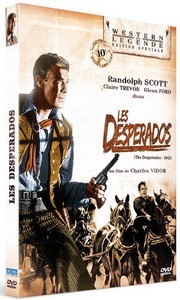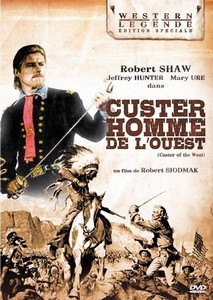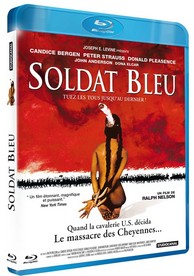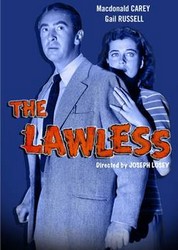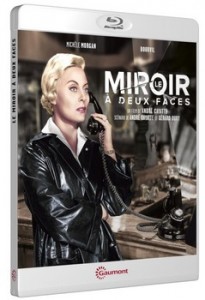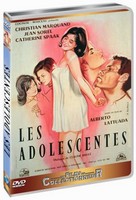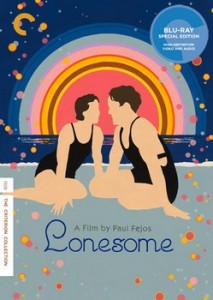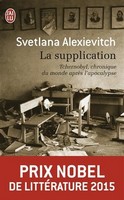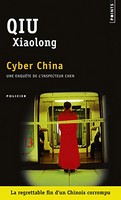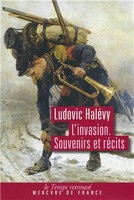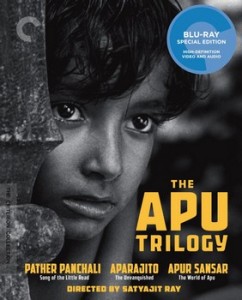FILMS AMÉRICAINS CLASSIQUES OU MÉCONNUS
ALFRED E. GREEN
 Je connais très peu de films d’Alfred E. Green, cinéaste prolifique (qui connaît ses films muets ?). J’ai dit à plusieurs reprises beaucoup de bien de BABY FACE (LILIANE), le plus Pré-Code des films Pré-Code, le plus audacieux, le plus tranchant qui viole tous les futurs diktats de la Censure dans les 15 premières minutes. C’est l’un des films les plus ouvertement sexuels de la période et on le trouve en zone 2. J’ai aussi beaucoup loué FOUR FACES WEST avec Joel McCrea.
Je connais très peu de films d’Alfred E. Green, cinéaste prolifique (qui connaît ses films muets ?). J’ai dit à plusieurs reprises beaucoup de bien de BABY FACE (LILIANE), le plus Pré-Code des films Pré-Code, le plus audacieux, le plus tranchant qui viole tous les futurs diktats de la Censure dans les 15 premières minutes. C’est l’un des films les plus ouvertement sexuels de la période et on le trouve en zone 2. J’ai aussi beaucoup loué FOUR FACES WEST avec Joel McCrea.
Je pense qu’on peut trouver pas mal de surprises dans ses films des années 30 et j’aimerais bien voir DARK HAZARD d’après le roman de W.R. Burnett qui vient d’être réédité en France.
Je conseille donc PARACHUTE JUMPER très divertissante comédie dramatique qui semble mélanger HELL’S ANGELS et L’ENNEMI PUBLIC. A retenir une réplique admirable lancée par une femme qui fait de fortes avances sexuelles à Douglas Fairbanks Jr. : « Avec vous, je fais une exception. Tous mes chauffeurs précédents ont été français… Je trouve les Français plus volatiles, inflammables. »
UNION DEPOT (1932) s’ouvre sur un brillant premier plan, figure stylistique présente dans beaucoup d’œuvres des années 30, un grand travelling à la grue qui traverse une rue où défile un orchestre, franchit les portes d’un hall de gare, nous faisant découvrir tout un microcosme typique de l’Amérique de la Dépression Nous savons immédiatement que nous sommes dans un film Pré-Code qui piétine un grand nombre de conventions morales. Une suite de mouvements brillants, très amples, bien orchestrés par Alfred E. Green, nous montre une femme qui part divorcer à Reno, une actrice qui montre ses jambes aux journalistes, des prostituées qui racolent. On boit malgré la Prohibition, on surprend des intrigues extra-maritales, y compris, notations curieuses, dans un couple de Noirs. Une jeune chorus girl à la recherche de 64 dollars accepte de suivre à l’hôtel Chick (Douglas Fairbanks Jr.) sans pouvoir aller jusqu’au bout (« je ne suis pas né de la dernière pluie mais j’ai un peu de décence »). Il la gifle mais tombe amoureux d’elle. Elle est poursuivie par un redoutable pervers, boiteux, affublé d’énormes lunettes noires qui l’avait engagée pour lui lire des romans pornographiques (« ils viennent d’Europe »). Plus tard, il essaiera de la violer. Green trébuche parfois sur la place des personnages dans l’espace mais se rachète par des audaces visuelles. La photographie de Sol Polito utilise parfois très peu de sources lumineuses. Si le charme réel de Douglas Fairbanks Jr. paraît parfois léger, Joan Blondell, remarquable dans un rôle plus en retenue que d’habitude, gomme tout ce que son personnage pourrait avoir de lénifiant, en mêlant gentillesse, douceur, vulnérabilité avec une vraie sexualité sous-jacente. UNION DEPOT bénéficie en outre d’un de ces dialogues inventifs et percutants qui sont la marque du tandem Kubec Glasmon et John Bright (L’ENNEMI PUBLIC, TAXI, BLONDE CRAZY, autant de réussites) débouchant sur une fin surprenante, douce amère, originale, aussi bien écrite que filmée.
SMART MONEY est le seul film qui oppose Edward G. Robinson et James Cagney mais ce dernier, trop maquillé, n’a qu’un rôle ultra-secondaire et on a droit à un grand récital Robinson, lequel devient de plus en plus inventif comme si le film avait été tourné dans l’ordre (le début est statique et daté et la suite s’améliore). Autre scénario de Bright et Glasmon. DVD avec sous titres et plein de bonus (actualités, courts métrage comiques, numéros musicaux croquignolets).
 Au début des années 50, la carrière de Green chuta malgré un triomphe comme son film sur Al Johnson et il fut obligé de tourner des sériez Z comme le très pittoresque INVASION USA, nanar ultra-fauché (photographié par John Russel : PARK ROW, MOONRISE, PSYCHO) qui constitue une vraie curiosité, une sorte d’apogée du film anti-rouge. Visuellement d’abord : 50% du métrage est composé d’interminables stock-shots de films de guerre supposés montrer l’invasion des USA par les Soviets filmés comme des nazis. Astuce économique suprême, quand ils attaquent, ils sont déguisés en soldats américains ce qui facilite les plans d’archives. Dramaturgiquement ensuite : la presque totalité du film se déroule dans un bar de l’Arizona devant lequel se tiennent sept à huit personnages plus un barman impavide qui regardent ces stock-shots sur une télé et commentent la situation. Cela oblige le malheureux Alfred E. Green à les filmer constamment en rang d’oignon (il n’y a que deux axes dans ces scènes). Parfois, l’un des protagonistes se déplace d’un bout du comptoir à l’autre. Dans le dernier tiers, certains essaient de gagner New York, San Francisco ou le Colorado, ce qui nous permet d’assister à la destruction de ces villes (et à celle, prémonitoire d’une tour, l’Empire State Building) avec des effets spéciaux croquignolets. Ce qui est sidérant, c’est l’étendue des revers, des catastrophes que subissent les Américains et la pauvreté des réactions. Les plans des chefs militaires au Pentagone (« ils nous font croire qu’ils attaquent à l’Ouest ») décrochant leur téléphone en même temps est du pur bonheur, tout comme l’exécution des membres du Congrès qui s’enfuient en claudiquant. Ce nanar anti-communiste paraît d’un pessimisme incroyable même si le dernier rebondissement introduit un fantastique se voulant mobilisateur. Voilà ce que vous allez vivre si vous continuez comme cela. On a le droit à une masse de bonus nous parlant des peurs de l’époque, nous montrant un épisode entier de RED NIGHTMARE présenté par Jack Webb et « personnellement produit par Jack L. Warner », film de télévision qui traite du même sujet que INVASION USA. Ne pas manquer ce DVD.
Au début des années 50, la carrière de Green chuta malgré un triomphe comme son film sur Al Johnson et il fut obligé de tourner des sériez Z comme le très pittoresque INVASION USA, nanar ultra-fauché (photographié par John Russel : PARK ROW, MOONRISE, PSYCHO) qui constitue une vraie curiosité, une sorte d’apogée du film anti-rouge. Visuellement d’abord : 50% du métrage est composé d’interminables stock-shots de films de guerre supposés montrer l’invasion des USA par les Soviets filmés comme des nazis. Astuce économique suprême, quand ils attaquent, ils sont déguisés en soldats américains ce qui facilite les plans d’archives. Dramaturgiquement ensuite : la presque totalité du film se déroule dans un bar de l’Arizona devant lequel se tiennent sept à huit personnages plus un barman impavide qui regardent ces stock-shots sur une télé et commentent la situation. Cela oblige le malheureux Alfred E. Green à les filmer constamment en rang d’oignon (il n’y a que deux axes dans ces scènes). Parfois, l’un des protagonistes se déplace d’un bout du comptoir à l’autre. Dans le dernier tiers, certains essaient de gagner New York, San Francisco ou le Colorado, ce qui nous permet d’assister à la destruction de ces villes (et à celle, prémonitoire d’une tour, l’Empire State Building) avec des effets spéciaux croquignolets. Ce qui est sidérant, c’est l’étendue des revers, des catastrophes que subissent les Américains et la pauvreté des réactions. Les plans des chefs militaires au Pentagone (« ils nous font croire qu’ils attaquent à l’Ouest ») décrochant leur téléphone en même temps est du pur bonheur, tout comme l’exécution des membres du Congrès qui s’enfuient en claudiquant. Ce nanar anti-communiste paraît d’un pessimisme incroyable même si le dernier rebondissement introduit un fantastique se voulant mobilisateur. Voilà ce que vous allez vivre si vous continuez comme cela. On a le droit à une masse de bonus nous parlant des peurs de l’époque, nous montrant un épisode entier de RED NIGHTMARE présenté par Jack Webb et « personnellement produit par Jack L. Warner », film de télévision qui traite du même sujet que INVASION USA. Ne pas manquer ce DVD.
WESTERNS
J’ai revu FORT BRAVO et partage l’enthousiasme d’Erik Maurel sur DVDClassik qui voit à juste titre l’une des plus éclatantes réussites de John Sturges. Je discuterais juste les dernières minutes, véritable orgie de sacrifices et la musique que je trouve conventionnelle. Mais Eleanor Parker est flamboyante (avec une cargaison de robes toutes plus belles les unes que les autres qui ont du nécessiter plusieurs malles, ce que l’on ne voit pas). William Holden est comme très souvent à l’époque, remarquable dans un personnage « dur et ténébreux » comme l’écrit Lourcelles. Magnifique photo de Robert Surtees même dans les extérieurs filmés en studio. Les vrais extérieurs sont eux à couper le souffle et Sturges les utilise avec maestria.
On retrouve ces qualités visuelles, cette appréhension sèche, dépouillée de l’espace et des paysages dans LE TRÉSOR DU PENDU (titre incompréhensible) mais le scénario du pourtant talentueux William Bowers est à la fois traditionnel et relâché. Tous les personnages restent à l’état d’ébauches superficielles et je n’ose pas mentionner l’héroïne, sous-écrite et incarnée (?) par la transparente Patricia Owens.
 THE WALKING HILLS (LES AVENTURIERS DU DÉSERT) est un film soigné mais plombé là aussi par un scénario routinier d’Alan le May. C’est le seul western moderne de Randolph Scott qui y est très bon, plus nuancé qu’on veut bien le dire. Elle Raines est très sexy et on est triste d’apprendre que cette découverte de Hawks était une fervente Républicaine, soutenant Nixon. On peut retenir un combat très violent à la pelle, un flashback totalement incongru malgré un beau plan de Raines face à des trombes de pluie. Et surtout la présence inhabituelle d’un Noir, joué par le chanteur de folk et blues, Josh White, spécialiste du blues urbain et de la « protest song » qui fut l’un des conseillers du Président Roosevelt et fut étiqueté communiste durant le maccarthysme qui brisa sa carrière. Le voir dans ce film est très rafraichissant d’autant qu’il chante plusieurs fois.
THE WALKING HILLS (LES AVENTURIERS DU DÉSERT) est un film soigné mais plombé là aussi par un scénario routinier d’Alan le May. C’est le seul western moderne de Randolph Scott qui y est très bon, plus nuancé qu’on veut bien le dire. Elle Raines est très sexy et on est triste d’apprendre que cette découverte de Hawks était une fervente Républicaine, soutenant Nixon. On peut retenir un combat très violent à la pelle, un flashback totalement incongru malgré un beau plan de Raines face à des trombes de pluie. Et surtout la présence inhabituelle d’un Noir, joué par le chanteur de folk et blues, Josh White, spécialiste du blues urbain et de la « protest song » qui fut l’un des conseillers du Président Roosevelt et fut étiqueté communiste durant le maccarthysme qui brisa sa carrière. Le voir dans ce film est très rafraichissant d’autant qu’il chante plusieurs fois.
JOEL MCCREA
Plusieurs titres sortent chez Sidonis avec Joel McCrea, acteur modeste, juste, nuancé que j’aime de plus en plus. Je l’ai longtemps sous-estimé. Il faut dire qu’il ne la ramenait pas, ne cherchait pas à devenir un mythe. « Je joue sur deux notes », disait il à Preston Sturges qui lui donna trois rôles sublimes dans LES VOYAGES DE SULLIVAN, THE PALM BEACH STORY et le méconnu THE GREAT MOMENT : « oui mais quelles notes ! » répondait Sturges. « Et comme tu les joues bien ! »
Il est d’une justesse confondante dans le très bon, très simple, très chaleureux BLACK HORSE CANYON (LE DÉFILÉ SAUVAGE), le meilleur de tous ces nouveaux titres. Le sujet tient en quelques lignes : une jeune femme veut capturer un étalon sauvage. McCrea joue un rancher, ce qu’il était dans la vie et tous ses gestes, ses attitudes, la manière dont il selle un cheval, répare une clôture, sont magnifiques de naturel et d’aisance. Après chaque tournage, il revenait dans son ranch et là on a presque l’impression de le voir vivre au quotidien. Le scénario de Daniel Mainwaring (PENDEZ-MOI HAUT ET COURT), auteur blacklisté, est chaleureux, parlant d’émotions simples et si importantes, regardant avec affection les protagonistes au point que les bandits paraissent quelque peu redondants. Le dialogue est aussi naturel et donne une vitalité, une sensualité à Mari Blanchard, bien meilleure que dans ses rôles stéréotypés. Race Gentry est plus discutable et dégage une ambiguïté sexuelle. Une jolie surprise, et sans doute le meilleur Jesse Hibbs.
CATTLE DRIVE dirigé par le peu talentueux Kurt Neuman est un plagiat éhonté et du coup assez marrant de CAPITAINE COURAGEUX de Kipling, écrit par Lillie Hayward (CHILD OF DIVORCE). McCrea est excellent (et on l’entend chanter plutôt bien), de même que Dean Stockwell, et il y a plusieurs scènes assez chaleureuses, joliment coloriées. Et puis il y a des trains.
THE LONE HAND (LE SOLITAIRE DES ROCHEUSES) témoigne du savoir faire de George Sherman qui sait intégrer les paysages à l’action, initier quelques plans nerveux (les premiers meurtres) mais le scénario assez benêt, prévisible et manipulateur semble le paralyser et rend son travail superficiel et anonyme.
RANDOLPH SCOTT
CORONER CREEK (TON HEURE A SONNÉ) est un western extrêmement violent pour l’époque. Randolph Scott se fait écraser une main à coup de botte ou de pierre (dans mon souvenir la scène était longue mais je l’ai peut être embellie), on lacère une joue à coups d’éperon. Au début du film, une attaque de diligence vire au massacre et Scott dans une bagarre frappe Forrest Tucker avec sa main abîmée. Moments qui ont révulsé des critiques à l’époque. C’est aussi, détail encore plus important, l’un des premiers westerns où Scott impose un personnage de veuf, muré dans la vengeance qu’il va développer avec André de Toth et surtout Budd Boetticher. Il est prêt ici à toutes sortes de violences, ne craint pas l’illégalité pour assouvir sa vengeance. Il s’agit de la première ou de l’une des premières (il y a un peu de cela dans GUNFIGHTERS, film assez mal dirigé après un beau premier plan) variations sur tout le corpus de films que nous admirons tant. Le scénario de Kenneth Gamet, auteur routinier, n’est pas à la hauteur du roman de Luke Short. Le travail de Ray Enright est correct (avec deux trois bonnes idées, une sécheresse efficace et un affrontement final traité rapidement et filmé intelligemment souvent en plongée, belle idée de cadrage), mais assez anonyme. J’aime bien qu’il insiste sur le fait que certains intérieurs (l’écurie) donnent sur des extérieurs, en l’occurrence une rue. Cela nous vaut des avant-plans sombres et des arrière-plans brillants. Assez bonne utilisation du Cinecolor (ici comme dans GUNFIGHTERS), procédé utilisant deux matrices qui interdisait certaines couleurs. George Macready campe un méchant très germanique et donc sadique. Forrest Tucker est toujours juste tout comme Edgar Buchanan qui campe un shérif asservi à Macready.
LES DESPERADOS, seul western de Charles Vidor, est enjoué, plaisant, splendidement photographié par George Meehan (de multiples séries B et TEXAS) dans de très beaux extérieurs et luxueusement décoré. La narration rapide, l’accumulation des péripéties (il y a pratiquement un retournement par séquence durant toute une partie du film), un dialogue nerveux et réjouissant de Robert Carson, font oublier le caractère conventionnel du scénario et des personnages, tous stéréotypés. Buchanan : « Vous devriez frapper Comtesse ; supposons que je prenne un bain ? » – « Si j’apprenais que vous preniez un bain, là je me mettrais à frapper. » Ou bien, le Juge Cameron : « Vous êtes douze, messieurs. Il faut douze personnes pour faire un jury. Et nous avons deux hommes à pendre. Mais on va le faire légalement. » On n’est pas loin de Lucky Luke. L’interprétation y est aussi pour beaucoup. Randolph Scott est plaisant, Claire Trevor efficace et Glenn Ford prend presque le premier rôle. Porter Hall joue bien sûr un banquier marron. La palme revient à Edgar Buchanan qui en baissant la voix, en parlant de manière étale, transcende un des archétypes du genre : le vieillard alcoolique et forban. Vidor glisse des détails amusants : durant un bal, on voit des chefs indiens dans le fond et pendant une mémorable bagarre de saloon, une tablée de joueurs de poker continu sa partie au milieu du chaos.
CUSTER OF THE WEST (CUSTER, HOMME DE L’OUEST) est une superproduction en Cinérama dont l’ambition est mise à mal par plusieurs décisions stupides de Philip Yordan devenu producteur. Il impose le tournage en Espagne et Hervé Dumont montre bien dans son passionnant ROBERT SIODMAK, LE MAÎTRE DU FILM NOIR, que Zinneman avait abandonné le film et un scénario de Wendel Mayes parce que Zanuck voulait délocaliser le film au Mexique. L’Espagne c’est dix fois pire. On est à des lieux des collines du Dakota. Il suffit de relire les descriptions magnifiques qu’en fait Haycox dans DES CLAIRONS DANS L’APRÈS-MIDI pour constater que les extérieurs sont lamentables et les Indiens joués par des gitans totalement bidons. D’autant que le film réduit tous les rapports entre les différentes tribus et Custer à un duel avec un seul chef indien (joué par un acteur irlandais Kieron Moore), Dull Knife, dont les actions furent, nous dit Dumont, postérieures à la mort de Custer. La scène qui les oppose avant la bataille est un contresens grandiloquent. De plus Yordan coupa des séquences psychologiques tournées et ajouta plusieurs scènes pseudo-spectaculaires ineptes, pour exploiter le Cinérama : pour fuir les Indiens, un chariot dévale une pente, un sergent s’accroche à des troncs d’arbre dans un torrent (scène tournée en Suède), un train roule vers un pont détruit. Ces séquences idiotes, platement tournées (Par Eugène Lourié ? Lerner ?) n’ont rien à voir avec le récit ou les personnages et cassent la progression dramatique. Ajoutons la destruction d’une bourgade, moment stupide et fantaisiste. Yordan a fait tourner par Irving Lerner une longue charge, au début du film, totalement inutile. C’est dommage car le film a des qualités, veut doter le personnage de Custer d’une vraie complexité, minimisant hélas son goût de la publicité et son arrivisme. Il est vrai en revanche qu’il dénonça la corruption régnant à Washington et Robert Shaw, saisissant de ressemblance, donne un portrait puissant où l’héroïsme côtoie le fanatisme, l’aveuglement, une certaine lucidité. Le scénario de Julian Halevy et Bernard Gordon, deux auteurs blacklistés, utilise certains propos prémonitoires de Custer face à l’évolution de la guerre mais jette parfois un regard trop moderne sur certains échanges. Distribution inégale : Jeffrey Hunter et Ty Hardin sont réduits à des affrontements répétitifs mais heureusement Robert Ryan relève le niveau. Il joue un déserteur, visiblement inspiré par le soldat Slovik, qui avant d’être fusillé affronte avec force Custer et lui reproche son absence d’humanité.
En revanche SOLDAT BLEU supporte assez mal une nouvelle vision. Non qu’on puisse discuter des intentions louables de Ralph Nelson et de son scénariste John Gay dont les dialogues surabondants paraissent trop explicatifs et trop s’adresser à un public moderne. Les atrocités commises par les Blancs (et parfois par les Indiens) y sont pointées de manière tellement ostentatoire qu’elles perdent de leur force. Tout paraît fabriqué à commencer par la musique et la mauvaise chanson de Buffy Sainte-Marie, sans oublier l’interprétation trop calculée de Candice Bergen. Le film dégage une certaine vulgarité même si on voudrait soutenir son propos.
LOSEY
Sidonis vient de ressortir M, une œuvre qui fut mésestimée à sa sortie. On l’écrasait en la comparant au chef d’œuvre de Lang mais à la revoir, l’approche de Losey, son travail possèdent une vraie force, une nudité dramatique qui prend le contrepied des ambitions formelles du modèle.
Je crois n’avoir jamais signalé la sortie en zone 1 de THE LAWLESS, sans sous-titres hélas. Voilà une œuvre qui gagne à être revue et je l’avais sous-estimée. C’est l’un des points culminants de la période américaine de Losey, aussi aigu que LE RODEUR dans son découpage, son regard, aussi chaleureux, fraternel que LE GARÇON AUX CHEVEUX VERTS. La chaleur émotionnelle du beau scénario, du dialogue fraternel et aigu de Geoffrey Homes inspire à Losey des plans tranchants, d’une grande élégance visuelle : regardez la manière dont il filme l’arrivée de Macdonald Carey et de Gail Russel au bal, partant de la voiture de Carey qui entre dans le champ et en sort quand rentre Gail Russell qui est à pied. La caméra la suit et recadre Carey qui sort de sa voiture et la rejoint. Magnifique plan, si fluide. Symbolique de la thématique du film qui unit deux personnages que tout semble séparer. Et le film possède une émotion à fleur de peau qui disparaîtra des œuvres ultérieures (sauf du MESSAGER, sous réserves d’une nouvelle vision) : la description de la montée de la violence à partir de petits faits quotidiens déformés par une presse à sensation qui jette de l’huile sur le feu et attise le racisme ambiant qui se nourrit aussi de l’obstination bornée, de l’intolérance. THE LAWLESS est un compagnon indispensable des deux grands films de Cy Enfield, the UNDERWORLD STORY (zone 1 à découvrir) et surtout TRY AND GET ME ou SOUND OF FURY. Gail Russel loin d’être une présence merveilleusement décorative, se montre extrêmement vivante, chaleureuse, touchante et c’est peut-être là son plus grand rôle.
NICHOLAS RAY
THE LUSTY MEN (LES INDOMPTABLES) est un des meilleurs films de Ray. Un des mieux écrits (beaucoup de scénaristes se succédèrent même si Horace McCoy donna la couleur du récit), des mieux tenus. On sent une vraie complicité entre Ray et Mitchum qui collabora au dialogue. Cette nouvelle vision m’a fait mieux apprécier le personnage nuancé de Susan Hayward qui pensait être éclipsée par le formidable Arthur Kennedy. Mais ce sont les personnages féminins qui sont décrits avec attention et justesse. Ces femmes qui essaient de survivre dans ce monde viril où triomphe la testostérone.
BITTER VICTORY (AMÈRE VICTOIRE) m’a semblé meilleur que dans mon souvenir, en tout cas lors de certaines séquences qui ne manquent pas de force et qui sont remarquablement mises en scène : le raid, une embuscade dans le désert, moments violents et désespérés. Jürgens amène une mélancolie touchante, donnant de la vie à une idée de distribution absurde (Gavin Lambert avait écrit un vrai personnage d’Anglais). Burton est plus décevant, assez raide, et Ruth Roman est inexpressive. Magnifique musique de Maurice Leroux.
 Dans une brillante analyse, Kent Jones a totalement détruit la dithyrambe de Godard sur la scène de repas qui oppose les trois personnages, lui préférant de loin la scène antérieure qui oppose Jürgens à son supérieur : contrastant avec l’échange brillant dans le bureau du commandant, le dialogue de la scène en question est moins anodin que sans saveur et l’action n’est pas claire. De toute évidence la séquence précédente réussit mieux à établir les conflits dramatiques à venir, où se mêle le courage, la lâcheté, la malhonnêteté, que l’échange célébré par Godard. Le but de la scène est de faire sentir les soupçons de Jürgens sur les rapports entre Burton et Ruth Roman, tout en nous faisant sentir que l’un des hommes, voire les deux, peuvent être envoyés dans une mission suicide… Selon Bernard Eisenshitz, le tournage fut un vrai chaos et la séquence écrite semble l’addition de plusieurs versions, de notes, d’idées, toutes malaxées le matin du tournage. Le dialogue est bousillé par des personnages qui parlent quand ils devraient se taire, révélant ce qu’ils devraient cacher et ne remarquant pas ce qu’ils ne peuvent pas manquer. Il y a des contradictions étranges : Jurgens paraît surpris à nouveau que Burton soit considéré pour la mission et il présente fièrement Roman à Burton bien qu’il ait été établi que les deux hommes ne s’aiment pas. La conversation qui s’ensuit erre sans logique, mêlant la guerre, l’absence de mémoire, le bavardage, l’amour, la survie, construisant un édifice branlant sur des fondations douteuses. Ce n’est pas que Ray n’a pas travaillé sur le texte, c’est que le texte est si alambiqué (en comparaison avec les scènes similaires, acérées, aiguës de THE LUSTY MEN) que cela élimine tout contact entre les personnages, remplacés par une série se voulant hypnotique de gros plans (42 dans 3 décors). Le résultat de ce manque de clarté est que Burton et Roman flottent de manière éthérée à travers la scène et leurs sentiments restent opaques. On ne sait pas qui a un effet sur qui. Jurgens est le seul qui évolue émotionnellement, de l’exaltation à la bonhommie, à l’étonnement tranquille, à l’état d’alarme et de douleur.
Dans une brillante analyse, Kent Jones a totalement détruit la dithyrambe de Godard sur la scène de repas qui oppose les trois personnages, lui préférant de loin la scène antérieure qui oppose Jürgens à son supérieur : contrastant avec l’échange brillant dans le bureau du commandant, le dialogue de la scène en question est moins anodin que sans saveur et l’action n’est pas claire. De toute évidence la séquence précédente réussit mieux à établir les conflits dramatiques à venir, où se mêle le courage, la lâcheté, la malhonnêteté, que l’échange célébré par Godard. Le but de la scène est de faire sentir les soupçons de Jürgens sur les rapports entre Burton et Ruth Roman, tout en nous faisant sentir que l’un des hommes, voire les deux, peuvent être envoyés dans une mission suicide… Selon Bernard Eisenshitz, le tournage fut un vrai chaos et la séquence écrite semble l’addition de plusieurs versions, de notes, d’idées, toutes malaxées le matin du tournage. Le dialogue est bousillé par des personnages qui parlent quand ils devraient se taire, révélant ce qu’ils devraient cacher et ne remarquant pas ce qu’ils ne peuvent pas manquer. Il y a des contradictions étranges : Jurgens paraît surpris à nouveau que Burton soit considéré pour la mission et il présente fièrement Roman à Burton bien qu’il ait été établi que les deux hommes ne s’aiment pas. La conversation qui s’ensuit erre sans logique, mêlant la guerre, l’absence de mémoire, le bavardage, l’amour, la survie, construisant un édifice branlant sur des fondations douteuses. Ce n’est pas que Ray n’a pas travaillé sur le texte, c’est que le texte est si alambiqué (en comparaison avec les scènes similaires, acérées, aiguës de THE LUSTY MEN) que cela élimine tout contact entre les personnages, remplacés par une série se voulant hypnotique de gros plans (42 dans 3 décors). Le résultat de ce manque de clarté est que Burton et Roman flottent de manière éthérée à travers la scène et leurs sentiments restent opaques. On ne sait pas qui a un effet sur qui. Jurgens est le seul qui évolue émotionnellement, de l’exaltation à la bonhommie, à l’étonnement tranquille, à l’état d’alarme et de douleur.
TOURNEUR ET SIODMAK
CIRCLE OF DANGER est pour moi un Tourneur majeur. Méfiez-vous de la copie Sinister Cinéma, très médiocre. Celle sur Amazon UK est bien meilleure. J’ai été très touché par le côté oblique du film, la manière dont Tourneur élague les péripéties et dont le film déjoue ce que l’on attend et refuse tout affrontement final. Marius Goring et Naunton Wayne sont remarquables et tous les accents régionaux sont justes. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’extérieurs : sur la lande à la fin avec justement ces plans larges que Tourneur affectionne. Il dédramatise le film noir, comme il l’avait fait du film d’horreur.
THE FILE ON THELMA JORDON (LA FEMME À L’ÉCHARPE PAILLETÉE – DVD Zone 1 chez Olive, sans sous-titres) développe un thème cher à Siodmak : l’honnête homme qui tombe dans un piège qu’il finit par perfectionner. On retrouve la vision pessimiste du cinéaste, proche de celle de Lang, dans la description des scènes de foule, son goût pour les jeux d’ombres et de lumière, les éclairages et cadres expressionnistes (le meurtre de la tante), sa virtuosité présente dans quelques séquences. Sinon, malgré un dialogue adulte de Ketti Frings, le récit paraît léthargique, alourdi par les conventions du mélodrame destiné au public féminin qui domine nombre de productions de Hal Wallis. Malgré Barbara Stanwyck avec qui Siodmak s’est très bien entendue, on flirte parfois avec le soap opera un peu noir.
Nous avons aussi revu MOMMIE DEAREST (MAMAN TRÈS CHÈRE) de Frank Perry et assumons pleinement ce que nous écrivions. Simplement, plutôt qu’indigente, terme excessif, la mise en scène nous a semblé soumise à l’approche sensationnaliste du sujet, d’un scénario qui accumule les scènes hystériques sans progression. Les scènes ne semblent pas enracinées dans une vision, elles se contentent d’arriver et certaines sont fortes, lorgnant vers le registre de BABY JANE. C’est une suite de sévices où la jalousie débouche sur la cruauté physique, voire la maltraitance (les plus fortes sont dans la première partie) de manière cyclique et répétitive. Les auteurs peinent à conclure mais on retrouve en revanche les qualités de directeur d’acteurs de Perry qui lui permettent parfois de surmonter les failles de ce scénario boiteux où les personnages secondaires sont sacrifiés. Nous saluions à juste titre Faye Dunaway, réellement impressionnante (on dit que cela ruina plus ou moins sa carrière), mais Steve Forrest est juste et le moment où exaspéré par les éclats de violence narcissiques de Crawford, il décide de la quitter compte parmi les meilleures séquences du film. Avec celle où il offre un bracelet à Christina et découvrant qu’elle n’a le droit de garder qu’un seul cadeau et donner les autres à des orphelins, il le garde pour le lui remettre plus tard. Howard Da Silva campe un Louis B. Mayer crédible, moins extraverti, plus en retenue mais cassant et impitoyable.
Lire la suite »