Le cinéma de Dorothy Arzner
20 décembre 2016 par Bertrand Tavernier - DVD
DOROTHY ARZNER
Pour beaucoup l’hommage à Lumière consacré à Dorothy Arzner fut une révélation. Pour moi aussi, qui n’avais vu que DANCE GIRL, DANCE sur le monde du « burlesque » qui m’avait paru timide et conventionnel. Une tirade revendicatrice de Maureen O’Hara avait permis au mouvement féministe de s’emparer du film et de le surestimer. On est à des lieues de GRAIG’S WIFE, MERRILY WE GO TO HELL, ANYBODY’S WOMAN ou WORKING GIRLS.
Malheureusement, c’est l’un de ses seuls titres qui est disponible en DVD avec le banal et languissant CHRISTOPHER STRONG, pourtant écrit par sa scénariste de prédilection, Zoe Akins, que rachète partiellement l’interprétation lumineuse, élégante et totalement maitrisée de Katharine Hepburn dont ce n’est que le second film et celle touchante de Helen Chandler.
 MERRILY WE GO TO HELL que l’on trouve soit dans un coffret consacré aux films Universal pre-Code soit séparément, compte en revanche parmi les meilleures réussites de Dorothy Arzner qui, comme l’écrit Antoine Royer, dans DVDClassik « aura été l’une des plus remarquables marginalités issues du giron des studios hollywoodiens durant les années 20 : en premier lieu, c’était une femme, et probablement la première réalisatrice à avoir obtenu une place de cette envergure à Hollywood. Plus encore, c’était une lesbienne, qui portait des pantalons et assumait ses amours, notamment avec la danseuse et chorégraphe Marion Morgan, dont elle partagea la vie pendant des décennies où cela ne se faisait pas encore. Et la plupart des films de Dorothy Arzner, sans pour autant être des pamphlets revendicatifs, portent ainsi en eux quelque chose de cette identité singulière, tant dans les thèmes abordés (notamment autour de la condition féminine, avec des personnages qui décident de prendre en main la direction de leur existence plutôt que de subir la pression de l’ordre social) que dans la manière de les appréhender. »
MERRILY WE GO TO HELL que l’on trouve soit dans un coffret consacré aux films Universal pre-Code soit séparément, compte en revanche parmi les meilleures réussites de Dorothy Arzner qui, comme l’écrit Antoine Royer, dans DVDClassik « aura été l’une des plus remarquables marginalités issues du giron des studios hollywoodiens durant les années 20 : en premier lieu, c’était une femme, et probablement la première réalisatrice à avoir obtenu une place de cette envergure à Hollywood. Plus encore, c’était une lesbienne, qui portait des pantalons et assumait ses amours, notamment avec la danseuse et chorégraphe Marion Morgan, dont elle partagea la vie pendant des décennies où cela ne se faisait pas encore. Et la plupart des films de Dorothy Arzner, sans pour autant être des pamphlets revendicatifs, portent ainsi en eux quelque chose de cette identité singulière, tant dans les thèmes abordés (notamment autour de la condition féminine, avec des personnages qui décident de prendre en main la direction de leur existence plutôt que de subir la pression de l’ordre social) que dans la manière de les appréhender. »
Je discuterai simplement et très légèrement « l’identité singulière » car aucun des films d’Arzner ne trahit vraiment ses préférences sexuelles (elle-même les vivait discrètement comme le rappelait Philippe Garnier) contrairement à ce que ressassent les universitaires américains. Même s’il lui arrive de dénoncer des conduites phallocratiques dans les couples, comme dans un certain nombre de mélodrames (BACK STREET de Stahl). De même que Cukor faisait attention à dissimuler son homosexualité dans ses films. On peut en effet noter l’attention que porte Arzner à ses personnages féminins – ici Sylvia Sidney qui a rarement été plus belle, plus délicate et ailleurs la sidérante Ruth Chatterton sans oublier Rosalind Russell extraordinaire dans CRAIG’S WIFE : attention aux visages, aux costumes, aux cadrages. Mais dans MERRILY WE GO TO HELL (c’est le toast qui ponctue chaque libation de Jeremy Corbett), Fredric March est exceptionnel, tout comme John Boles dans CRAIG’S WIFE, voire Clive Brooks et surtout Paul Lukas dans ANYBODY’S WOMAN, ce qui contredisait un peu l’assertion de Garnier selon laquelle, elle sacrifiait parfois les personnages masculins.
Il y a un thème qui court à travers tous ses films : les couples mal assortis ou dysfonctionnels pour des différences de classe, de milieu, de caractère. Parfois les protagonistes surmontent ces différences, après bien des souffrances comme dans ce film, parfois non comme dans CRAIG’S WIFE. Toujours Antoine Royer : « MERRILY WE GO TO HELL (1932) est un film admirable, à de nombreux points de vue. Stimulant, troublant, émouvant, léger tout en étant empreint de gravité et de subversion, le film témoigne d’une excellence de production assez généralisée qu’il convient de souligner ici. Avec le recul conféré par quelques décennies de mélodrames plus ou moins honnêtes autour de l’alcoolisme – et parmi eux, de bien rares chefs-d’œuvre – on pourrait trouver le déroulé du film un peu attendu, somme toute prévisible. Quatre contre-arguments, au moins, invitent à modérer le constat critique. Premièrement : avant 1932, la figure de l’alcoolique n’avait que rarement été traitée en tant que telle au cinéma, si ce n’est pour donner l’occasion de scènes d’ivresse comique et/ou bagarreuse, et des ressorts dramaturgiques qui peuvent aujourd’hui paraître obligés ne l’étaient pas forcément, loin de là, à l’époque. Deuxièmement – et pour revenir à cet admirable titre – : certes, le couple central va être mis à mal par la dépendance à l’alcool de Jerry, et ce qui est attendu survient… mais peut-on finalement reprocher à un film de se tenir au programme annoncé sur son affiche ? Troisièmement, le scénario d’un film ne se limite pas, loin de là, au déroulé de son intrigue, et le film contient suffisamment de singularités périphériques, dans son approche de son sujet ou dans le traitement de ses personnages secondaires, pour attiser la curiosité. Et enfin, quatrièmement : il ne faudrait pas confondre le moyen et la fin, et MERRILY WE GO TO HELL n’est en réalité pas tant un film sur l’alcoolisme qu’une œuvre sur les obsessions individuelles et les pulsions destructrices qu’il engendre souvent. »
Le ton oscille entre la cocasserie et la gravité, la légèreté et le drame et l’action avance comme suspendue dans un nuage d’alcool, ce qui dramatise les chutes et les faux pas. Corbett va se remettre à boire sous l’influence de son ancienne petite amie qui l’avait pourtant maltraité :« Pourquoi me considères tu avec cette dévotion ? », lui demande-t-elle quand ils se retrouvent, « celle qu’on accorderait à un boa constrictor ». « C’est vrai, j’étais jeune et égocentrique » – « Et maintenant ? » – « Maintenant, je suis jeune et égocentrique ». Et il va entraîner provisoirement sa femme dans sa chute. Il y a des parenthèses surprenantes : la recherche d’un baryton occupe pendant quelques scènes les déambulations d’un trio de fêtards dont March (« il n’est ni baryton ni gentleman », dit il après avoir testé un barman vocaliste et après qu’un autre barman ait répondu « je n’autorise pas les barytons ici ») et tout à coup une réplique poignante, quand Sylvia Sidney qui vient elle aussi de boire, déclare : « Je vous donne l’état sacré du mariage moderne : on vit seul, dans des lits jumeaux avec trois Alka Seltzer le matin. » Remarquable dialogue, brillant, moderne et rapide d’Edwin Justus Mayer (March découvrant que Sidney est la fille de Prentice, le roi de la conserve : « Ah, celui qui met des objets dans une boîte que moi j’ouvre pour les en retirer »). Arzner parvient à contourner tous les clichés, nous faisant sentir la muflerie de March mais aussi sa fragilité, la souffrance. Elle maitrise tous les changements de ton avec une grâce infinie.
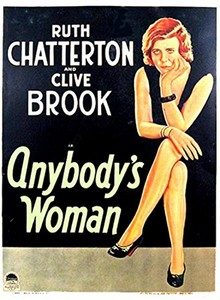 ANYBODY’S WOMAN (1930) est dans la même veine et débute par un moment anthologique. Clive Brook surprend par la fenêtre dans une chambre voisine, deux chorus girls dont l’une joue de l’ukulele. C’est Ruth Chatterton qui est absolument inoubliable. Ils vont se marier. Toujours un de ces couples mal assortis qui peuplent les films d’Arzner avec tous les incidents que cela entraine : les gaffes de la jeune femme, ses manières plébéiennes, l’arrogance des amis du marié, imbus des privilèges de leur caste. Mais avec l’aide de la scénariste Zoe Akins (qui adapte une histoire de Gouverneur Morris, l’auteur pulp de EAST OF JAVA), Arzner triomphe de tous les pièges et réussit à constamment nous surprendre. Tous les personnages à commencer par celui que joue si délicatement Paul Lukas, révèlent des facettes inattendues, une couleur qu’on n’avait pas repéré, une surprenante véracité (notamment celui que joue Lukas qui prend tout le monde à contre pied) et le scénario évite tous les stéréotypes. La Pansy de Ruth Chatterton est une fille naturelle, décente, loyale qui reconnaît ses erreurs et refuse qu’elles la plombent. Elle peut aussi être rude quand il le faut, n’hésitant pas à gifler un soupirant trop insistant, ce qui se retourne contre elle. Le scénario est ponctué par des intertitres : un Mois Après, le Lendemain, comme un film muet mais ce qui paraît ailleurs une béquille, devient ici une manière dynamique de raconter l’histoire, faisant saliver le spectateur. D’autant qu’Arzner utilise admirablement l’espace (les personnages coincés dans des chambres proches ou de très grandes pièces) et le son : un ventilateur permet de réverbérer des conversations et de les faire entendre à une autre personne, astuce digne du Dumas des TROIS MOUSQUETAIRES avec la fameuse cheminée.
ANYBODY’S WOMAN (1930) est dans la même veine et débute par un moment anthologique. Clive Brook surprend par la fenêtre dans une chambre voisine, deux chorus girls dont l’une joue de l’ukulele. C’est Ruth Chatterton qui est absolument inoubliable. Ils vont se marier. Toujours un de ces couples mal assortis qui peuplent les films d’Arzner avec tous les incidents que cela entraine : les gaffes de la jeune femme, ses manières plébéiennes, l’arrogance des amis du marié, imbus des privilèges de leur caste. Mais avec l’aide de la scénariste Zoe Akins (qui adapte une histoire de Gouverneur Morris, l’auteur pulp de EAST OF JAVA), Arzner triomphe de tous les pièges et réussit à constamment nous surprendre. Tous les personnages à commencer par celui que joue si délicatement Paul Lukas, révèlent des facettes inattendues, une couleur qu’on n’avait pas repéré, une surprenante véracité (notamment celui que joue Lukas qui prend tout le monde à contre pied) et le scénario évite tous les stéréotypes. La Pansy de Ruth Chatterton est une fille naturelle, décente, loyale qui reconnaît ses erreurs et refuse qu’elles la plombent. Elle peut aussi être rude quand il le faut, n’hésitant pas à gifler un soupirant trop insistant, ce qui se retourne contre elle. Le scénario est ponctué par des intertitres : un Mois Après, le Lendemain, comme un film muet mais ce qui paraît ailleurs une béquille, devient ici une manière dynamique de raconter l’histoire, faisant saliver le spectateur. D’autant qu’Arzner utilise admirablement l’espace (les personnages coincés dans des chambres proches ou de très grandes pièces) et le son : un ventilateur permet de réverbérer des conversations et de les faire entendre à une autre personne, astuce digne du Dumas des TROIS MOUSQUETAIRES avec la fameuse cheminée.
WORKING GIRLS (1931) ne se situe pas au même niveau en partie à cause du matériau de base, une pièce de Vera Caspary se déroulant à l’origine dans une chambre d’hôtel de femmes, avec une distribution entièrement féminine. Zoe Akins rajouta donc les personnages d’hommes et tous les extérieurs. Et surtout, avec la réalisatrice, elle noie l’intrigue sous une foule détails, de personnages, de notations si bien que la trame a moins d’importance que l’atmosphère. Parmi les « working girls » (c’est à dire plus ou moins des prostituées dans l’argot de l’époque, l’équivalent des « travailleuses » chères au Milieu français) du titre, figurent deux sœurs et là Arzner va montrer peu à peu que celle qui paraît flirter le plus est en fait la plus posée, la plus pragmatique. Et Dorothy Hall est d’ailleurs assez convaincante alors que le jeu de Judith Wood se révèle assez exaspérant et forcé. Autre faiblesse, Charles Buddy Rogers distribué ici à contre emploi (il est frivole, égoïste, oublieux de toutes ses promesses), ce qui ne dynamise pas son talent. Heureusement la mise en scène d’Azner, son attention à de petits détails surmontent les faiblesses du sujet et de l’interprétation.. Elle dynamise par ses plans, ses cadrages des moments où pourtant rien ne paraît se passer qu’elle soigne particulièrement, souligne la caractère prolétarien de certains personnages, réussit plusieurs séquences de montage et dirige remarquable Paul Lukas, personnage complexe et touchant. Les premières séquences se déroulant dans l’hôtel ont suscité des exégèses soulignant leur côté lesbien qui nous semble pourtant indéchiffrable. Certes, on voit une fille cligner de l’œil vers une copine mais cela paraît davantage un gag qu’une tentative de séduction. Et quant aux filles qui dansent ensemble, on en voit beaucoup dans les films de la Dépression, voire plus tard, quand leurs copains ou maris étaient de mauvais danseurs, sans que cela trahisse la moindre influence homosexuelle. Ce film passionnant fut malheureusement un échec commercial.
CRAIG’S WIFE (1936)
 Pour Edward Chodorov qui produisit le film et déclare avoir travaillé au scénario, c’est la dernière réussite de Dorothy Arzner et sans doute son chef d’œuvre. L’Histoire semble lui donner raison. Inspiré d’une pièce de George Kelly, l’oncle de Grace, qui reçut le prix Pulitzer, le scénario est crédité à Mary McCall qui accomplit (sous la supervision ou avec l’aide de Chodorov ?) un travail remarquable, supprimant les digressions de la pièce, ses longueurs, réduisant les trois actes à 71 minutes. Bien sur, on peut penser que vu le laps de temps (identique dans la pièce) l’évolution du mari et sa soudaine lucidité sont un peu précipitées mais John Boles et la mise en scène parviennent à faire accepter la convention. Le couple dysfonctionnel qu’il forme avec Rosalind Russel (le choix de l’actrice est revendiqué par Chodorov mais sa direction, rigoureuse, tendue, semble être le fait de la réalisatrice), femme parfaite, ménagère perfectionniste qui aime davantage sa maison que son mari ou le monde extérieur, est l’un des plus forts, des plus originaux de toute l’œuvre d’Arzner qui en compte pourtant pas mal. Elle est froide, calculatrice, obsédée plus par les apparences, par ce que vont dire les gens que par les ennuis judiciaires qui peuvent tomber sur son mari. Sa recherche de l’indépendance à tout prix, sa volonté d’autonomie la conduisent à nier le monde extérieur, à ne privilégier que sa maison : elle se montre d’une incroyable dureté envers une de ses plus fidèles domestiques (Jane Darwell), coupable d’avoir invité quelqu’un à la cuisine ; elle méprise sa voisine qui lui amène sans cesse des roses (délicieuse Billie Burke), ment de manière éhontée à sa jeune nièce à qui elle déclare que le « mariage est le seul moyen d’acquérir sa liberté ». Et peu à peu va se retrouver seule, abandonnée par tous. Rosalind Russel sait combiner la froideur et la fausse gentillesse qu’elle exhibe pour la galerie et qui sont les deux faces de la même pièce. Elle arrache son interprétation sans jamais avoir l’air de juger son personnage, de le commenter et l’on sent qu’elle est non pas un monstre mais le produit parfait d’une société. Arzner transforme sa maison avec l’aide d’un de ses amis, le décorateur d’intérieur William Haines qui remplaça Stephen Goosson qu’elle avait renvoyé, en une sorte de mausolée, un tombeau pour sa propre gloire qui finit par devenir suffoquant. Elle joue sur les verticales pour augmenter ce sentiment d’oppression et le moment où Boles fracasse le vase qu’elle essuie et repositionne constamment, résonne comme un sacrilège libérateur. Il l’avoue avec une certaine jubilation, conquérant ainsi sa liberté.
Pour Edward Chodorov qui produisit le film et déclare avoir travaillé au scénario, c’est la dernière réussite de Dorothy Arzner et sans doute son chef d’œuvre. L’Histoire semble lui donner raison. Inspiré d’une pièce de George Kelly, l’oncle de Grace, qui reçut le prix Pulitzer, le scénario est crédité à Mary McCall qui accomplit (sous la supervision ou avec l’aide de Chodorov ?) un travail remarquable, supprimant les digressions de la pièce, ses longueurs, réduisant les trois actes à 71 minutes. Bien sur, on peut penser que vu le laps de temps (identique dans la pièce) l’évolution du mari et sa soudaine lucidité sont un peu précipitées mais John Boles et la mise en scène parviennent à faire accepter la convention. Le couple dysfonctionnel qu’il forme avec Rosalind Russel (le choix de l’actrice est revendiqué par Chodorov mais sa direction, rigoureuse, tendue, semble être le fait de la réalisatrice), femme parfaite, ménagère perfectionniste qui aime davantage sa maison que son mari ou le monde extérieur, est l’un des plus forts, des plus originaux de toute l’œuvre d’Arzner qui en compte pourtant pas mal. Elle est froide, calculatrice, obsédée plus par les apparences, par ce que vont dire les gens que par les ennuis judiciaires qui peuvent tomber sur son mari. Sa recherche de l’indépendance à tout prix, sa volonté d’autonomie la conduisent à nier le monde extérieur, à ne privilégier que sa maison : elle se montre d’une incroyable dureté envers une de ses plus fidèles domestiques (Jane Darwell), coupable d’avoir invité quelqu’un à la cuisine ; elle méprise sa voisine qui lui amène sans cesse des roses (délicieuse Billie Burke), ment de manière éhontée à sa jeune nièce à qui elle déclare que le « mariage est le seul moyen d’acquérir sa liberté ». Et peu à peu va se retrouver seule, abandonnée par tous. Rosalind Russel sait combiner la froideur et la fausse gentillesse qu’elle exhibe pour la galerie et qui sont les deux faces de la même pièce. Elle arrache son interprétation sans jamais avoir l’air de juger son personnage, de le commenter et l’on sent qu’elle est non pas un monstre mais le produit parfait d’une société. Arzner transforme sa maison avec l’aide d’un de ses amis, le décorateur d’intérieur William Haines qui remplaça Stephen Goosson qu’elle avait renvoyé, en une sorte de mausolée, un tombeau pour sa propre gloire qui finit par devenir suffoquant. Elle joue sur les verticales pour augmenter ce sentiment d’oppression et le moment où Boles fracasse le vase qu’elle essuie et repositionne constamment, résonne comme un sacrilège libérateur. Il l’avoue avec une certaine jubilation, conquérant ainsi sa liberté.
 HARRIET CRAIG, le remake qu’en fit Vincent Sherman, est vraiment intéressant pendant plus de la première moitié, surtout par rapport à ce que l’on a appris de Crawford par la suite, ses obsessions, sa maniaquerie, son coté tyrannique avec ses proches. Le film incorpore certains de ses traits et ce, alors que Crawford avait une histoire d’amour avec Vincent Sherman qui dura 3 ans. Est-ce que ceci explique cela, est-ce que Sherman qui disait que les Noël chez Crawford était une torture ne les a pas ajoutés dans le script ? Le fait que Crawford les ait acceptés, connaissant le voile qui dissimulait sa conduite avec ses enfants et ses proches, laisse rêveur. Masochisme, sentiment d’invulnérabilité ? Cela renforce l’intérêt du film, filmé avec une vrai fluidité et un sens certain de la direction d’acteur. Le dernier tiers trahit son origine théâtrale et les coups de théâtre sont assénés sans subtilité malgré l’interprétation très convaincante de Wendell Corey. Le film est plus long que le Arzner, plus psychologie et Crawford paraît plus ambitieuse dans ce qu’elle recherche et plus perverse avec son mari.
HARRIET CRAIG, le remake qu’en fit Vincent Sherman, est vraiment intéressant pendant plus de la première moitié, surtout par rapport à ce que l’on a appris de Crawford par la suite, ses obsessions, sa maniaquerie, son coté tyrannique avec ses proches. Le film incorpore certains de ses traits et ce, alors que Crawford avait une histoire d’amour avec Vincent Sherman qui dura 3 ans. Est-ce que ceci explique cela, est-ce que Sherman qui disait que les Noël chez Crawford était une torture ne les a pas ajoutés dans le script ? Le fait que Crawford les ait acceptés, connaissant le voile qui dissimulait sa conduite avec ses enfants et ses proches, laisse rêveur. Masochisme, sentiment d’invulnérabilité ? Cela renforce l’intérêt du film, filmé avec une vrai fluidité et un sens certain de la direction d’acteur. Le dernier tiers trahit son origine théâtrale et les coups de théâtre sont assénés sans subtilité malgré l’interprétation très convaincante de Wendell Corey. Le film est plus long que le Arzner, plus psychologie et Crawford paraît plus ambitieuse dans ce qu’elle recherche et plus perverse avec son mari.
Autres films vus à Lumière
BUTCH CASSIDY ET LE KID tient très bien le coup même si un des passages ultra-célèbres grâce à la chanson de Bacharach prend des airs de vidéo clip. J’ai été très sensible au scénario et surtout au remarquable dialogue de William Goldman (avec cette brusque irruption d’un type qui veut placer la bicyclette au milieu du recrutement d’une milice) auquel George Roy Hill contribua et aussi à la manière dont ce dernier passe dans sa réalisation de la comédie, de la désinvolture à la gravité. Il y a deux monologues extrêmement touchants de Katharine Ross, notamment le dernier quand ils vont se séparer qui s’enchaine sur une ellipse très émouvante. Roy Hill a très souvent raconté l’histoire de types instables, pas très mûrs, inadaptés psychologiquement (pensez à THE WORLD OF HENRY ORIENT). Tarantino disait à Lyon que dans tous ses films, il y a un affabulateur et un idéaliste. Ce qui n’est pas faux.
Dans le programme préparé par Quentin TARENTINO, j’ai pu enfin voir LA DAME DANS L’AUTO AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL de Litvak qui est plaisant et bien mené (Samantha Eggar est fort bonne de même que Fresson) et comme le dit Tarantino « hip et cool ». Mais comme beaucoup d’adaptations de Japrisot, le récit et le suspense sont tellement alambiqués qu’ils réclament 25 minutes d’explications.
THE LIBERATION OF L.B. JONES (ON N’ACHÈTE PAS LE SILENCE) tient très bien le coup et nous étions injustes dans 50 ANS avec ce film. Nous allions jusqu’à mettre en doute, erreur inexcusable et ne s’appuyant sur rien, les convictions personnelles de Wyler. Or on apprend dans FIVE CAME BACK de Mark Harris que Wyler avait demandé à Capra de réaliser le film sur les soldats noirs. Capra l’envoya dans le Sud avec un scénariste noir Carleton Moss et là, Wyler fut horrifié par tout ce qu’il découvrit : un racisme omniprésent, violent, y compris à l’intérieur de l’armée qui l’empêchait de travailler avec son co-auteur : ils ne pouvaient pas être ensemble dans les restaurants, les hôtels, les trains. Ecœuré, Wyler abandonna le projet en déclarant qu’il haïssait le Sud. Et cette violence, on la sent tout au long de THE LIBERATION OF L.B. JONES. Ce que nous qualifions de cynique est en fait une lucidité qui refuse les compromis et l’ordre établi. Et le jeune avocat qui quitte le pays est la réincarnation de Wyler, touche profondément personnelle. Le projet, évidemment, a bénéficié du succès de IN THE HEAT OF THE NIGHT, mais il n’en a pas la roublardise (inconsciente ?). Nulle réconciliation, nulle main tendue entre les Noirs et les Blancs à la fin, qui mettait tellement en colère James Baldwin. Seul bémol, Wyler se livre à tout un montage de plans cut, ultra rapides, sur le visage d’une jeune noire, concession inutile à l’air du temps qui jure par son pseudo modernisme. Belle musique d’Elmer Bernstein.
LECTURES
 SAINT FRANÇOIS D’ASSISE (Éditions Le Bruit du Temps du Temps) est une magnifique et revigorante biographie écrite par l’immense GK Chesterton (dans tous les sens du termes, il mesurait 1 mètre 96 et était un colosse). Bien qu’il se soit converti au catholicisme, Chesterton n’est pas un auteur paralysé par les dévotions. Comme l’écrit Anne Weber dans sa belle préface et qui parle de l’éblouissement que l’on ressent à la lecture : « nul besoin pour cela d’être soi-même catholique orthodoxe comme Chesterton, ni même catholique tout court, ni même croyant. Du moment qu’on est un être humain, comment ne pas être ébloui face au merveilleux personnage que l’on découvre et qui ressemble si peu à l’idée qu’on se fait communément d’un saint, ni d’ailleurs à rien de ce qu’on a jamais connu. On suppose qu’on va avoir affaire à quelque ascète sinistre et l’on se retrouve face au plus joyeux des hommes. » Chesterton trace le portrait d’un François qui a d’abord voulu s’illustrer à la guerre avant que la maladie le terrasse, un homme profondément démocratique, voire révolutionnaire et l’on y apprend une foule de détails savoureux, cocasses ou bouleversants. « Toute l’explication de Saint François, écrit-il, c’est qu’il était certes ascétique et qu’il n’était certes pas sombre… Il se jeta dans le jeûne et les vigiles aussi furieusement qu’il s’était jeté dans la bataille. Il avait fait faire à son coursier volte-face complète mais il n’y avait ni arrêt ni ralentissement dans la foudroyante impétuosité de sa charge. Elle ne présentait rien de négatif ; ce n’était ni un régime ni une simplification stoïque de la vie. » On admirera au passage l’écriture de Chesterton que vénérait Borges. J’ai été fasciné par les rapports entre le monde des troubadours, voire des jongleurs et François.
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE (Éditions Le Bruit du Temps du Temps) est une magnifique et revigorante biographie écrite par l’immense GK Chesterton (dans tous les sens du termes, il mesurait 1 mètre 96 et était un colosse). Bien qu’il se soit converti au catholicisme, Chesterton n’est pas un auteur paralysé par les dévotions. Comme l’écrit Anne Weber dans sa belle préface et qui parle de l’éblouissement que l’on ressent à la lecture : « nul besoin pour cela d’être soi-même catholique orthodoxe comme Chesterton, ni même catholique tout court, ni même croyant. Du moment qu’on est un être humain, comment ne pas être ébloui face au merveilleux personnage que l’on découvre et qui ressemble si peu à l’idée qu’on se fait communément d’un saint, ni d’ailleurs à rien de ce qu’on a jamais connu. On suppose qu’on va avoir affaire à quelque ascète sinistre et l’on se retrouve face au plus joyeux des hommes. » Chesterton trace le portrait d’un François qui a d’abord voulu s’illustrer à la guerre avant que la maladie le terrasse, un homme profondément démocratique, voire révolutionnaire et l’on y apprend une foule de détails savoureux, cocasses ou bouleversants. « Toute l’explication de Saint François, écrit-il, c’est qu’il était certes ascétique et qu’il n’était certes pas sombre… Il se jeta dans le jeûne et les vigiles aussi furieusement qu’il s’était jeté dans la bataille. Il avait fait faire à son coursier volte-face complète mais il n’y avait ni arrêt ni ralentissement dans la foudroyante impétuosité de sa charge. Elle ne présentait rien de négatif ; ce n’était ni un régime ni une simplification stoïque de la vie. » On admirera au passage l’écriture de Chesterton que vénérait Borges. J’ai été fasciné par les rapports entre le monde des troubadours, voire des jongleurs et François.
De Chesterton, il faut absolument lire UN NOMMÉ JEUDI, cette fable sarcastique, LES ENQUÊTES DU PÈRE BROWN et si vous le trouvez d’occasion, son prodigieux essai sur Dickens dont certaines pages constituent le plus beau texte jamais écrit sur John Ford. Je vais aussi commander chez le même éditeur sa vie de Robert Browning.
Je me suis replongé avec délices dans certains livres d’Albert Cossery, ce romancier égyptien qui écrivait en français et en anglais : LES HOMMES OUBLIÉS DE DIEU fut préfacé par Henry Miller. Il faut absolument découvrir LES FAINÉANTS DE LA VALLÉE FERTILE, LA VIOLENCE ET LA DÉRAISON, MENDIANTS ET ORGUEILLEUX.
Petite promo familiale, ma fille Tiffany vient d’écrire une belle biographie sur Isabelle Eberhardt, UN DESTIN DANS L’ISLAM (Tallandier). C’est passionnant, touchant et très actuel. Quel destin.
Bouquins a eu la fort bonne idée de réunir en deux volumes les chroniques d’Alexandre Vialatte parues dans La Montagne au temps béni où les journaux s’offraient de vrais et grands écrivains. C’est un éblouissant festival, sublimement écrit, jubilatoire. Du bonheur à chaque ligne. En l’ouvrant au hasard, je suis tombé sur ce que Vialatte écrivait sur BONJOUR TRISTESSE. C’est splendide. Il trace un portrait si élégant, si profond de Sagan, si drôle où il a déjà tout senti, tout compris. Voilà un bon remède face aux tonnes de langue de bois qui se déversent.
L’autobiographie de Bruce Springsteen BORN TO RUN (Albin Michel) est un livre émouvant, un vrai portrait de l’Amérique populaire, ouvrière, pauvre (il y a des pages formidables sur la manière dont il vivait). Il parle avec honnêteté de ses crises de dépression, des doutes qui le ravagent : un an et demi pour mixer THE RIVER. Les rapports ambigus, douloureux avec son père, son évocation chaleureuse de sa mère, ses luttes pour conquérir sa liberté, la description de la disparition du saxophoniste Clarence constituent des pages bouleversantes comme tout ce qu’il écrit sur Elvis, Dylan, Pete Seeger. Du coup je me suis replongé dans certains de ses albums, NEBRASKA qui fut méconnu, BORN IN THE USA qui lui valut des félicitations de Reagan, THE SEEGER SESSION, THE GHOST OF TOM JOAD inspiré par LES RAISINS DE LA COLÈRE et Woody Guthrie.
Dans ma collection western, chez Actes Sud, je signale la parution de CIEL ROUGE, un roman de Luke Short, auteur totalement ignoré en France, où il introduit avec brio les principes du roman noir dans le western. Robert Wise en tira un fort bon film, nocturne, à peine gâché par de mauvaises transparences et que rachetaient Mitchum, déjà génial, et une scène de bagarre incroyablement violente. Sans oublier la sublime photo noir et blanc de Nicholas Musuracca. Luke Short participa au scénario, ce qui explique la fidélité du film au roman. Une partie des qualités que MB trouve fort justement dans TON HEURE A SONNÉ, viennent du livre de Short, CORONER CREEK, même si le scénario de Kenneth Gamet le simplifie quelque peu. Toutes les scènes de violence sadique proviennent du roman.
L’ÉTRANGE INCIDENT (the Ox Bow Incident) de Van Tilburg Clark est un admirable roman, profond, âpre, fort. A lire d’urgence. Voilà un immense écrivain qui influença des dizaines d’auteurs. Il s’agit sans doute du premier livre de fiction sur le lynchage.
THE COLOR LINE est une riche exposition au Musée du Quai Branly et aussi un très beau triple CD sorti par Frémaux & associés : chansons de travail, de protestation, blues urbains ou campagnards, Come Sunday d’Ellington.
Lisez aussi LA SILICOLONISATION DU MONDE, un essai qui fait parfois froid dans le dos. Eric Sadin est l’un des rares intellectuels à penser la numérisation de notre monde. Voilà 10 ans maintenant qu’il interroge d’un point de vue philosophique l’impact du numérique sur nos sociétés. Cette fois-ci il parle de « silicolonisation » du monde, contraction de deux mots : la Silicon Valley, lieu mythique du développement du numérique aux Etats Unis, et colonisation tant la réussite industrielle de ces produits colonise le monde selon lui. Cet essai est une charge contre les Facebook, Apple et autres Amazon qui contrôlent subrepticement nos vies pour en tirer des services via les applications et générer des profits à une échelle jamais atteinte auparavant.
Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Mario Ruspoli, James Toback et une sélection de classiques français
- Article précédent : Une poursuite infernale et des films noirs
Articles similaires
Commentaires (589)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)




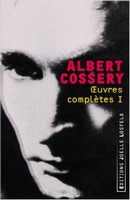

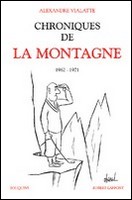
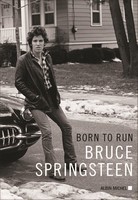
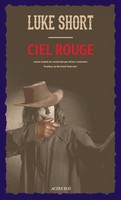


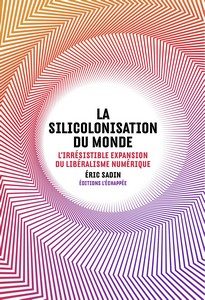
Bertrand,
vous m’avez donné envie de revoir BUTCH CASSIDY ET LE KID qui vieillit pas mal du tout. Il faudrait que je revoie L’ARNAQUE à l’aune de cette redécouverte car Newman et surtout Redford excellent à rendre ce côté « gamin » des personnages, parfois geignards et boudeurs, et ce jusqu’au bout. Le dialogue, effectivement piquant de William Goldman, donnent le La de la gestion intelligente du charme des interprètes. La répartie, sans doute programmatique du duo, constitue une des raisons qui explique l’excellent vieillissement du film. Si des coquetteries de surface (Newman et la bicyclette, les chromos new-yorkais)surviennent ça et là, le film, plus en profondeur, donnent à ses protagonistes une épaisseur discrètement enfantine qui n’est pas si courante dans le western moderne. Les pures scènes d’action, précises, âpres, n’en ont que plus de poids : voir la presque fantastique séquence du « posse » ou la fusillade finale avec la maréchaussée bolivienne, remarquablement réalisée et découpée.
En outre, on a droit à un très bon Strother Martin, même pour dix pauvres minutes.
A Bertrand.Qu’en est il de la sortie d’un film inédit d’Orson Welles qu’il à réaliser durant une trentaine d’années?Il me semble que c’était des Iraniens qui détenaient les droits d’exploitation de cette oeuvre,mais je n’en sais pas plus.
A Yves
Personne ne s’y retrouve dans cette histoire. Voici le début d’un article trouvé par Joe dante
With footage from The Other Side of the Wind now at a Technicolor lab in Hollywood, completing Orson Welles’ legendary unfinished movie is no longer a quixotic quest.
For the cast and crew who worked alongside Welles on the 1970-1976 shoot, it had been a series of bitter disappointments until an agreement was reached and the footage freed from a Paris film laboratory on March 9. Produced by Filip Jan Rymsza’s Royal Road Entertainment and Frank Marshall, The Other Side of the Wind will be streamed to 93 million Netflix subscribers in 190 countries.
The Other Side of the Wind centers on veteran director Jake Hannaford (played by the late John Huston), struggling to make his comeback film in the New Hollywood era.
Wellesnet reached out to surviving cast and crew members for their reaction. Their reactions ranged from understandable skepticism (« I will believe it when I am sitting in the Cinerama Dome in downtown Hollywood ») to utter jubilation (« My film faith is restored. ») Here are some of the highlights:
Bob Random and Oja Kodar in a scene from The Other Side of the Wind.
Bob Random (Plays John Dale in TOSOTW. He appeared on such television shows as Dr. Kildare, Ben Casey, Gunsmoke, The Dick Van Dyke Show and Gidget. His big screen credits include Village of the Giants, This Property is Condemned and …tick…tick…tick…): “Perseverance Furthers…’ – I Ching. As for how excited I am, my wife just now came up with a good one: ‘I would have been more excited 45 years ago.’ Perhaps the best words are slightly dazed. Throughout the years there have been many rumors and faux reports of a release, but obviously this is it. Thank you Peter and Oja! Am I surprised it is finally going to happen? Not really, but I am curious as to its reception. I was 25 during the shooting, now I’m 72 and I know I’ll get a kick out of seeing it. Not bad for a kid from North Vancouver, eh? »
Larry Jackson (The former manager of the Orson Welles Cinema in Cambridge, Jackson was invited by Welles to work on the crew and plays a member of a documentary film team in TOSOTW. In the years that followed, Jackson, who had also worked on Filming Othello, served as head of acquisitions, marketing and production for the Samuel Goldwyn Company, vice president in charge of production at Orion Pictures, and executive vice president of worldwide acquisitions and co-productions at Miramax): « Despite the passing of so many years, I truly hope this film, so very far ahead of its time in its conception and shooting, will be properly judged for the amazing visionary work of art that it was and is. I’m so very proud to have been a part of it and grateful to Filip and Frank and everyone who helped to cut the Gordian knot.
Jamais diffusé à la tv »La machine »de Paul Vecchiali est un film réquisitoire contre la peine de mort.Bouvet un des acteurs fétiche du réalisateur incarne un ouvrier sidérurgiste qui commet l’enlèvement d’une gamine.On ne comprend pas pourquoi,il va basculer dans l’horreur lui l’homme effaçé et tranquille.Les scènes du tribunal sont fortes en émotions,la mère est dépassée par les évenements.Il y à une sequence qui m’a fait penser à « Orange mécanique »de Kubrick,quand Pierre Lentier subit des électrochocs dans la prison.
Je reviendrai longuement sur Lost city of Z de J Gray que les blogueurs doivent aller voir toutes affaires cessantes.
Un film d’aventure comme on n’en voir plus et une hauteur de vue rare dans la représentation des rapports humains qu’il s’agisse de la perception des rapports entre civilisés et sauvages ou des rapports familiaux qui sont LE grand sujet de J Gray.
Et une perfection formelle qui est un ravissement pour l’oeil, l’oreille et le coeur qui n’en peut plus d’aise face à tant de beauté non apprêtée, vraie comme arrachée à la réalité.
Entièrement d’accord avec vous pour le nouveau James Gray qui m’à fait penser au cinéma d’Herzog(Fitzcaraldo ou Cobra verde)et meme de Mallick.En effet il y à une forte relation entre l’humain face à la nature,la végétation,l’eau,le vent ou le feu.Gray se démarque totalement du cinéma traditionnel état-unien et prouve qu’il est un créateur et un auteur à part entière.La bande musicale est grandiose.
D’accord ballantrae avec ce que vous dites sur THE LOST CITY OF Z et je dirai qu’au-delà du film d’aventure, c’est d’abord un film sur l’aventure intérieure, la quête d’une vie à laquelle chacun peut prétendre : la cité de Z n’est qu’un prétexte, une bulle où chacun peut s’y retrouver : c’est avant tout la grande force du film de James Gray et qui en fait pour moi son meilleur film à ce jour au-delà de ses thèmes de prédilections toujours présents (rapports familiaux notamment…).
Personnellement le film m’a soulevé, touché réellement (après THE IMMIGRANT qui était un film bien fait mais un cran nettement en-dessous dans sa filmo et qui m’avait laissé de côté).
Se dire aussi qu’à l’heure où tout est rendu possible par la mondialisation et le tout communication, l’aventure, la soif de découvrir était encore possible, palpable il y a 90 ans de cela (dernière expédition de Fawcett)… Gray capte donc à la fois une époque mais réussi à rendre son film intimement contemporain : un vrai tour de force.
A cela s’ajoute une beauté formelle exceptionnelle du grand directeur de la photo qu’est Darius Khondji (lisez son interview dans Positif!). Un chef d’oeuvre à voir absolument.
Je signale en revanche un coffret Potemkine qui pourrait être indispensable l’ensemble Chepitko/Klimov rassemblant les longs des deux cinéastes unis par l’amour et la création.
La cinéaste mourut tragiquement à 40 ans environ d’un accident d’auto et Klimov eut à coeur d’achever les Adieux à Matiora.
Potemkine avait déjà édité le magistral Requiem pour un massacre sur les horreurs perpétrées par les Nazis en Bielo Russie( en russe : Va et regarde , titre plus proche de la force terrible et hallucinée du film) mais on pourra enfin revoir le non moins impressionnant Raspoutine, l’agonie.
A Bertrand.J’ai acheter »Geronimo »de Walter Hill que j’avais vu en salles à l’époque.Fresque pacifique ou nous suivons l’un des derniers chef indiens qui à sut braver les Etats-unis et qui à finit sa vie dans une réserve en Floride.Le film est magnifique sur le plan visuel avec des couchers de soleil couleur abricot,des montagnes rocheuses rouges tel le sang des indiens et des soldats blancs qui fut versés pendant des décénies.Puis la distribution est à la hauteur du talent de Wes Studi(Geronimo),Gene Hackman dans celui du general ou Jason Patrick qui incarne un soldat pacifique qui veut la paix avec la tribu Apaches et essaie de négocier avec Geronimo.Un jour il faudra se pencher sérieusement sur la filmographie de Hill mais aussi du scénariste et réalisateur John Milius qui sont des bons faiseurs.
Géronimo, je crois, a fini sa vie en Oklahoma, à Fort Sill.
« As-tu vu KAPO de Rivette ? Euh… de Pontecorvo » m’as demandé un copain, avec qui nous évoquions la disparition d’Emmanuelle Riva. Un film dont j’ai entendu murmurer le titre une ou deux fois dans ma vie, mais Rivette et Daney sont-ils les seuls responsables de sa dissolution dans un néant quasi absolu ? Je ne pense pas être complètement inculte, pourtant j’ai affirmé que LA 25eme HEURE de Verneuil était la première fiction à traiter de la déportation. Je pense toutefois que l’abjection Rivetto-Daneysienne a fait plus de bien que de mal à un film qui aurait sombré dans un oubli encore plus sombre sans cette polémique. Essentiellement par le choix désastreux de Susan Strasberg, pâle Audrey Hepburn, qui n’exprime ni joie, ni peine, ni crainte, ni espoir, ni tendresse, ni haine, ni dureté, ni faiblesse, la faute à un visage aussi expressif que celui de d’Edith Scob dans Les yeux sans visage lorsqu’elle se masque. La faute à un sujet qui montre l’exacte limite du cinéma quand il s’aventure au-delà de certaines frontières ? Y a-t’il un seul cinéaste au monde qui se soit demandé comment filmer le viol d’un enfant ? A part peut-être Gaspar Noé, ma réponse est catégorique : « Non ! »
A ceux qui m’objectent, un peu comme le fait Ronny Broman dans les suppléments du DVD, qu’un tel sujet doit évidemment faire appel à la subjectivité du public, j’invite à revoir MR KLEIN ou LE PIANISTE, réponses plus radicales à KAPO que le sermon Rivettien, par leurs travellings qui s’arrêtent précisément où le subjectif commence, c’est à dire sur le quai de la gare. Tout au long du film j’ai pensé à une maison de redressement, éventuellement à une usine de textile dans le Nord de la France (un sujet de l’émission Streap tease s’en rapproche) sans doute aux quartiers féminins de la centrale de Clairvaux, mais à Auschwitz, non, sûrement pas. Elie Wiesel avait exprimé une semblable indignation à la sortie de LA LISTE DE SCHINDLER, à propos de la volonté de Spielberg d’avoir recruté des figurants maigres qu’il faisait mettre tout nu devant un médecin du camp, recherchant « l’ effet » comme on le recherche dans un film d’épouvante. A la décharge de Pontecoro, sûrement plus naïf que mal intentionné, on reconnaitra qu’en 1959, la réalité des camps était bien moins documentée qu’elle ne l’est aujourd’hui, la douleur moins enracinée, la culpabilité plus diffuse, et l’histoire loin d’être définitive. Toutefois, j’abonde dans le sens de Broman qui pointe du doigt le caractère religieux de l’article indigné, sans pour autant identifier les mêmes racines que lui, quant à la raison du sermon. En effet, Rivette n’aurait-il pas écrit « Emmanuelle Riva se détache d’elle-même de la colonne des déportées pour se jeter, en appel au secours, dans le public, seul témoin de son calvaire, impuissant à sa mort certaine, mais susceptible de sauver, sinon sa vie, sa mémoire. La clôture électrifiée qui interdit tout échappatoire et provoque sa mort, témoigne autant de l’impuissance à agir contre une telle barbarie, que d’une volonté directe de graver à tout jamais dans notre mémoire ce que fut l’horreur, l’horreur montrée de plein fouet, afin que nous n’oublions jamais. l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme a droit au plus profond respect. »
Ceci, si le film avait été signé Billy Wilder.
Il y à quelques lenteurs qui gâchent un peu cette œuvre assez forte.L’idylle amoureuse entre un soldat nazi et cette jeune juive n’était pas necessaire je pense dans le scénario.Sinon la prestation de la fille de Lee Strasberg est émouvante.Les bonus sont interessant.
Si le message est bientôt diffusé, je conseille à tous les blogueurs de voir le mini cycle Kaurismaki sur Arte réunissant Ariel, L’homme sans passé et Le Havre.
On a tendance à penser que l’univers de Kaurismaki est connu mais comme Almodovar ou Allen la musique kaurismakienne n’empêche pas les surprises d’un film à l’autre tout comme le plaisir des retrouvailles.
Il faut avoir la mauvaise foi des Cahiers du cinéma actuels pour voir dans Le Havre un film réactionnaire ou décoratif: au contraire, les petites gens qui sont les héros du film font simplement preuve de la common decency qui manque tant à un nombre conséquent de postulants à la Présidence en cherchant à s’entraider même si l’un des leurs est un gamin sans papiers. André Wilms y est magnifique avec sa posture, sa voix uniques et il forme un couple très touchant avec Kati Outinen l’actrice fétiche d’AK.Notons que Kaurismaki est comme l’enfant naturel de Bresson et de Tati,c’est dire son sens du cadre, son sens du tempo et la beauté de ses plans amoureusement , patiemment ouvragés.
L’homme sans passé est l’un de ses opus les plus connus qui joue magistralement avec les codes sirkiens et Ariel est un road movie dense et émouvant.
Son dernier film est à l’affiche mais je n’ai pu encore le voir.
A Ballantrae
Vous avez mille fois raison
A Ballantrae
Original, perçant, cocasse et neuf et aussi hélas parfois paresseux et se reposant sur une idée, une situation. J’ai gardé un bon souvenir du film avec Mitchell, un ovni
A Bertrand
Je suis perdu. Le film avec Mitchell?
a Alexandre Angel
De Ferrerri
Je suis moins enthousiaste au sujet d’André Wilms dont je trouve le jeu très forcé.
à A Angel: I LOVE YOU cf https://www.tavernier.blog.sacd.fr/le-cinema-de-dorothy-arzner/comment-page-1/#comment-614690
Merci MB!
Ne manquez pas »Le Havre »qui est diffusée cette semaine sur arte.
Entièrement d’accord avec vous sur ce cinéaste atypique et singulier qu’est Kaurismaki.Empressez vous de voir « De l’autre coté de l’espoir »qui est une ode à la liberté des individus qui fuient la guerre,la misère et la faim.Quand j’entends les discours « racistes »de Mme Le Pen sur le flux migratoire en France ou nous avons acueuillis en 2015 200.000 réfugiés venues de Syrie,de Libye ou d’Irak,elle se trompe une nouvelle fois.J’en ai plus qu’assez des médias tout format confondu qui ont mis en avant des mots tels que: »intégration », »jihadistes » »islamophobie »…Alors qu’approche l’échéance électorale on se réveille avec les « affaires »de corruption de candidats soit disant honnêtes et intègre.On publie même sur le site de la commission de contrôle le patrimoine immobilier des uns histoire de nous donner bonne conscience en glissant un bout de papier dans une urne.Les démocraties ont perdus tout leurs sens de justice sociale et de respect d’étres humains.Je soutiens complétement Philippe Torreton dans sa démarche de dégout profond du système politique en France.Soyons réalistes exigeons l’impossible!!!
Je pense que Bertrand doit ètre en pleine promotion pour la sortie du dvd »Voyage dans le cinéma français ».Je vous conseille un des films qu’à réaliser l’acteur Cornel Wilde »Le sable dans le sang ».Très bon film de guerre avec des scènes de bataille qui à dut inspirer Stone,Copolla ou meme Spielberg.Le bonus est croustillant d’anecdotes dut à Bertrand.Notamment pour un film de cape et d’épée réaliser aussi par Wilde qui prenait un accent français.Il me tarde de découvrir cette pépite ainsi que »La proie nue » ou « Terre brulée »un film de science fiction assez brillant selon Brion.
Il a inspiré aussi et surtout La ligne rouge de Malick.
Naked prey est magnifique et je trouve Terre brûlée moins inabouti qu’on ne l’a dit:des maladresses certes mais aussi des fulgurances et un sentiment élégiaque propre à une conscience écologique réelle.
c’est LE SABLE ETAIT ROUGE/BEACH RED le film de Wilde, le film très moralisateur dans sa fin, de Malick est tiré du même roman de P Bowman, plutôt que inspiré du film précédent.
… le Wilde est vraiment meilleur que l’autre et les scènes de bataille sont revenues à ma mémoire en découvrant Spielberg et le SOLDAT RYAN, mais encore plus Fuller et BIG RED ONE.
Les scènes avec les soldats japonais par contre j’y ai pensé en découvrant IWO JIMA de Eastwood.
ERREUR: les films de Malick et Wilde ne viennent pas du même roman! LA LIGNE ROUGE de Malick c’est un roman de J Jones, LE SABLE ETAIT ROUGE de Wilde c’est bien un roman de Bowman.
Quant au premier il y a une première version de Andrew Marton, un peu confuse (L ATTAQUE DURA 7 JOURS).
et personne ne me corrige ah là là on peut raconter n’importe quoi!
A MB
Oui la version de Martin est une ébauche sommaire qui retient un ou deux points du roman
à Bertrand: Marton restera dans les mémoires pour l’attaque du casino dans LE JOUR LE PLUS LONG, que vous signalez dans 50 Ans, magnifique travelling aérien qui fait sursauter le spectateur assoupi mais il a terminé sa carrière avec FLIPPER LE DAUPHIN… Avant ça j’adore AU PAYS DE LA PEUR/THE WILD NORTH grâce à Wendell Corey (le flic de REAR WINDOW) et aussi car j’adore ce genre d’histoires dans lequel le chasseur est sauvé par le lapin qu’il poursuivait. Il faudrait les recenser, il y a qqs films qui se sont bâtis à partir de cette matrice déjà LA CHEVAUCHEE DU RETOUR de AH Miner.
Mais en passant, que pensez-vous de LA LIGNE ROUGE de Malick?
A MB
Beaucoup de bien
à Bertrand: pas moi! LA LIGNE ROUGE/Malick intéresse lors de l’avancée des soldats dans la brousse puis se résout en un sentimentalisme typiquement mainstream US dans lequel S Penn excelle et Caviezel et son sourire béat adopté par le village d’indigènes c’est inimaginable, ça passe pas. A côté l’amoralisme du « Ligne Rouge » (L ATTAQUE DURA 7 JOURS) de Marton retrouve ma sympathie, le film n’est pas vraiment dirigé mais à qqs moments, Marton signale bien comment le héros passe de l’anodin doux (Dullea est fade) à l »anodin guerrier inconscient, belliciste. Le film laisse une sale impression, l’amoralisme que Marton voulait exprimer quant à la guerre a couçi-couça imbibé le point de vue de la mise en scène?
Je pense que »Terre brulée »de Wilde à beaucoup influençé Fleisher pour « Soleil vert »trois ans plus tard.L’acteur principal ressemble étrangement à Charlton Heston et à été doublé par Jean claude Michel:grande voix disparue en 99.
Vu hier soir soir.3La proie nue »de Cornel Wilde est en effet une oeuvre forte ou un homme blanc est chassé par une tribu de jeunes noirs d’Afrique.L’homme est livré à lui mème face aux serpents,lions,crocodiles,et insectes en tous genres.Malgré la faim et la soif il ne baissera jamais les bras et ira jusqu’à sa »libération »qui était attendu.Je pense que le film à été tourner dans une réserve.Les images sont d’une grande beauté visuelle et donne à ce film une curiosité rare.
Brillant non à mon sens mais à l’avant garde d’une certaine idée de la SF oui.C’est dans la veine des Fils de l’homme de Cuaron lui réellement brillant, visionnaire et déchirant.
Je conseille également de voir ce très beau film « Beach Red » de Cornel Wilde qui ne peut cependant faire oublier à mon sens les plus grandes réussites du genre et notamment « A Walk in the Sun » de Lewis Milestone qui n’est pas sans ressemblance certaine avec le film de Cornel Wilde. Je pense tout particulièrement aux premières scènes de « Beach Red » où l’on voit des soldats américains commandés par Cornel Wilde sur le point de s’embarquer sur des péniches de débarquement en vue de débarquer sur les plages de je ne sais plus quelle île du Pacifique occupée par les troupes japonaises et bien évidemment ces soldats sont assaillis par des pensées, des désirs et des peurs de circonstance. Ce début ne peut pas ne pas faire irrésistiblement penser aux premières scènes du film de Lewis Milestone quasi similaires où les mêmes angoisses, les mêmes désirs et toutes sortes de pensées contradictoires assaillent également nos G.I prêts eux aussi à débarquer d’un instant à l’autre non pas cette fois-ci sur une île du Pacifique mais sur les côtes de l’Italie du Sud, du côté de Salerne, si ma mémoire est bonne. Le superbe noir et blanc du film de Lewis Milestone renforce admirablement son propos – et bien mieux que la couleur un peu délavée du film de Cornel Wilde – dans ces premières scènes de « A Walk in the Sun » où l’on distingue à peine les corps de tous ces soldats collés les uns aux autres sur le pont de leur navire et où seule émerge de ces corps indistincts leur propre voie qui se veut plus que leur corps l’expression même de leurs désirs et de leurs angoisses. Il faut aussi voir le film de Cornel Wilde comme l’un des premiers films de guerre américains à ma connaissance à avoir traité sur un même pied d’égalité pour ainsi dire les combattants japonais et leurs adversaires américains, ce qui ne va pas parfois selon moi sans un peu de naïveté dans la mise en scène de son réalisateur, notamment dans les dernières scènes de son film.
A JP RASTELL
A WALK IN THE SUN que j’ai chroniqué est une adaptation très fidèle du roman de Harry Brown (DU HAUT DES CIEUX LES ETOILES) qui porte le même titre. Le style est toutefois plus littéraire, plus écrit, moins quotidien. Et vous avez eu du bol de voir un beau noir et blanc parce que pendant des décennies on a eu droit à des copies film et VHS du domaine public, toutes plus horribles les unes que les autres. Je crois avoir signalé la meilleure sortie chez VCI et il FAUT voir de Milestone OF MICE AND MEN qui a été aussi restauré
à JP Rastell: 100% d’accord sur LE SABLE ETAIT ROUGE, je ne crois pas qu’on puisse faire remonter à plus tôt dans un film guerrier US ce souci de réelle égalité entre Américains et leurs adversaires ou du moins ce regard respectueux sur ceux-ci, respectueux et pas bienveillant (quoique certains films des 20 ou 30 pourraient me surprendre encore parmi ceux que je n’ai pas vus!), j’ai perçu la naïveté aussi d’ailleurs mais comme un culot, un refus de la convention. Il y aurait beaucoup à dire sur la prétendue naïveté de certains films perçue par des esprits forts comme disneyienne alors que.
A MB
Et le film est tourné en pleine guerre du Vietnam et les Japonais représentent une autre race
LE SABLE ETAIT ROUGE, à Bertrand: exact: 1967!
Il y a une réelle naïveté dans BEACH RED, mais elle participe du charme étrange d’un film qu’il faut, pour l’apprécier, prendre tel qu’il est dans son tout sans trop s’attarder sur les détails. Parfois, ce qui surprend dans une œuvre se résume au simple fait qu’elle existe. C’est le cas, je trouve, avec BEACH RED. Cela dit LA PROIE NUE est sensiblement supérieur.
Pardon pour Dorothy que je découvrirai qui sait dans une vie prochaine, mais je ne peux résister à exprimer mon impression sur TROIS HUIT, un film de Philippe Legay, d’une justesse glaçante sur les rapports humains dans le milieu du travail ouvrier. A l’usine, arrive un nouveau, il va être la victime d’un harceleur pathologique, sans que ses collègues ne fassent rien pour lui venir en aide. A la lecture du sujet, on peut croire que le bourreau est un chef d’équipe ou un membre de la direction, il n’en est rien, c’est un simple camarade de travail. Le harceleur, dans sa logique à vouloir détruire méthodiquement, planifiant chacune de ses attaques contre le collègue sans défense, est une représentation terrifiante, et magnifiquement interprétée, de ce que peut être la prédation. L’apparente absence de motivation en dit beaucoup plus sur la souffrance au travail, que ce qui a été théorisé sur le sujet. On ne voit jamais la hiérarchie, le film se concentrant uniquement sur les ouvriers, parmi lesquels le harceleur dont on apprend qu’un poste de responsable lui a été refusé. Ainsi la pression que ces invisibles exercent sur lui, il doit la relâcher sur un plus faible. Qui a travaillé en usine ne pourra contester la justesse du portrait, la vérité des dialogues, encore moins la logique des camarades de travail qui refusent de réagir au calvaire vécu par le nouveau. Un nouveau qu’on ne connait pas et qu’on n’a donc aucune raison de défendre sous les coups d’un collègue, au nom de cette solidarité ouvrière, dont voici le côté pile de ce que le cinéma militant d’un Marin Karmitz avait exprimé, avec quelques fantasmes. J’ai pensé à The glass house, saisissant film de Tom Gries sur le harcèlement en milieu carcéral. Le milieu dans lequel nous immerge le film est un miroir beaucoup plus direct que celui de la prison. Ce que montre Legay est vrai ! Le final ne clôture pas l’histoire, il l’ouvre au contraire sur des possibilités encore plus terrifiantes. Un film qui enseigne autant, et complète par les faits, les conférences et les écrits de Christophe Dejours.
Il y à quelques fois au cinéma des nouvelles versions ratées et sans intérêts comme par exemple « Le sac de billes »sortie récemment.Ce n’est pas le cas du nouveau film de Nicolas Boukrief(le précedent fut censurer sur les écrans) »La confession »revient sur l’histoire de cette femme communiste et résistante durant l’occupation allemande et tomba amoureuse d’un prètre.Romain Duris efface complétement le jeu de Belmondo dans l’œuvre de Melville.Le personnage est emplit d’ambiguité face au regard de cette jeune femme dont le mari est prisonnier en Allemagne.Lui aussi d’une certaine façon résiste à la tentation de la chair et se réfugie dans l’évangélile selon Saint Mathieu et Saint Luc.Marina Vacht est surprenante de naturel ,elle la communiste convaincue qui refuse de croire en dieu.Le seul point faible sur le plan technique de la mise en scènes sont les séquences intérieures qui sont d’un jaune pisseux.Apparemment Boukrief à dut utiliser un filtre afin d’atténuer les scènes qui rendent une certaine légereté à l’image définie.En tout cas du bel ouvrage comme dirait Bertrand.Second film à voir,c’est la première réalisation de l’acteur Nicolas Bedos »Mr et Mme Atelman »co-écrit avec Dorah Tellier.Le film défile entre 1971 et 2016 à une vitesse folle.Rencontre,mariage,enfants,séparation,maladie de deux ètres à l’opposé l’un de l’autre mais qui vont s’aimer jusquà la fin.Quelle fluidité dans la narration puis toutes les scènes sous jacentes comme le repas de Noel au début du film qui est d’une drolerie inouie.Puis il y à il faut reconnaitre un très bon travail sur les dialogues,la reconstitution de l’époque avec les musiques qui jouent un role déterminant dans le rendu.Voilà comme disait Claude Piéplu »C’est tout pour aujourd’hui ».
Je conseille à tous le coffret avec plusieurs court-métrage et long du cinéaste Walerian Borowycz(peut ètre j’écorche son nom)et notamment »La bète »et »Les contes immoraux ».Réalisateur venu du cinéma d’animation dans les années 60,il n’a à mon humble avis pas trouver de défenseur ici en France,pourtant ses œuvres minitieuses caractérise un cinéaste inventif à plusieurs niveaux(c’est lui qui construisait les petits décors de ses films avec un souci du détail impressionnant).Merci à François Angelier et Philippe Rouyer dans »Mauvais genres »qui lui ont consacré un bel hommage.
A Yves Rouxel,
C’est terrible, lorsqu’il y a de beaux coffrets qui sortent, notamment chez Carlotta et Potemkine, que je passe à l’acte ou pas, je suis la plupart du temps client et je salive rien que d’y penser, mais là, je ne suis pas du tout attiré par le Borowczyk! Ai-je tort?
Par curiosité, j’ai également acheté ce coffret avec les films de ce réalisateur polonais proche du surréalisme, il est vrai assez oublié aujourd’hui (faute à une fin de carrière médiocre : voir l’article de Positif du mois dernier) et dont rend hommage cette sortie accompagnant une rétrospective au centre Pompidou (Michel Ciment y présentera par exemple HISTOIRE d’UN PÉCHÉ…).
Ses courts métrages avaient semblent-il marqué l’époque et ses longs choqué le bourgeois par un érotisme totalement assumé. Peut-être que Bertrand ou d’autres intervenants pourront donner leur avis sur des films déjà vus.
J’ai démarré pour ma part par BLANCHE réalisé en 1975 : volontairement théâtral (on apprend dans les bonus que Borowczyk voulait retranscrire à l’écran les enluminures moyenâgeuses faites d’aplats dans les descriptions de scènes) et d’une sobriété pouvant en apparence rebuter. C’est pourtant un conte macabre où les tensions de rivaux amoureux aboutissent à une série de morts et suicides qui ne seront d’ailleurs jamais appuyés par la réalisation mais non moins implacables… Le choix des décors et costumes y est très minutieux. Ajoutons à cela un beau casting allant de Michel Simon à Georges Wilson en passant par Jacques Perrin. Un film décontenançant (et peut-être moins abouti que ses suivants d’après les critiques de l’époque) mais que j’ai trouvé assez original (quand Bunuel rencontre Rohmer en quelque sorte !)
J’ai un souvenir un peu vague des longs qui me semblaient très inégaux: si Goto et Blanche étaient des objets ciselés et étranges, Contes immoraux et La bête me semblaient hésiter entre raffinement décadent et série Z.
Ses films d’animation sont par contre assez fabuleux et proches du degré de réussite des films de Jan Svankmajer.
Cependant, vous me donnez envie de vérifier …un point m’arrête: le coût du coffret!
J’ai découvert »La bète » qui est une œuvre étrange qui flirte aisément avec le pornographique dans le déroulement de l’histoire.D’entrée de jeu,on voit un cheval en érection nerveux qui va prendre une jument.Le réalisateur filme des gros plans du sexe du cheval ainsi que du sexe de la jument.La suite est une succession de scènes assez absurde ou l’on reconnait Guy Tréjean et Roland armontel dans un fauteuil roulant dans un château ou l’on croise un prètre qui embrasse un jeune homme sur la bouche.Bon j’en resterais là car il se dégage un coté malsain et inutile dans ce genre d’œuvre.
« Le sherif d’el soldito »réalisé par George Sherman est un western de bonne facture.Guy Madison qui avait le physique d’Alan Ladd incarne au début du film un chasseur de primes sans pitié qui tue tous les bandits qu’il doit rattraper.La photographie est d’une grande luminosité dut au décors naturel du tournage.Le dvd est sorti l’an passé grace à Alain Carradore et son équipe et Patrick Brion à la barbe blanche façon Buffalo Bill apporte sa pièrre blanche à ce western.
« Une sale histoire »de Jean Eustache est une œuvre invisible diffusée par Arte en 2000 il me semble.Jean noel Pick,l’auteur de ce scénario décousue et non moins interessant est d’abord narrer par Michael Lonsdale.L’histoire d’un gars en 68 qui fréquentait un bar rue de Clichy à Paris et qui fut le témoin durant de longues semaines de scènes hallucinantes et perverses.En effet un jour,il entendit de jeunes consommateurs de bar,évoquaient un trou au sous sol près des toilettes féminines.Il descendit se mit à genoux,les avants bras repliés façon prière musulmane,colla sa joue sur le sol et vu de ses yeux un sexe féminin.Ce rituel devient au fil des jours une habitude qui se transforma en addiction car certains jours des fidèles du bar se pressaient de descendre aux toilettes.Comme le précise le personnage,au premier abord quand on voit une belle femme on regarde sa silhouette,ses yeux,la couleur de ses cheveux mais on ne pense pas à la forme de son sexe.Un jour il aborde une mannequin style cover-girl et l’invite à boire plusieurs bières et du thé car ce sont des boissons qui font uriner.Tout d’un coup elle se lève ,se dirige vers les toilettes.Il la suit discrètement afin de visionner »la chose »puis remonte au bout d’une poignée de secondes dégouter par le sexe de cette fille qui était hideux et ne correspondait pas du tout à sa plastique.Il est dommage et regrettable à la fois de ne pas avoir accès aux autres court-métrage,moyen et long de ce cinéaste atypique et captivant.Je me contenterais du livre Luc Beraud.
Ce ne me semble pas le meilleur Eustache car uniquement film de « dispositif » sans comparaison avec la densité littéraire de Mes petites amoureuses et La maman et la putain.
C’est le fils Eustache qui bloque les droits avec acharnement, privant de leur découverte nombre de spectateurs qui aimeraient certainement.Il faut donc les guetter au gré des rares diffusions TV.
Bon, et bien je viens de voir MERRILY ME GO TO HELL, mon premier Dorothy Arzner. J’ai été frappé par l’élégance étouffée (comme on dirait « à l’étouffée »)du style de la réalisatrice. Il y a certes des ruptures de ton mais elles ne font pas de tintamarre, se déroulent dans la fluidité et la discrétion, avancent à pas feutrés. C’est que le climat général est, sinon dépressif, du moins emprunt d’une amertume dont je ne parviens pas à trouver d’équivalence. Il y a quelque chose de douloureux dans ce film, une souffrance diffuse, un goût de suicide, une émanation de fêlures sans que l’on en connaisse forcément les tenants (j’ai vu le film sans sous-titres). Comme le dit précisément Bertrand, les séquences se succèdent « dans un nuage d’alcool » qui trouble le spectateur (l’adjectif « troublant » est employé par Antoine Royer)l’embarrassent. La scène où Fredric March ne trouve plus l’anneau qu’il doit passer au doigt de Sylvia Sidney met presque mal à l’aise et le moment où il flanque par terre la dinde que vient de cuisiner son épouse n’est drôle que sur le papier. C’est tout juste si l’on se sent pas les haleines chargées d’alcool. Outre Fredric March, que je redécouvre complétement et Sylvia Sidney, qui serre le cœur et ravit les yeux, on trouve les remarquables Adrianne Allen (l’ex)et George Irving (le père de Sylvia Sidney)qui contribuent à animer le film de dialogues non pas susurrés, comme chez Tourneur, mais égrenés, sans embardées, ni haussement de ton, au diapason d’une atmosphère plus clinique que réellement mélodramatique.
A Alexandre Angerl
Merci, c’est magnifique. Je pourrais et devrais vous citer
Merci Bertrand et désolé pour la faute dans le titre (il fallait lire WE et non ME).
A Bertrand.Dans le numero de mars du mensuel »les années lazer »vous affirmé qu’il n’y à plus sur le service public d’émissions consacré au cinéma et vous citer »Le cinéma de minuit »cher à Patrick Brion qui est toujours programmé à pas d’heures c’est vrai.J’attends le dvd du film de Jean Vallée avec impatience.Signalons un très bel article signé Bernard Achour qui revient sur les personnages des Indiens dans les westerns(j’avais oubliés qu’Yvette Duguay était marseillaise!!).
à A Angel: autrement dit, l’alcoolisme est dans la mise en scène à travers des moyens pas toujours utilisés (plus souvent utilisé: la caméra qui tremble…), là, on a l’avancée diffuse de l’emprise alcoolique, bravo encore! J’ai pensé à Tourneur en lisant vos premières lignes, après vous montrez comment ça s’en éloigne, au niveau de la diction, des voix en général. Bon, ça s’en éloigne mais c’est cousin.
c’est le dvd zone 1?
A MB
L’alcoolisme est moins dans les effets (il y a juste une image floue subjective à un moment) que dans une atmosphère posée comme telle dès le départ (les gens boivent, en général, dans le film). Il n’y a pas vraiment de progression, c’est là dès le début. Rien à voir avec THE LOST WEEK-END. Pas de cauchemar, ni de descente aux enfers au sens conventionnel du terme. Antoine Royer, sur Dvdclassik, fait rebondir avec pertinence la personnalité duelle de Fredric March (il est par moment exaspérant) avec celle du Docteur Jeckyll et de Mister Hyde qu’il interprétait un an plus tôt.
Vu sur YouTube la copie du dvd Universal : image et son excellents.
à A Angel: merci je crois que je vais tenter un coffret américain qui donne d’autres films en + (avec stf!) à moins que je ne cède à la curiosité et le découvre comme vous.