Films noirs
27 juillet 2011 par Bertrand Tavernier - DVD
 Cela fait déjà un bout de temps que je voulais signaler le deuxième coffret Columbia Film Noir Classics 2. Je ne me souviens même plus si j’ai parlé du premier, FILM NOIR CLASSICS NOIR I (sous titres anglais). Même si c’est le cas je peux revenir sur le très méconnu THE SNIPER (l’HOMME A L’AFFUT) d’Edward Dmytryk, étude forte, pleine de compassion d’un tueur en série qui abat les femmes avec un fusil à mire télescopique. Il lutte contre ses pulsions, tente de se bruler, de se mutiler pour arrêter. Chaque fois que je vois ce film, je me demande si les scénaristes de DIRTY HARRY ne s’étaient amusés à prendre le contrepied systématique de la morale, de la démarche humaniste de THE SNIPER. Utilisant la même ville (San Francisco), ils montraient un tueur abject, refusaient tout alibi médical et Eastwood jouait un personnage aux antipodes de l’inspecteur Kafka que brosse Adolphe Menjou. Il est passionnant en tout cas d’opposer les deux films. Dmytryk utilise aussi brillamment que Siegel les décors naturels (je n’ai jamais oublié cette immense cheminée d’usine avec cet ouvrier qui repère le tueur), joue avec des plans longs (le premier meurtre), évite toute complaisance dans la description de la violence. Les scènes de police font preuve d’une rudesse peu commune à l’époque.
Cela fait déjà un bout de temps que je voulais signaler le deuxième coffret Columbia Film Noir Classics 2. Je ne me souviens même plus si j’ai parlé du premier, FILM NOIR CLASSICS NOIR I (sous titres anglais). Même si c’est le cas je peux revenir sur le très méconnu THE SNIPER (l’HOMME A L’AFFUT) d’Edward Dmytryk, étude forte, pleine de compassion d’un tueur en série qui abat les femmes avec un fusil à mire télescopique. Il lutte contre ses pulsions, tente de se bruler, de se mutiler pour arrêter. Chaque fois que je vois ce film, je me demande si les scénaristes de DIRTY HARRY ne s’étaient amusés à prendre le contrepied systématique de la morale, de la démarche humaniste de THE SNIPER. Utilisant la même ville (San Francisco), ils montraient un tueur abject, refusaient tout alibi médical et Eastwood jouait un personnage aux antipodes de l’inspecteur Kafka que brosse Adolphe Menjou. Il est passionnant en tout cas d’opposer les deux films. Dmytryk utilise aussi brillamment que Siegel les décors naturels (je n’ai jamais oublié cette immense cheminée d’usine avec cet ouvrier qui repère le tueur), joue avec des plans longs (le premier meurtre), évite toute complaisance dans la description de la violence. Les scènes de police font preuve d’une rudesse peu commune à l’époque.
On retrouve Siegel pour le remarquable the LINE UP qui démarre un peu mollement (Siegel se bagarra pour changer ce début mais le producteur à qui ont doit la série TV du même nom, voulait montrer la police).
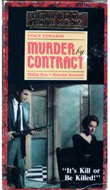 MURDER BY CONTRACT est d’une rare sécheresse mais je me suis toujours demandé si ce ton dépouillé, dégraissé, surprenant dans son refus de la scène à faire, ne venait pas autant des manques d’Irving Lerner (qui apparaitront dans ses films suivants) que de ses qualités : une certaine platitude dans les cadres, les plans qui contredit des options souvent intelligentes. Le scénariste Ben Maddow (non crédité) a du aussi jouer un rôle important. Inutile de s’étendre sur REGLEMENT DE COMPTE, le meilleur Fritz Lang de la décennie.
MURDER BY CONTRACT est d’une rare sécheresse mais je me suis toujours demandé si ce ton dépouillé, dégraissé, surprenant dans son refus de la scène à faire, ne venait pas autant des manques d’Irving Lerner (qui apparaitront dans ses films suivants) que de ses qualités : une certaine platitude dans les cadres, les plans qui contredit des options souvent intelligentes. Le scénariste Ben Maddow (non crédité) a du aussi jouer un rôle important. Inutile de s’étendre sur REGLEMENT DE COMPTE, le meilleur Fritz Lang de la décennie.
FIVE AGAINST THE HOUSE est assez bavard et statique après de bonnes scènes d’introduction où je retrouve la patte du scénariste dialoguiste William Bowers. Dans ces échanges de vannes rapides, souvent drôles mais qui deviennent ici trop systématiques (chez De Toth, Dick Powell, Parrish, Bowers changeait de ton et de style). De plus cette nervosité n’est pas très bien servie par des acteurs trop âgés pour ces étudiants qu’ils sont censés jouer, trop placides comme Madison ou Matthews. Brian Keith lui s’en sort nettement mieux. Je me demande si Phil Karlson n’a pas été paralysé par l’autre scénariste Stirling Silliphant qui produisit le film et donc protégea son scénario. Il serait intéressant de voir quelle est la part respective de ces deux écrivains. On peut penser que Silliphant vint en premier et que Bowers qui avait travaillé avec Karlson (ils se retrouvèrent sur TIGH SPOT) vint dynamiser le dialogue et l’épicer. Quelques plans réussis dans le hold-up final, un décor – ce garage avec ces ascenseurs- bien utilisé, un long plan en mouvement qui traverse tout le casino pour aboutir à la pièce où William Conrad range son chariot rompent la monotonie terne du film. Comme toujours, dans tous les films, une chanteuse de bar (Kim Novak doublée bien sur) ne chante qu’une seule chanson…
 FILM NOIR CLASSICS II (sous titres anglais) nous offre HUMAN DESIRE, le remake de la BÊTE HUMAINE par Lang qui m’avait plu, CITY OF FEAR d’Irving Lerner, le très élégant PUSHOVER de Richard Quine, variations plus tendres, plus sentimentales sur ASSURANCES POUR LA MORT. Comme le notait Godard, un mouvement de camera était juste destiné à nous montrer que Kim Novak ne portait pas de soutien gorge. J’avoue avoir un faible pour ce film et pour tous ceux que Quine fit avec Kim Novak. On le sent admiratif, amoureux, conquis par son actrice (qui le planta le jour de leur mariage, le détruisant).
FILM NOIR CLASSICS II (sous titres anglais) nous offre HUMAN DESIRE, le remake de la BÊTE HUMAINE par Lang qui m’avait plu, CITY OF FEAR d’Irving Lerner, le très élégant PUSHOVER de Richard Quine, variations plus tendres, plus sentimentales sur ASSURANCES POUR LA MORT. Comme le notait Godard, un mouvement de camera était juste destiné à nous montrer que Kim Novak ne portait pas de soutien gorge. J’avoue avoir un faible pour ce film et pour tous ceux que Quine fit avec Kim Novak. On le sent admiratif, amoureux, conquis par son actrice (qui le planta le jour de leur mariage, le détruisant).
NIGHTFALL commence très bien et toutes les premières séquences, cette rue qui s’allume, la rencontre d’Aldo Ray et d’Anne Bancroft, la découverte de James Gregory, témoignent du talent unique, si personnel de Jacques Tourneur. Un passage à tabac près de derricks est un moment anthologique et l’apparition de la neige dans un film noir surprend comme dans TIREZ SUR LE PIANISTE. Malheureusement le sujet, tiré d’un roman de David Goodis, fait long feu. Cette histoire d’agent enterré ne tient pas la route, reste trop sommaire. Le pognon est une motivation qui peut facilement devenir abstraite si elle n’est pas relayée par des personnages forts et originaux. Malgré Brian Keith, toujours parfait et Aldo Ray, on reste désespérément à la surface.
 Je viens de revoir les FRERES RICO que j’ai trouvé original, troublant. Le coté aseptisé des décors, l’atmosphère de la Floride, les costumes, le refus de tout expressionnisme dans la photo et les cadrages au profit d’une grisaille visuelle, renforcent paradoxalement la tension, surtout dans la deuxième partie. Tout paraît quotidien ce qui rend d’autant plus choquant la présence, l’irruption de la violence. La description de la Maffia est dépourvue de tout romantisme. Tous ceux que rencontre Richard Conte parlent doucement, de manière tranquille et la manière dont les acteurs sous jouent ces situations, en augmente la menace et l’inéluctabilité.). La rencontre entre Eddie et Johnny est oppressante et les premiers plans larges nocturnes – des voitures dans la nuit, la sortie de Johnny – prennent une force rare. Le retournement qui révèle la vraie nature de Kulik, nous prend par surprise : le côté anonyme, rassurant du décor, ce couloir d’hôtel, cette chambre à la porte de laquelle on cogne, rien ne nous prépare à ce que l’on découvre, la vision de cet homme torturé, qui est expédiée en quelques plans rapides, concis, dépourvus de gesticulation et d’effets visuels. Ce traitement donne une quotidienneté à la séquence qui décuple son côté effrayant. En revoyant le film, j’ai été frappé par la sensualité, la chaleur des rapports unissant Eddie Rico (Richard Conte toujours formidable) et Diane Foster dans les premières séquences que mon ami Coursodon trouve un peu bavardes. En fait le film est plus proche de THE NICKEL RIDE que de THE GODFATHER et l’on peut juste regretter une fin bâclée : une manchette de journaux et une scène rassurante qui arrive comme des cheveux sur la soupe.
Je viens de revoir les FRERES RICO que j’ai trouvé original, troublant. Le coté aseptisé des décors, l’atmosphère de la Floride, les costumes, le refus de tout expressionnisme dans la photo et les cadrages au profit d’une grisaille visuelle, renforcent paradoxalement la tension, surtout dans la deuxième partie. Tout paraît quotidien ce qui rend d’autant plus choquant la présence, l’irruption de la violence. La description de la Maffia est dépourvue de tout romantisme. Tous ceux que rencontre Richard Conte parlent doucement, de manière tranquille et la manière dont les acteurs sous jouent ces situations, en augmente la menace et l’inéluctabilité.). La rencontre entre Eddie et Johnny est oppressante et les premiers plans larges nocturnes – des voitures dans la nuit, la sortie de Johnny – prennent une force rare. Le retournement qui révèle la vraie nature de Kulik, nous prend par surprise : le côté anonyme, rassurant du décor, ce couloir d’hôtel, cette chambre à la porte de laquelle on cogne, rien ne nous prépare à ce que l’on découvre, la vision de cet homme torturé, qui est expédiée en quelques plans rapides, concis, dépourvus de gesticulation et d’effets visuels. Ce traitement donne une quotidienneté à la séquence qui décuple son côté effrayant. En revoyant le film, j’ai été frappé par la sensualité, la chaleur des rapports unissant Eddie Rico (Richard Conte toujours formidable) et Diane Foster dans les premières séquences que mon ami Coursodon trouve un peu bavardes. En fait le film est plus proche de THE NICKEL RIDE que de THE GODFATHER et l’on peut juste regretter une fin bâclée : une manchette de journaux et une scène rassurante qui arrive comme des cheveux sur la soupe.
Présentation souvent trop courte, trop sommaire de Martin Scorcèse dont le nom et la Fondation aidèrent la sortie de ces coffrets. Je n’ai pas regardé ce que Michael Mann dit de the BIG HEAT et Christopher Nolan de The LINE UP.
Anthony Mann
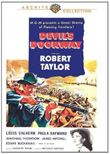 Warner Archive vient de sortir plusieurs Anthony Mann majeurs, un très grand western, DEVIL’S DOORWAY et, puisqu’on parle des films noirs, le très remarquable de TALL TARGET qui raconte les efforts d’un policier, John Kennedy, pour déjouer un complot pour assassiner Lincoln avec un fusil à mire télescopique. En principe, nous sommes à l’époque du western mais tout dans le traitement – la photo très altonienne de Paul Vogel, le style de la mise en scène, le climat, l’atmosphère, l’utilisation du décor, ce train et ces gares dans la nuit, la présence et le jeu de Dick Powell – nous renvoie au film noir. Je le place dans mon panthéon des films de train, avec L’ÉNIGME DU CHICAGO EXPRESS, BERLIN EXPRESS et il est amusant de voir comment chacun de ses metteurs en scène a su se servir des vitres, à la fois comme un autre écran ou un miroir
Warner Archive vient de sortir plusieurs Anthony Mann majeurs, un très grand western, DEVIL’S DOORWAY et, puisqu’on parle des films noirs, le très remarquable de TALL TARGET qui raconte les efforts d’un policier, John Kennedy, pour déjouer un complot pour assassiner Lincoln avec un fusil à mire télescopique. En principe, nous sommes à l’époque du western mais tout dans le traitement – la photo très altonienne de Paul Vogel, le style de la mise en scène, le climat, l’atmosphère, l’utilisation du décor, ce train et ces gares dans la nuit, la présence et le jeu de Dick Powell – nous renvoie au film noir. Je le place dans mon panthéon des films de train, avec L’ÉNIGME DU CHICAGO EXPRESS, BERLIN EXPRESS et il est amusant de voir comment chacun de ses metteurs en scène a su se servir des vitres, à la fois comme un autre écran ou un miroir
 Encore un cadre historique et un même climat tout aussi noir, tout aussi éloigné des films d’époque traditionnels avec REIGN OF TERROR (ou THE BLACK BOOK : LE LIVRE NOIR) revu avec délectation. Il n’y a pas un plan, un cadre qui ne soit pas surprenant, aigu, violent. Evidemment la description de la Révolution française est sujette à caution. C’est Saint Just qui paraît le plus caricaturé, le plus simplifié et l’on peut sourire devant le fait que Tallien nous soit présenté (avec une certaine ironie) comme un honnête homme et La Fayette (dont le rôle fut calamiteux, sans parler de tous ses revirements) comme un sauveur potentiel. Les soldats dans les rues se conduisent comme les nazis ou les communistes dans les films de l’époque. Mais étrangement, Mann parvient à saisir une paranoïa, même dans la description de Robespierre qui semble recouper partiellement les études si brillantes de Jean Philippe Domecq dont je conseille Robespierre, derniers temps, 1984 (Prix « 1984 »), 2002, et 2011: édition augmentée de « La Littérature comme acupuncture ». Cette peur que Robespierre devienne dictateur, qu’il élimine une partie de la Convention, était fort répandue même si les faits contredisent cette impression. La rumeur était plus forte et Mann filme cette rumeur. Son travail est si brillant qu’il semble dynamiser les comédiens de Basehart à Charles McGraw : Arlène Dahl qui dit dans le commentaire avoir eu 19 ans durant le tournage, n’a jamais été meilleure ni plus belle et Robert Cummings est un héros tout à fait acceptable. Avec l’aide du génial décorateur William Cameron Menziès, il se joue du manque de moyens, invente des cadrages ultra stylisés, place en avant plan un moulin aux énormes proportions, utilise de fausses perspectives, l’exiguïté des décors pour renforcer le sentiment d’oppression, d’étouffement. Il ne faut acheter que le dvd de VCI (en double programme avec l’amusant AMAZING Mr X de Bernard Vorhaus). Il s’agit et de loin, de la meilleure édition même si elle n’est pas parfaite. J’en ai vu d’autres qui étaient honteuses et où on ne retrouvait rien de la photo géniale de John Alton.
Encore un cadre historique et un même climat tout aussi noir, tout aussi éloigné des films d’époque traditionnels avec REIGN OF TERROR (ou THE BLACK BOOK : LE LIVRE NOIR) revu avec délectation. Il n’y a pas un plan, un cadre qui ne soit pas surprenant, aigu, violent. Evidemment la description de la Révolution française est sujette à caution. C’est Saint Just qui paraît le plus caricaturé, le plus simplifié et l’on peut sourire devant le fait que Tallien nous soit présenté (avec une certaine ironie) comme un honnête homme et La Fayette (dont le rôle fut calamiteux, sans parler de tous ses revirements) comme un sauveur potentiel. Les soldats dans les rues se conduisent comme les nazis ou les communistes dans les films de l’époque. Mais étrangement, Mann parvient à saisir une paranoïa, même dans la description de Robespierre qui semble recouper partiellement les études si brillantes de Jean Philippe Domecq dont je conseille Robespierre, derniers temps, 1984 (Prix « 1984 »), 2002, et 2011: édition augmentée de « La Littérature comme acupuncture ». Cette peur que Robespierre devienne dictateur, qu’il élimine une partie de la Convention, était fort répandue même si les faits contredisent cette impression. La rumeur était plus forte et Mann filme cette rumeur. Son travail est si brillant qu’il semble dynamiser les comédiens de Basehart à Charles McGraw : Arlène Dahl qui dit dans le commentaire avoir eu 19 ans durant le tournage, n’a jamais été meilleure ni plus belle et Robert Cummings est un héros tout à fait acceptable. Avec l’aide du génial décorateur William Cameron Menziès, il se joue du manque de moyens, invente des cadrages ultra stylisés, place en avant plan un moulin aux énormes proportions, utilise de fausses perspectives, l’exiguïté des décors pour renforcer le sentiment d’oppression, d’étouffement. Il ne faut acheter que le dvd de VCI (en double programme avec l’amusant AMAZING Mr X de Bernard Vorhaus). Il s’agit et de loin, de la meilleure édition même si elle n’est pas parfaite. J’en ai vu d’autres qui étaient honteuses et où on ne retrouvait rien de la photo géniale de John Alton.
Toujours d’Anthony Mann, Wild Side va sortir le magnifique INCIDENT DE FRONTIERE.
WARNER ARCHIVES
 Les archives de la Warner Archives viennent de distribuer un grand nombre de titres jusque là rares : I DIED A THOUSAND TIMES de Stuart Heisler, le remake de High Sierra que le scénariste WR Burnett préférait presque à l’original. Il admirait le travail d’Heisler qui lui, déplorait qu’on lui ait imposé Shelley Winters et Jack Palance (là, il avait tort).
Les archives de la Warner Archives viennent de distribuer un grand nombre de titres jusque là rares : I DIED A THOUSAND TIMES de Stuart Heisler, le remake de High Sierra que le scénariste WR Burnett préférait presque à l’original. Il admirait le travail d’Heisler qui lui, déplorait qu’on lui ait imposé Shelley Winters et Jack Palance (là, il avait tort).
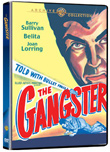 THE GANGSTER est un film très littéraire où Daniel Fuchs adapte (avec dit-on la complicité de Dalton Trumbo), son excellent roman, Low Company. Cette chronique truffée de notations subtiles, amères, lyriques, dramatise les derniers jours d’un gangster peu à peu supplanté par des rivaux plus puissants. Le ton noir, pessimiste, explique l’obscurité de ce film, redécouvert récemment et qui fut réalisé par Gordon Wiles, le décorateur d’Albert Lewin. Nulle misogynie dans cette œuvre, écrite au départ pour John Garfield. Barry Sullivan y est excellent. A découvrir d’urgence.
THE GANGSTER est un film très littéraire où Daniel Fuchs adapte (avec dit-on la complicité de Dalton Trumbo), son excellent roman, Low Company. Cette chronique truffée de notations subtiles, amères, lyriques, dramatise les derniers jours d’un gangster peu à peu supplanté par des rivaux plus puissants. Le ton noir, pessimiste, explique l’obscurité de ce film, redécouvert récemment et qui fut réalisé par Gordon Wiles, le décorateur d’Albert Lewin. Nulle misogynie dans cette œuvre, écrite au départ pour John Garfield. Barry Sullivan y est excellent. A découvrir d’urgence.
99 RIVER STREET est l’un des plus grandes réussites de Phil Karlson auquel le film noir doit beaucoup (THE PHOENIX CITY STORY, LE 4ÈME HOMME qui sort chez Wild Side et qui partage avec L’AFFAIRE DE LA 99ème RUE le goût pour les seconds rôles hauts en couleur) qui nous entraîne dès l’ouverture dans un monde de faux semblants, dans une intrigue labyrinthique où le metteur en scène joue à mettre en abymes les émotions qui sous tendent son récit (étonnante scène du théâtre). Au passage, il réussit une de ses bagarres teigneuses qui sont une de ses marques de fabriques : John Payne et Jack Lambert saccagent littéralement un petit appartement. Brad Dexter joue un tueur cauteleux à l’effroyable sourire et Jay Adler un impitoyable recéleur. Dans le 4ème HOMME, John Payne affrontait Jack Elam, Neville Brand, Lee Van Cleef et Preston Foster.

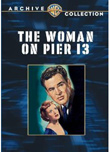 THE WOMAN ON PIER 13 est d’abord un film anti communiste. Son titre fut longtemps, I MARRIED A COMMUNIST et Howard Hughes en proposait le scénario aux réalisateurs sous contrat pour tester leur patriotisme. Losey le refusa, Nicholas Ray ne dit pas non, John Cromwell prétendit être tellement enthousiaste que ses demandes firent exploser le budget et on lui retira la préparation, sans que cela le mette sur une liste noire. Disons le tout de suite, le film est anthologique. Les communistes sont identifiés aux plus vils gangsters et on ne les rencontre que dans des lieux de plus en plus obscurs et souterrains. Leur plan paraît totalement inepte (pourquoi veulent ils fermer le port), incompréhensible et il est impossible de comprendre, de saisir ce qu’ils veulent. Le film dépense beaucoup d’énergie pour qu’on ne puisse jamais comprendre leurs motivations, leur idéologie. Chaque fois qu’ils parlent, ce qu’ils disent est traité en une suite de plans musicaux où l’on n’entend pas le dialogue. Leurs adversaires sont tout aussi dépourvus d’arguments : on ne dénonce pas les camps russes, l’antisémitisme. Qu’on ne cherche pas une idée politique. Les communistes sont traités de manière plus abstraite, plus vide que dans le brillant I WAS A COMMUNIST SPY FOR THE FBI de Gordon Douglas, qui gagna l’Oscar du documentaire (sic) pour une histoire totalement fausse. Mais la présence de Robert Ryan, la photo sublime de Nicolas Musuracca nous ramène au film noir. Et de nombreux détails sont ultra révélateurs et témoignent avant tout de la mentalité des auteurs, de leurs préjugés : une femme communiste fume en public, ce signe la trahit et elle est tout de suite aguicheuse. Quelqu’un qui cite un livre est suspect.
THE WOMAN ON PIER 13 est d’abord un film anti communiste. Son titre fut longtemps, I MARRIED A COMMUNIST et Howard Hughes en proposait le scénario aux réalisateurs sous contrat pour tester leur patriotisme. Losey le refusa, Nicholas Ray ne dit pas non, John Cromwell prétendit être tellement enthousiaste que ses demandes firent exploser le budget et on lui retira la préparation, sans que cela le mette sur une liste noire. Disons le tout de suite, le film est anthologique. Les communistes sont identifiés aux plus vils gangsters et on ne les rencontre que dans des lieux de plus en plus obscurs et souterrains. Leur plan paraît totalement inepte (pourquoi veulent ils fermer le port), incompréhensible et il est impossible de comprendre, de saisir ce qu’ils veulent. Le film dépense beaucoup d’énergie pour qu’on ne puisse jamais comprendre leurs motivations, leur idéologie. Chaque fois qu’ils parlent, ce qu’ils disent est traité en une suite de plans musicaux où l’on n’entend pas le dialogue. Leurs adversaires sont tout aussi dépourvus d’arguments : on ne dénonce pas les camps russes, l’antisémitisme. Qu’on ne cherche pas une idée politique. Les communistes sont traités de manière plus abstraite, plus vide que dans le brillant I WAS A COMMUNIST SPY FOR THE FBI de Gordon Douglas, qui gagna l’Oscar du documentaire (sic) pour une histoire totalement fausse. Mais la présence de Robert Ryan, la photo sublime de Nicolas Musuracca nous ramène au film noir. Et de nombreux détails sont ultra révélateurs et témoignent avant tout de la mentalité des auteurs, de leurs préjugés : une femme communiste fume en public, ce signe la trahit et elle est tout de suite aguicheuse. Quelqu’un qui cite un livre est suspect.
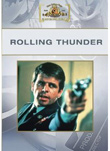 N’en déplaise à Samuel Blumenfeld, j’ai trouvé ROLLING THUNDER de John Flynn qui faisait partie des titres méconnus des années 70, très en dessous des autres films, extrêmement étroit et pauvre, malgré Tommy Lee Jones. Le sujet s’épuise très vite, les personnages de femmes sont atrocement mal traités et filmés. Même le règlement de compte final ne parvient pas à vous réveiller
N’en déplaise à Samuel Blumenfeld, j’ai trouvé ROLLING THUNDER de John Flynn qui faisait partie des titres méconnus des années 70, très en dessous des autres films, extrêmement étroit et pauvre, malgré Tommy Lee Jones. Le sujet s’épuise très vite, les personnages de femmes sont atrocement mal traités et filmés. Même le règlement de compte final ne parvient pas à vous réveiller
Revu ROPE OF SAND. Pas grand-chose à ajouter sur le texte de 5O ANS. L’affrontement durant la tempête de sable est vraiment spectaculaire et Corinne Calvet moins ridicule que je le craignais. Burt Lancaster y joue un de ces personnages masochistes si nombreux dans son début de carrière (ici il se fait fouetter par Paul Henreid) On se demande simplement pourquoi on nous impose un long flash back qui a déjà été très bien raconté par Peter Lorre. Dumont dit que les réminiscences de Casablanca entrainèrent une brouille entre Wallis et Jack Warner.

Je ne sais pas si j’ai jamais parlé de DIAL 1119, qui est assez intéressant. C’est une bonne idée que de donner à un acteur aussi transparent que Marshall Thompson (qui joue aussi dans THE TALL TARGET), ce personnage de tueur dérangé, lunatique et très dangereux. C’est un excellent contre emploi. Il a l’air terne, ordinaire et cela le rend encore plus menaçant parce que peu prévisible. Dans la première partie, notamment, il réussit une interprétation dépouillée, nue, sans jamais vouloir introduire des éléments rédempteurs. La photographie de Paul Vogel est bonne. L’absence de toute musique (sauf de musique source : une radio) renforce le climat et doit peut être être portée au crédit du metteur en scène. Je me souviens du producteur Richard Goldstone nous parlant avec affection et estime de Gerald Mayer, qu’il jugeait intelligent, sensible, articulé et trop gentil pour réussir. Il y a ici et là des touches sensibles, originales, une utilisation assez neuve pour l’époque du rôle que peut jouer la télévision, une description dépourvue de sentimentalisme de la police et de certains témoins (le couple qui a entendu le premier coup de feu et veut une récompense). Certains des otages sont montrés comme des gens égoïstes, déplaisants et le scénario de John Monks jr (qui travailla plusieurs fois avec Hathaway) recèle quelques surprises : Le psychiatre échoue avec Harry, le journaliste ne parvient pas à parler à son patron. Dans le dernier tiers, la mise en scène devient plus académique et conventionnelle malgré quelques ellipses heureuses.
 Quelques films noirs français et de fort bons avec ce coffret Jacques Audiard qui regroupe le passionnant REGARDE LES HOMMES TOMBER qui vous agrippe dès le premier monologue de Jean Yanne, la première voix off détaillée comme dans un rêve par Bulle Ogier, dès ce plan de chien ponctuant la planque de Yanne. Ne pas oublier Trintignant (« Marx comme Karl Marx ») et le splendide SUR MES LEVRES. Il faudra revenir sur ces films remarquables
Quelques films noirs français et de fort bons avec ce coffret Jacques Audiard qui regroupe le passionnant REGARDE LES HOMMES TOMBER qui vous agrippe dès le premier monologue de Jean Yanne, la première voix off détaillée comme dans un rêve par Bulle Ogier, dès ce plan de chien ponctuant la planque de Yanne. Ne pas oublier Trintignant (« Marx comme Karl Marx ») et le splendide SUR MES LEVRES. Il faudra revenir sur ces films remarquables
A BOUT PORTANT, la deuxième réalisation de Fred Cavayé est palpitant de bout en bout. Remarquablement bien dirigé, à l’américaine, il se sort avec les honneurs de toutes les scènes archétypales, notamment les poursuites. Celle dans le métro est anthologique et Cavayé parvient à y introduire des rebondissements inattendus (les transporteurs de fonds qui croient être attaqués et se rendent). Gilles Lelouch est épatant et au passage les auteurs parviennent à décrire avec justesse décors et métiers (tout ce qui se passe dans l’hôpital)
Je cite Espions qui n’est pas un film noir mais plutôt un thriller d’espionnage hitchcockien d’abord parce que j’aime beaucoup Nicolas Saada, que je lui trouve du talent : la manière dont il filme Londres et Géraldine Pailhas, la filature dans le métro, ce découpage qui privilégie les plans moyens souvent en mouvement, sait imposer un décor, voilà quelques unes des qualités qui me touchent dans ESPIONS où Guillaume Canet est comme souvent impeccable.

Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Additifs films noirs
- Article précédent : Classiques passés et futurs
Articles similaires
Commentaires (54)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)

Je viens de découvrir ESPION(S) diffusé à la tv dernièrement: très brillant et maîtrisé, je n’ai pas pensé à Hitchcock pour le thriller mais pour l’histoire d’amour qui comme dans NOTORIOUS ou SUSPICION joue comme allégorie de la conscience mutuelle que deux amoureux doivent s’accorder. J’ai trouvé à l’exact contraire de Damien Doussin dans cette page, que la scène de fusillade finale dans le parking était très bien vue, libératoire et même jubilante, relâchant la tension accumulée par un film qui se concentre à l’intérieur des dialogues en huis-clos, des filatures, des mystères: on est soulagé que Canet déglingue proprement quelques uns de ces salopards! L’action spectaculaire est ici parfaitement justifiée! Enfin, le deuxième final consécutif à celui-ci, sentimental lui, qui voit les deux amants se regarder de loin à travers une glace qui interdit toute communication verbale entre eux, en plus de la distance qui les sépare et du secret qui les tient pour des raisons différentes, touche au sublime, et je pèse mes mots. Ce final des amants forcés au silence vise avec une réussite totale à illustrer une deuxième fois dans le film la dualité amour-confiance mutuelle. En fait, je trouve même génial d’avoir réussi à faire se suivre d’aussi près, un final d’action et un final de romance! Bien vu!
Décidément, le jeune cinéma français est en pleine forme!
A Martin Brady
Vous avez raison et votre dernière phrase est confortée par AUGUSTINE et deux ou trois autres films interessants
To Mr. Tavernier and Mr. Alhazred, The Cromwell interview appeared in « The Velvet Light Trap »(#10, Aut ’73) and is cited by Bernard Eisenschitz in his excellent biography of Nicholas Ray. Cromwell put Art Cohn (THE SET-UP) on to rewriting the « impossible » original script. Since these rewrites took so long and « after a certain time, Cromwell’s salary was to go up to $7,500 a week, RKO released Cromwell. » Hughes also looked at work by Brahm, Haskin, and Ludwig but may not have approached these gentlemen. See pgs. 121-125, Eisenschitz, Amer ed.
Bonjour,
A propos de The Woman on Pier 13, vous dites : »John Cromwell prétendit être tellement enthousiaste que ses demandes firent exploser le budget et on lui retira la préparation, sans que cela le mette sur une liste noire ».
Je n’ai pas réussi à retrouver votre source.
L’historien Daniel J. Leab, dans un article de 1984 (« How Red Was My Valley: Hollywood, the Cold War Film, and I Married a Communist »), réfute la thèse selon laquelle Hughes se serait servi du film pour tester les réalisateurs. En parlant de John Cromwell, il dit seulement qu’il avait rejeté le script (je n’ai pas l’article sous la main pour citer les termes exacts).
Votre explication introduit une dimension supplémentaire, fort intéressante, et je souhaitais savoir où vous aviez eu connaissance de cette information.
Cordialement
A ABDUL
Je crois l’avoir trouvé dans une interview de Cromwell (le journal de la DGA ?) ou dans un des très nombreux livres sur cette époque. En tout cas Hughes le proposa à Losey, à Ray (voir l’attitude étrange de celui ci dans le livre de Pat McGilligan)
A Martin Brady :
La question de l’ellipse est passionnante en effet car si nous osions les grands mots, nous la retiendrions comme l’une des définitions de l’œuvre artistique. A contrario de la vie réelle où l’ellipse n’existe pas hélas, toute œuvre cinématographique ou littéraire, prosaïquement, mais cela est valable pour les beaux-arts également, en nous proposant un récit, donne accès à l’ensemble des outils de la rhétorique, dont procède l’ellipse.
Et, en forçant le trait, l’ellipse ne représenterait-elle pas la quintessence de l’art ?
Le clair-obscur du Caravage n’est-il pas l’art ultime de l’ellipse par son travail sur la lumière, en captant toute notre attention sur une partie d’un corps, d’un visage, d’une plaie, tandis que se fond dans le dégradé de tons sombres où la lumière décline, l’imagination et de l’artiste et du spectateur ?
Le découpage en chapitres d’un livre (ou d’un film), n’est-ce pas l’art d’agencer une histoire autour d’ellipses ?
Et lorsqu’un cinéaste découpe son récit suivant un montage, étape Ô combien cruciale du processus créatif dans la réalisation d’un film, l’ellipse est bien cette invitation au voyage de l’imagination, parfois, ou bien encore un moyen de décaler la perception et l’humeur du spectateur. Et selon les sentiments que le réalisateur désire nous inspirer, il optera pour tel ou tel effets, selon une palette et visuelle et sonore.
Aussi, dans mon propos, je ne verbalisais pas l’ellipse en tant que telle, mais l’usage de celle-ci à seule fin de paresse d’écriture, unique motivation m’a-t-il semblé dans les exemples cités. Et bien au contraire, l’absence de celles-ci dans une proposition de récit se révélerait hautement indigeste, tout autant que les explications apportées à ce qu’une caméra a suggéré auparavant (tant d’exemples me viennent à l’esprit, de ces mauvais films).
De ces ellipses, certaines me demeurent gravées en mémoire, et, à tout seigneur tout honneur, je n’en citerai qu’une. Dans THE DEER HUNTER, Michael Cimino filme cette scène de bar au retour de la chasse, à l’ambiance conviviale, joyeuse et alcoolisée comme il sied à ce genre de moments. Après les franches et viriles accolades, quelques notes de piano se font entendre et la caméra cadre George Dzundza (John, le propriétaire du bar) qui interprète le Nocturne No. 6 in G Minor, Op. 15, No. 3. de Chopin. Quelques plans sur les différents protagonistes, les sourires, l’amitié, une once de nostalgie que l’on sent poindre, déjà, et par la bande son, l’amorce de la scène suivante, la musique de Chopin peu à peu supplantée par le grondement du rotor du « Huey » (l’hélicoptère Bell UH-1 Iroquois dont les premières années de service coïncidèrent avec la guerre du Viêt Nam, et en devint un symbole), et l’image qui apparaît et nous confirme notre transport sur le lieu du conflit. La seconde partie de l’histoire peut alors commencer et se distinguera à bien des égards de l’ambiance de la première partie, comme annoncé par la bande son.
Amicalement,
D. H.
Monsieur Tavernier, Thanks for the gracious response and for the Calef recommendations which I shall follow. In the matter of NAKED CITY,the out of print discs are obtainable from American Amazon. The sets I would particularly recommend are a 4 episode disc entitled (after one of the episodes therein) NEW YORK TO L.A. That title episode features Frank Sutton and Robert Blake as 2 near telepathically linked (they were raised together in an orphanage) murderous armed robbers being transported from and to the aforementioned cities by Paul Burke and partner Ed Asner. Sutton (later Sgt to Gomer Pyle) makes an even better psycho than Blake,which is saying something, isn’t it? This set also features the Torn/Weld episode « A Case Study of Two Savages », and anyone who loved Torn in PAYDAY should see him in this. A set called BUTTON IN THE HAYSTACK includes the best of Robert Duvall’s guest appearances « Hole in the City »(written by Howard Rodman,inspired by Ingmar Bergman). The best of three 12 episode sets is Volume 2 (Aldo Ray,Dan Duryea,Sandy Dennis,Richard Basehart,Maureen Stapleton…) Best, Michael
To Michael
Thank you
Oh to be in Montreal/Now that Bertrand’s there Michael Rawls, after Robert Browning Monsieur Tavernier: If you’d just drop by Gainesville,Florida on your way back to Paris, I could present you with a copy of that DRAGNET episode with the Pagnol namecheck. I have copies of two (PITFALL on Laser and VHS, THE PROWLER ON DVD) of your six Montreal selections in my video library) and I saw (and loved)the substitute third (CRY DANGER) twice, on television, many years ago before it dropped down the memory hole for a few decades. I haven’t copies nor have seen any of the French films in the program but, off program, I still remember the state of exhilirated despair (something like being punched in the stomach and finally being able to breathe again) in which I left the Center Theater in Jacksonville, FL in 1968 after seeing PLAY DIRTY, the DVD of which I don’t have yet but I do have DAY OF THE OUTLAW. And also many episodes of the fantastic American TV series NAKED CITY with performances by the like of Rip Torn, Tuesday Weld, and Christopher Walken which I’ll bet you haven’t seen. Feel free to drop by. Best, Michael Rawls
I’d like to mark that last e-mail private (like this one) rather than for publication. I hope you don’t take it as impertinent. If you do, then just regard it as a « pied de nez », or as BABELFISH would have it, « a foot of nose. » Although it wasn’t. Best, Michael
No impertinence, Michael. Not at all
Michael, I would love to see those NAKED CITY episodes. Try to see L’HEURE DE LA VERITÉ, the french dvd has english subtitles. It is a fascinating film, daring, meaningful. Calef is an interesting director. Look at JERICHO. LE SUCRE has no subtitles, I think.
Je viens juste de voir en dvd ESPION (S) de Nicolas Saada, réalisateur dont j’apprécie également beaucoup la simplicité et la cinéphilie. J’ai accroché de bout en bout à son film. La relative courte durée du film (1h30) et c’est positif, fait que l’on rentre immédiatement dans l’histoire : sorte de chronique de l’espionnage « ordinaire ». Canet est tout à fait dans son rôle et Pailhas est magnifique. Un petit regret toutefois sur la fin que j’ai trouvé assez peu crédible pour le coup avec la fusillade dans le parking… Mais il fallait sans doute mettre une scène d’action qui, paradoxalement pour ce genre de film, pouvait parfaitement tenir sans…
En espérant que vous profiterez bien de votre séjour à Montréal.
Bon voyage à Montreal Mr Tavernier.
http://www.montrealgazette.com/entertainment/movie-guide/Montreal+World+Film+Festival+2011+Bernard+Tavernier+goes+movies/5257965/story.html
Merci Catherine
L’année 2012 devrait démarrer sous de bons auspices.
Pour le 3 janvier 2012, sont annocés chez TAMASA la sortie de :
– MISSISSIPPI BLUES
– LA CLASSE OUVRIERE VA AU PARADIS
Dans le premier, il y a une chorale qui chante Amazing Grace de façon magnifique, dirigée par une jeune conductrice de choeur stupéfiante, vivement que je revoie ça, ça fait longtemps qu’on voit plus le film de Parrish et Tavernier à la tv.
« Pushover » est très beau et original (cela fait déjà drôle d’employer l’adjectif beau pour qualifier un film noir) mais je lui préfère encore « Drive a crooked road » que vous avez un peu passé sous silence dans « 50 ans… ».
C’est une magnifique dérive, un film noir en état de grâce, douloureux comme un mélodrame, dont il emprunte certaines situations et plans archétypaux. Mickey Rooney y est formidable (il y joue encore un rôle de mécanicien naïf, comme dans l’étonnant « Quicksand ») et la fin sur la plage est bouleversante.
« J’ai commis une légère erreur en parlant de l’accent américain maladroit de Dirk B. C’est une phrase que j’ai rajoutée à la dernière minute. J’ai utilisé une des biographies de Bogarde (celle de Coldstream est très injuste avec le film) et aussi ce qu’il m’a raconté mais qui devait être biaisé par le temps, par le fait qu’il n’avait jamais revu certains films. Toutes mes excuses. On devrait douter de tout surtout de certaines sources »
REPONSE:
« Le point de détail qui tue »
Surtout ne vous excusez pas, Mr Tavernier, vous savez les Anglais (cinéphiles) sont très susceptibles en ce qui concerne les accents, alors un américain ET un anglais qui se fait passer pour un américain …ce n’est pas pareil, ha,ha [THE WOMAN IN QUESTION]
De +, l’une des personnes qui a relevé votre remarque est THE spécialiste de Dirk Bogarde, alors …
A noter, la sortie imminente en dvd de DESPAIR de R.W Fassbinder avec D.Bogarde et A.Ferreol
WARNER sur son site warnerbros.fr vient de démarrer une collection « Les Trésors WARNER ». Ils s’agit de DVD Zone2, pressés à la demande(ils ne sont pas gravés)comportant des sous-titres français; de rares titres possèdent m^me une psite française. 30 titres sont pour l’instant disponible; je citerai :
– La Fille du désert (WALSH)
– La Toile d’Araignée (MINNELLI)
– Le Grand Attentat (MANN)
– La Chute d’un Caïd (BOETTICHER)
– Le Harpon Rouge (HAWKS)
– La Tempête qui tue (BORZAGE)
-……
Bonjour
Les dvd industriels vendus dans le commerce sont toujours pressés à l’origine, c’est nous dans nos foyers qui gravons de façon artisanale, le pressage est 100 fois plus rapide que le gravage, ce que je me demande, c’est « à la demande » de qui? Moi, je veux bien adresser quelques requêtes…
La Chute d’un Caïd était indisponible jusqu’à maintenant, en tout cas… (l’un des premiers rôles de Warren Oates).
Monsieur Tavernier, Thanks for your defense of Fred MacMurray. I too at first had trouble seeing past MacMurray’s years of Disneyian buffoonery and of his somnambulistic shuffling through MY THREE SONS. But when I first saw PUSHOVER in 1985, I found him thoroughly convincing as the corrupt cop (unlike Mitchum’s noir characters, brought down by one fatal mistake, you get the impression that MacMurray’s character was just waiting for the proper catalyst to bring out his innate rottenness). Mac-Murray is also quite good in Leisen’s romantic comedies, above all REMEMBER THE NIGHT (no-one could have partnered Stanwyck better in that film). And then there’s the thoroughly slimy intellectual Keefer in THE CAINE MUTINY. In fact, in CAINE…, MacMurray,Ferrer,Bogart, and Johnson are so good that they almost make it possible to swallow that deeply morally confused take-it-all-back ending (« Captain Bligh’s Revenge », the great critic Eric Bentley called it).
Cher Bertrand Tavernier, c’est ma première intervention sur votre blog que je consulte régulièrement, que j’adore et qui me fait dépenser beaucoup d’argent. J’aime vos films et je revois au moins une fois par an « Laissez-passer ». J’ai eu le cœur serré quand vous avez annulé votre dernière intervention sur Musique et Cinéma au Forum des images. Vos « Amis américains » sont mon livre de chevet : ils me permettent d’approfondir au lit ma cinéphilie, tout en travaillant mes abdominaux le livre lourdement posé sur le ventre. Les « Cinquante ans de cinéma américain » sont aussi régulièrement consultés, étudiés, et trônent royalement dans une pièce de mon appartement que la bienséance m’interdit de nommer mais où je me rend au moins une fois par jour. J’ai également beaucoup aimé votre journal « Pas à pas dans la brume électrique », dans lequel je découvre avec admiration page 212 que, plongé dans les affres d’un tournage américain éprouvant, vous trouvez encore le temps et l’énergie de sauver toute une famille de bébés chats…
Mr Tavernier, vous êtes décidément un type formidable.
En revanche, je dois m’inscrire en faux contre une remarque que vous faîtes au sujet du film de Fred Cavayé « A bout portant ». Rien à dire contre le film que je viens de visionner suite à la lecture de votre dernière chronique et à votre enthousiasme communicatif. Les poursuites sont effectivement bluffantes, le film défile sans temps mort (75 minutes, je crois… !) et on passe un bon moment. Et je me garderais bien de vous reprendre en matière de cinéma. Mais quand vous dîtes que « les auteurs parviennent à décrire avec justesse décors et métiers (tout ce qui se passe dans l’hôpital) »… non !
Je suis infirmier en réanimation depuis de longues années, et, j’ai envie de dire comme d’habitude, le réalisateur ne comprend rien à ce qui se passe dans un hôpital.
D’abord, il est absolument exclu qu’un aide-soignant (un an d’études) prenne seul en charge trois ou quatre patients, en plus intubés-ventilés et relevant de la réanimation. C’est le rôle d’un infirmier (trois ans et demi d’études). Il peut certes parfois exister un malheureux glissement de tâches dans certaines cliniques privées, mais le film montre bien qu’on est ici à l’Assistance Publique (les badges clairement identifiables), et là, ça n’arrive jamais. Gilles Lellouche porte par ailleurs un badge rouge, un badge de médecin (rouge = médical, bleu = paramédical) : c’est un détail, bien sûr, mais ces badges sont un signe tellement distinctif au sein de l’hôpital… !
Quand le voyou sectionne le tuyau du respirateur de Roschdy Zem, on peut voir sur le scope que le patient fait une fibrillation… pas commun, mais pourquoi pas. En revanche, ballonner un patient à l’ambu (le ballon), n’a jamais fait céder une fibrillation ventriculaire. Cela dit, pour une fois, on n’a pas eu droit comme dans tous les films à un choc électrique externe pour ranimer un électrocardiogramme plat (un choc ne peut pas faire repartir un cœur arrêté, les médicaments, si…), on ne va pas critiquer.
Les salles communes de réanimation avec des lits séparés par un vieux rideau de douche n’existent plus : surtout depuis qu’on parle de ce fléau de l’hôpital que sont les infections nosocomiales (attrapées à l’hosto). Ces germes adorent les services de réa où les techniques de soins sont très invasives. Donc que des chambre seules.
Un policier gardant un détenu ou un gardé à vue n’est jamais au lit du patient. On l’installe à la porte (ou dans le cas du film, devant le rideau de douche…), mais ce qui se passe dans la chambre relève du secret médical.
Et enfin, et c’est peut-être le plus important, les rapports entre médecin et l’aide-soignant/infirmier (je n’arrive décidément pas à définir la fonction de G. Lellouche : soit on est infirmier diplomé d’état, soit on est élève infirmier à l’école, soit aide-soignant) sont bidons. On sent dans le film une forte hiérarchie entre les deux (« si l’interne te voyais… », « je te rappelle que tu n’es qu’aide-soignant… »). En réalité, les services de réa sont des services tendus, on est toujours dans l’attente d’une catastrophe, et on s’entend généralement plutôt bien : s’occuper de ces patients compliqués et très malades est un travail d’équipe : on ne peut pas faire autrement, c’est trop lourd techniquement, physiquement et psychologiquement. Médecins, infirmiers, aide-soignants, psychologues, agents d’entretien, tout le monde travaille ensemble. En plus, on parle dans le film d’un interne. L’interne dépend d’un chef de clinique (médecin thésé) et effectue un travail monumental dans le service. Mais il ne fait que passer (stage de 6 mois) alors que l’infirmier est en poste fixe. L’infirmier est d’ailleurs souvent plus copain avec le chef de clinique qu’il connaît depuis des années qu’avec l’interne qui disparaitra au bout de six mois. Mais si jamais un interne s’aventurait à me parler à moi ou à un collègue comme le fait celui du film, je vous assure qu’il serait bien reçu… ! L’interne, qu’on adore je le précise, ne la ramène généralement pas trop dans ce genre de service ; il est un peu un invité, même si, corvéable à merci, il fait tourner la boutique. Mais il a finalement assez peu de pouvoir, en tout cas rien à voir avec celui du film.
Je me suis permis de vous envoyer tout ça car je sais bien, Mr Tavernier, que vous êtes curieux et toujours très attaché au réalisme dans vos films. Et malheureusement, très souvent au cinéma l’hôpital est assez mal représenté. Ce qui reste une chose pour moi absolument incompréhensible vu le nombre d’infirmiers et de médecins en France qui pourraient être facilement consultés. Car quand dans un film, on peut voir des lunettes à oxygène mises systématiquement à l’envers sur un acteur jouant le rôle d’un patient, on est quand même 700.000 à se marrer… !
Merci encore pour votre blog et le reste.
a Joe
Merci et pardon pour les erreurs. On avait une iumpression de réalité, de réalisme et je trouve qu’on avait envie après ce film de se battre avec ceux qui demandent qu’on double les moyens des hopitaux publics
Bonjour
J’ai souvent constaté que l’impression de réalisme qui émane de tel ou tel film pouvait ne reposer sur rien. Le rapport que vous faites, Joe Gillis, sur le nombre d’erreurs présentes dans A Bout Portant est vertigineux! Dans une production « courante », le réalisme ne sera pris en compte qu’en dernier ou pas du tout, déjà, si le respect des détails réalistes prend trop de temps au scénariste ou au réalisateur, il n’en tiendra pas compte. Si ces détails sont faciles à respecter en termes de budget ou, s’ils vont dans le sens du film, ils seront sans doute pris en compte (parfois, le réalisme est spectaculaire, parfois non). Le cinéma plus ancien bafouait bien plus le réalisme, dans certains films américains de guerre, par exemple, on s’écarquille les yeux devant certaines séquences!
A propos de soins infirmiers, j’avais vu un vieux film dans lequel les soldats US envahissaient une île du Pacifique, un indigène était déclaré blessé au bras sans que le spectateur puisse déceler là la moindre blessure, l’infirmier s’approchait et badigeonnait d’un coup de liquide blanc la partie du bras désignée, je n’ai jamais compris de quel liquide à vertu médicale il se pouvait agir, comment ça pouvait agir (temps de l’application du soin: une seconde et demie) ni déjà quelle était la blessure en question que le chef de patrouille avait aperçue à 5m de distance! Celui-ci lançait « Les Etats-Unis ne sont pas des barbares! ».
Le cinéma est très fort à produire l’impression de réalisme plutôt qu’à respecter celui-ci tout simplement.
Souvent, ce n’est pas le sujet, prenez « La Mort Aux Trousses », il y a une invraisemblance par seconde, mais on s’en fiche (c’est même le meilleur Hitchcock, à mon goût) mais cet amoncellement de « bourdes » finit même par nous donner l’impression d’un cauchemar vécu par le héros qui se réveillerait sur une banquette de wagon-lit partant en voyage de noces avec Eva Marie Saint: dans nos rêves, notre cerveau aligne les invraisemblances… Mais ce dernier film est extravagant de toute façon, alors que ce ne doit pas être le cas de A Bout Portant que je n’ai pas encore vu (2 réservations d’avance dans ma médiathèque, grrr…).
Concernant le réalisme au cinéma, il me semble en effet qu’au delà des invraisemblances dans la reconstitution de milieux professionnels (quel flic, quel journaliste, quel pilote de ligne, quel restaurateur, quel magistrat n’a pas fait des bonds dans son fauteuil au gré des contre-sens projeté sur grand écran pour la bonne cause du scénario ?), ce sont les incohérences scénaristiques ou les encore les ellipses cachant mal une paresse d’écriture qui passent difficilement. Et, à ce titre, A BOUT PORTANT n’en est pas exempt. Outre Gilles Lelouch (simple aide-soignant ou infirmier en formation, dans tous les cas certainement pas un truand chevronné qui pratiquerait ce genre de sport depuis sa plus tendre enfance) parvenant à échapper par miracle à des dizaines de policiers, la fuite en parallèle de Roschdy Zem est éclipsée, mais il est vrai que lui, de pratique, il n’en manque pas. Et ce même « simple soignant » qui parvient, lors de l’intrusion au siège de la PJ, à prendre le dessus sur un flic dont la corpulence trahit une fréquentation assidue des salles de musculation, la présence opportune, justement, d’haltères qu’il va pouvoir utiliser comme arme, semble tirée par les cheveux, mais de nouveau, une ellipse du récit balaie ce genre d’interrogation.
Néanmoins, je vous accorde que malgré ces quelques faiblesses, le rythme est bien présent, et que certaines trouvailles surprennent agréablement. Et je souligne également la force du personnage à l’âme plus que noire joué de façon minérale par Lanvin.
Mais j’en viens enfin à l’objet de mon intervention, lequel est la recherche du DVD de BREAKING POINT de Michael Curtiz récemment découvert à la Cinémathèque lors du cycle Perles rares du film noir. Jusqu’à présent, mes investigations semblent toutes conclure à l’inexistence de ce film en DVD…
Ce serait effectivement un grand plaisir que de revoir ce film aux dialogues pétillants, intelligents et drôles, sans oublier les sous-entendus érotiques, si peu sous entendus, entre un John Garfield, que je ne trouve pas personnellement un acteur flamboyant, et une Patricia Neal géniale en blonde fatale dont la voix grave donne une saveur encore plus piquante à ses répliques. Phyllis Thaxter en archétype de la jolie et compréhensive petite épouse américaine est également très bien, et non dénuée d’esprit comme en témoigne la scène où ils sont tout trois attablée au bar, avec un Garfield éméché et, pour le coup, un peu largué par ces dames qui s’expliquent entre elles.
Les relations ambiguës entre Garfield et son employé noir (Juano Hernandez, je crois) me semblent également digne d’intérêt dans ce film tourné à la toute fin des années 40.
Voici quelques raisons, parmi d’autres, afin d’étayer ma requête d’informations quant à ce potentiel DVD.
Amicalement,
D. H.
A Deer Hunter
D’abord je partage en les amplifiant vos éloges sur THE BREAKING POINT et en effet les rapports entre Garfield et Juano Hernandez sont remarquables et vraiment audacieux pour l’époque. En premier lieu – car il y a eu d’autres films, peu nombreux, qui ont abordé ce thème, ce sujet – parce qu’ils ne sont jamais écrits, filmés ou joués pour montrer leur « exceptionnalité ». Les auteurs les montrent de la manière la plus naturelle possible comme s’il s’agissait de rapports évidents. Juano Hernandez est accepté sans que l’on se décerne des récompenses pour cet acte de courage.
Je vous trouve très injuste pour Garfield, acteur d’un modernisme sidérant dont le jeu influença certainement Bogart qui est bien meilleur APRÈS l’irruption de Garfield. Avant, il est caricatural, grimaçant. Il semble avoir puisé son intériorité chez Garfield, l’un des premier héros ouvertement proletarien du cinema américain. Il y avait eu d’autres comédiens qui symbolisaient cette classe, de Wallace Berry, Georges Bancroft, Lee Tracy mais on mettait en valeur leur roublardise, leur cynisme. Garfield comme en France Gabin a donné ses lettres de noblesse filmique à la classe ouvrière et celà dès FOUR DAUGHTERS. Il est magnifique dans BODY AND SOUL, FORCE OF EVIL, AIR FORCE, le splendide PRIDE OF THE MARINES de Daves (disponible en Warner Archive sans sous titres).
Warner Archive vient de sortir THE BREAKING POINT et je vais revenir sur ce film dans une prochaine chronique dès que j’aurai vu le dvd
Cher Bertrand Tavernier,
Merci pour ce renseignement quant à la sortie, très récente en effet, du DVD chez Warner Archive. Et grâce à votre plaidoyer en faveur de John Garfield, vous m’avez fourni un programme enthousiasmant avec cette liste de films à découvrir (à moins que j’en visse certains, à l’insu de mon souvenir, durant l’une de ces nuits lointaines, lors du rendez-vous dominical, soit religieux, avec le Ciné-Club de Patrick Brion…).
Car vous touchez en plein cœur, en citant Bogart, dont le charisme me semble assez irrésistible, ou Gabin que je tiens, et je ne suis évidemment pas le seul, pour l’un, si ce n’est le plus grand acteur français toutes générations confondues, si l’on fait abstraction des films qu’il fit à compter de la seconde moitié des années 60. Peut-être nos chers camarades des Cahiers participèrent par le radicalisme rebelle qui est l’apanage de la jeunesse, à cet aiguillage subit vers une voie de garage, de celui qui imprima de sa marque (un jeu réaliste et une gouaille naturelle nourrie peut-être par son parcours professionnel d’avant le cinéma) un pan entier de la cinématographie française naissante, de LA BELLE ÉQUIPE au personnage, génialement interprété, du paysan dans LA MAISON TELLIER, épisode le plus réussi dans LE PLAISIR de Max Ophüls, sans oublier son ahurissante filmographie, particulièrement dans la seconde moitié des années 30.
Sinon, à la liste des comédiens que vous citez, ne pourrait-on ajouter le nom de Spencer Tracy ?
Votre analyse très juste de la manière « naturelle » de filmer les relations entre Garfield et Juano Hernandez m’a rappelé une scène, que j’avais oubliée, entre des enfants blancs et noirs, filmés sans angélisme aucun. Définitivement, il faut revoir ce film !
Enfin, je me permets d’abonder dans le sens de Godefroy, car ANIMAL KINGDOM est, à ce jour, le meilleur film (diffusé en 2011) vu en salle depuis le début de l’année, à mon sens. La subtilité et la précision de la mise en scène servent avec justesse cette histoire assez peu banale en fin de compte d’un ado « normal » dont la famille est une bande de gangsters en fin de parcours et dont le problème tout entier réside en sa reconversion obligée pour cause de vieillissement et de perfectionnement de systèmes de sécurité des banques. Les gangsters et les flics sont montrés sans apprêts et empathie aucune et le spectacle de cette réalité déprimante est assez réjouissant.
Ps : je me permets, encore, d’indiquer un lien vers un article de Libé concernant une initiative dont nous ne manquerons pas de reparler à une occasion prochaine mais dans un autre lieu certainement tant, j’imagine, elle touchera les lecteurs de ce blog.
http://next.liberation.fr/culture/01012353842-la-septieme-salle-invoque-l-esprit-cine-club
Amicalement,
D. H.
A Deer Hunter:
La question de l’ellipse au cinéma est pas-sion-nante! J’en parlais récemment avec un copain. Ca sert à tout pour des utilisations appréciables ou pas du tout: nuage de fumée destiné à détourner l’attention d’une invraisemblance comme dans votre exemple, accélération du rythme, cliché-clin d’oeil au spectateur (le gros brun à la moustache dans ces vieux westerns, chevauchant un cheval noir, est forcément un méchant, donc, inutile de s’attarder à montrer son caractère antipathique par une action, ellipse: on passe à autre chose: j’avoue que cet exemple est limite, faudrait que je revoie ça!), fausse difficulté adressée au spectateur pour flatter son intelligence (que d’ellipses agaçantes dans les drames psy! Cher spectateur, vous avez compris bien sûr, inutile de vous le souligner au trait gras!), ficelle humoristique (L’Homme de Rio, dispute entre Bébel et Dorléac, il leur faut une voiture d’urgence, Dorléac: « Oui, mmm… mais quelle couleur?, Bébel excédé: « Rose avec des étoiles vertes! », ellipse, plan suivant, les deux repartent à l’aventure dans une voiture rose aux étoiles vertes, ce gag m’avait fait hurler de rire à l’âge de 12 ans!).
Dans la discussion, mon pote me parlait de l’ellipse utilisée par Asghar Farhadi dans le film Une Séparation. Dans une interview,Farhadi disait que selon lui, l’ellipse permettait de conserver l’attention du spectateur, c’est curieux, car l’ellipse souvent peut noyer celle-ci, j’ai hâte de voir le film pour vérifier son illustration dans le film et le propos de Farhadi.
pour John Garfield, n’oublions pas Le vaisseau fantôme, un autre chef d’oeuvre trop rare signé Michael Curtiz…
Bonjour, est-ce trop tard pour revenir sur une chronique passée?
J’ai enfin vu A Bout Portant, de Cavayé, le film est complètement réussi dans la catégorie « Action Américaine Pas Une Seconde A Perdre Y’a D’la Pression », et il ne dure que 81 minutes, ce qui est à louer. Suite à la remarque de Joe Gillis, qui a suscité un bout de discussion sur la vraisemblance et le réalisme, respecté ou non, au cinéma, je note que le petit détail pas du tout réaliste, des patients séparés par une sorte de rideau de douche (qu’on a aussi dans un John Woo) ne se retrouve justifié que par le fait qu’ainsi, le héros peut apercevoir, lorsqu’il ramasse au sol un objet qu’un patient a laissé tomber, l’arrivée d’un intrus dans le box d’un autre patient qui est le bandit sympathique joué par R Zem, puisque les rideaux ne tombent pas jusqu’à traîner sur le sol, et donc, que l’action puisse démarrer. Le film file bien, et les acteurs sont plus convaincants que dans les différents modèles américains, joués en général par Jason Statham!
Ce genre de détail, et d’autres, dont le plus notable est d’aller imaginer que des truands puissent embaucher un « pékin », un amateur, pour le charger de faire sortir l’un des leurs de l’hôpital, ceci en kidnappant son épouse, c’est à dire en se lançant dans l’une des actions les plus délicates et dangereuses qui puissent être, est balayé par le souci de l’action, mais depuis l’exemple de La Mort Aux Trousses, comment reprocher à un film de se servir d’invraisemblances pour faire avancer l’intrigue (ce que J Gillis ne reproche pas non plus au film).
Le dvd contient un bonus -making of- à peine moins long que le film, qui montre Cavayé comme un réalisateur assez décontracté et joyeux, semblant plaire à tous (à moins que le montage y soit pour quelquechose!). Je regrette l’épilogue conventionnel à l’américaine qui montre le flic pourri enfin puni des années après, exécuté par le bandit sympathique. Un copain me dit qu’il faut voir Pour Elle.
A Martin Brady
Oui, il faut, le voir
Bonjour, je viens juste de recevoir le coffret Films Noirs Classics 1 (trois mois à tenter de le trouver sur Internet, mais j’ai enfin trouvé le bon site marchand qui me dispense de prendre une cb internationale, trois mois à désespérer de l’obtenir depuis que vous en aviez parlé, Bertrand!) et de voir enfin The Lineup juste avant d’ouvrir mon ordi et de découvrir votre nouvelle chronique! J’ai été totalement séduit par le film: et pas pour vous contredire mais je trouve que ça démarre au contraire au quart de tour et ne se relâche jamais (l’une des meilleures séquences pré-générique que j’ai vues, punition pour les lambins qui s’installent encore dans leur fauteuil quand les lumières s’éteignent: bien fait!). Je me suis dit par moi-même « chef d’oeuvre », certes ce n’est jamais vertigineux ou exaltant mais étant donné les ambitions affichées: parfaitement assumé, 85′ sans un seconde de graisse, admirable! Tout fonctionne, même le duo un peu conventionnel des deux flics. Je trouve aussi qu’on insiste un peu trop sur le personnage de dingo de Eli Wallach: après tout, il me paraît pas cinglé à ce point! En même temps, il forme le duo pendant de celui des flics avec l’excellent Robert Keith: celui-ci, je ne l’ai jamais vu aussi bon, il est l’exacte balance de Wallach/Dancer, et joue sur des pointes, avec légéreté et douceur, Siegel lui laisse de longues lignes de dialogue qu’il cisèle avec précaution (voir sa manière de raisonner Dancer, qui paraîtrait le chef, et l’amène à se rallier à son avis…). Keith est un acteur étonnant, trop discret dans son expression pour ne pas s’être laisser reléguer dans des rôles trop obscurs trop souvent, mais pas ici: vous noterez comment il fait valoir sa folie à lui, qui vaut celle de Dancer, par le moyen d’une seule petite phrase à l’adresse de la femme kidnappée (Mary LaRoche): « Vous voyez, vous pleurez, c’est pourquoi les femmes n’ont pas leur place dans la société. Les femmes sont faibles. Le crime est agressif, et la loi aussi (…) Vous ne comprenez pas le besoin criminel pour la violence! ». A ces sornettes décousues et machistes, détaillées avec cautèle et prétention, elle lui répond à notre grand soulagement « Vous êtes malade! ».
Finalement, je vais finir par trouver que Lineup dit quelques petites choses singulières sur l’esprit criminel, la mégalomanie de celui-ci qui reste en germe, qui dort doucement, mais reste bien vivante…
Bien sûr la poursuite de fin, est excellente avec les deux truands qui s’engueulent en hurlant alors que la voiture qui les contient fait du slalom avec les autres véhicules comme si l’ambiance n’était pas assez survoltée! Poursuite que Silver et Ward dans Film Noir disent « avec ses transparences (…) plus précise visuellement que la plupart des excitantes poursuites de voitures récentes », l’idée de la faire se terminer sur une bretelle d’autoroute inachevée qui donne sur le vide est étonnante.
La rencontre entre Richard Jaeckel et nos bandits est un régal, celui-ci posant des questions naïvement indiscrètes et les deux répondant sans répondre: c’est du grand film noir! Je le revois demain, il le mérite.
Dans le bonus, C Nolan ne parle pas du film de Siegel mais du film noir en général.
Je réserve The Sniper pour la soirée d’après, je pense!
J’ai vu aussi 5 Against The House, j’adore le début avec son côté documentaire, la façon dont Brian Keith drague une parieuse avec beaucoup d’humour et de gentillesse, les fascinants monte-charges réservés aux voitures que l’on retrouve à la fin…
Bonsoir,
Dans la continuité du paragraphe sur les films noirs de Anthony Mann, j’aimerais évoquer un film que j’ai vu récemment, MARCHE DE BRUTES (RAW DEAL). Très bonne surprise de ce film dont j’ignorais tout et que j’avais trouvé dans la collection FNAC « Introuvables ». J’aime beaucoup Claire Trevor comme toujours (j’ai été toutefois de la découvrir récemment dans ECRIT DANS LE CIEL avec un personnage ridicule), tout comme Raymond Burr, qui est souvent filmé en contre-plongée ici, renforçant son autorité, même chancelante à la fin du film.
La lumière est superbe (John Alton) et quelques plans sont absolument magnifiques, notamment la séquence où O’Keefe parle de la vie qu’il aurait aimé, dans l’ouverture de sa cabine de paquebot. Il y a un réel climat oppressant tout au long du film. J’ai hâte de découvrir d’autres films noirs de Anthony Mann, LA BRIGADE DU SUICIDE particulièrement.
Je ne sais pas si on peut classer ces films dans la catégorie « Noir » mais je viens de m’avaler le coffret OSS 117 édité par Gaumont et le constat est plutôt affligeant. Ces cinq films (qui ne méritent pas le titre d' »Intégrale » puisque d’autres OSS furent commis avant et après ceux-là) vont du piteux au tout juste passable. Les pires sont les deux premiers où l’agent américain aux improbables origines françaises est campé par le transparent Kerwin Matthews. Il y a tout petit mieux ensuite avec le solide Frederick Stafford et une (très légère) recherche de décontraction avec le dernier joué par John Gavin. Bien que le héros de Jean Bruce soit antérieur à celui de Ian Fleming, ses aventures exotiques en font un James Bond de 5ème zone, aussi limité que la palette de ses gadgets (en général une radio et un micro miniaturisés). Les méchants d’opérette sont risibles (Robert Hossein s’y colle à deux reprises, no comment) et les seconds couteaux sous-employés (comme Daniel Emilfork et Guy Delorme). Les vamps de service aussi malgré la présence de Mylène Demongeot, Pier Angeli, Irina Demick, la vénéneuse Margaret Lee ou cette éternelle incarnation de la lassitude sensuelle qu’est Marina Vlady (et ce n’est pas pour fayotter mais elle fut rarement meilleure que dans QUE LA FETE COMMENCE). Je ne sauverai que le charme espiègle de la ravissante Jitsuko Yoshimura dans ATOUT COEUR A TOKYO POUR OSS 117, bien plus intéressante que les copines nippones de Sean Connery.
Un coffret à n’acquérir que par second – voire troisième – degré cinéphilique ainsi que pour son livret d’accompagnement et ses bonus très sympathiques (dont des actualités Gaumont-Pathé farfelues d’époque).
A Pierre, je garde de ces films un sentiment d’accablement. André Hunnebelle est l’un des plus mauvais réalisateurs français, très inférieur à un Roger Richebé dont on s’est tant moqué, à Maurice Cloche. Je ne vois pas un film à sauver. Les acteurs sont tous pitoyables mais je trouve bien que l’on édite ces nanars
Bonjour Bertrand. Difficile effectivement de défendre la filmographie de Hunebelle, dont un critique avait dit à propos de « Ça va faire tilt », son dernier film, « Une belle connerie. » Néanmoins, comparé à la version de Delannoy, je trouve que son « Bossu » est un peu supérieur, plus enlevé, plus divertissant, mais celui que je réhabiliterai serait plutôt « Le capitan », bien meilleur que certains Borderie (notamment les « Pardaillan ») . Les duels sont assez brillants, particulièrement celui opposant Jean Marais à Guy Delorme, et le film tout à fait plaisant malgré un XVIIe siècle un peu de pacotille, il est vrai. Et puis il y a Piéral et Marcel Pérès… Cela dit je n’ai pas vu la version de Robert Vernay… mais dont j’ai un peu peur. Je classe Hunebelle dans une catégorie de cinéma pour enfants qu’il ne faut pas complètement sous-estimer, au vu du plaisir qu’ils éprouvent encore devant ses « Fantômas », toujours très drôles… quand on a 6 ou 7 ans. Ce n’est déjà pas si mal ! Bien à toi.
Si je voulais absolument défendre Hunebelle (tâche très ardue) peut-être que je citerais les 2 films qu’il tourna avec Michel Simon dans lequel le génial acteur jouait un chauffeur de taxi et un concierge.C’est pas génial, mais cette évocation de la France des années 50 et de ses milieux populaires est plutôt sympathique.
A A Desage
Vous trouvez. La mise en scène est si molle si convenue
Tout à fait d’accord sur Hunnebelle. Vu deux de ses OSS 117 à la télé. C’est proprement affligeant : les acteurs mauvais, le manque de rythme, les décors extérieurs quasiment tous affreusement inexploités et gachés par les transparences(il suffit de comparer les scènes se passant à Rio dans FURYA A BAHIA par rapport à celles de L’HOMME DE RIO..). Les seuls films que je sauverais d’Hunnebelle sont ses trois FANTOMAS : mais attention c’est la madeleine de Proust qui parle et non le cinéphile…
PUSHOVER est certes très élégant mais il m’a déçu par rapport à tout le bien que j’en entendais dire. Au départ, je ne suis pas très fan du jeu de MacMurray et si je comprends le pouvoir attractif de Kim Novak (du moins, dans ce film où elle est plus qu’amoureusement filmée), son jeu atone m’a vite lassé. Un peu tiqué aussi sur l’opposition téléphonée du duo sulfureux Novak-MacMurray avec celui formé par la gentille infirmière bonne ménagère (Dorothy Malone, sous-employée) et l’honnête flic beau gosse (Philip Carey, qui joua l’officier ex-ennemi intime de qui Bertrand sait dans un fameux western d’espionnage). Quelques trouvailles sympathiques néanmoins comme Carey en adepte des arts martiaux. Je connais trop mal l’oeuvre de Richard Quine mais j’ai par contre furieusement envie de revoir l’émouvant LIAISONS SECRETES, le film avec Kim Novak qui m’avait le plus enchanté (VERTIGO mis à part, of course). Ne serait-ce que pour la séquence au supermarché (dont j’ai cru voir un hommage dans le très chouette MELODIE POUR UN MEURTRE d’Harold Becker) et celle, réjouissante d’auto-dérision où Kirk Douglas répond enfin à LA question pratique que les spectateurs devaient se poser depuis quinze ans. ;P
D’accord par contre sur NIGHTFALL, polar un peu à part mais à la conclusion décevante. Je n’arrive pas à savoir si la composition d’Aldo Ray est soit très originale soit si son jeu assez particulier de costaud fragile venait de ce qu’il était complètement perdu (ou alors volontairement mis dans cet état par Tourneur). Reste un Brian Keith épatant (comme presque toujours) et la grande Anne Bancroft.
En ce qui concerne THE TALL TARGET, c’est à la fois un des sommets des films de train et du film noir tout court. Pas revu depuis un lointain cycle proposé par Patrick Brion mais il m’avait bluffé.
Pushover: j’aime beaucoup ce film, même Fred McMurray n’est pas énervant, juste risible avec sa tête de gogo qui joue au dur, on comprend qu’il se laisse embarquer dans cette histoire catastrophique! Il reste imperturbable malgré les complications qui s’amoncellent au-dessus de lui et révèle un atout comique a contrario (type John Wayne dans Rio Bravo), par opposition. C’est l’un des rares polars qui semble finement mixé avec de la comédie, les quiproquos nombreux l’apparentent à une comédie de boulevard, malgré la fin tragique.
A Martin Brady
Je trouve les commentaires sévères pour Mac Murray. C’est un acteur que j’ai mis du temps à apprécier (ses derniers films familiaux n’aidaient guère). Je le trouvais inerte dans certains westerns. Et puis ce qu’en dit Billy Wilder (entretiens avec Cameron crowe, excellents) m’a ouvert les yeux, quand il parle de sa modestie et il faut dire qu’il est remarquable dans ASSURANCES SUR LA MOT et LA GARCONNIERE. Et puis il y a eu les Mitchel Leisen qui analyse très bien son sens de la comédie, du rythme, sa manière de jouer décalé par rapport à Carole Lombard et autres. Il avait un vrai sens du tempo dans tous ces films. Mais quand les sujets sont ternes (L’OEUF ET MOI, les films de Binyon), il peut devenir transparent. Il a besoin de personnage forts qu’il interiorise sans effets histrioniques.Il était excellent dans un western méconnu de Paul Wendkos, FACE OF A FUGITIVE
Je trouve aussi que Fred MacMurray est bien meilleur que sa réputation. Et dans Pushover, son jeu convient tout à fait au personnage.
Attention, je pense réellement que le côté risible de Mac Murray dans Pushover n’appartient qu’à lui, je ne sais pas si Quine l’a fait exprès, mais ce côté suicidaire du personnage relève de la comédie noire, les quiproquos funestes qui s’amoncellent et réduisent les portes de sortie mènent à une espèce de tragi-comique (a contrario) qui n’a pu fonctionner qu’avec son talent. C’est là que je vois ce qu’il y a de spécifique dans le film de Quine, qui a réussi des grandes comédies. Je trouve FMM en effet souvent énervant dans des films plus faibles, et comment le lui reprocher…
A Pierre
Comme à vous, PUSHOVER m’a laissé une impression mitigée, à tout le moins. Au travers des commentaires qui ont suivi, la défense de Fred Mc Murray aurait dû me mettre la puce à l’oreille. Effectivement, dans la GARÇONNIÈRE, il « fait le job » mais n’oublions pas que Billy Wilder est à la baguette et le film entier est l’une des meilleures comédies qu’il m’est été donné de voir. Le scénario de PUSHOVER égrene les invraisemblances comme autant de rebondissements absurdes et ce, dès la scène de la rencontre autour de la panne de la voiture de Kim Novak. Ainsi, ils se seraient observés réciproquement durant toute la représentation ? Lui, certes, est en service commandé, ce qui justifie sa démarche, mais elle ? Succombant au sex-appeal de Mc Murray ?!? Quant à la genèse de sa vulnérabilité face à la tentation de passer le Rubicon, elle tient en deux phrases, lancées lors d’une discussion pour faire passer plus vite le temps de la planque : « je ne me rappelle de mes parents que se querellant, toujours à cause de l’argent, je m’étais juré, étant gosse, d’être un jour plein aux as », un peu court, non ? Ainsi que le relevait un commentaire, l’enchaînement des « pépins » qui viennent contrecarrer le plan, plus que sommairement établi, il est vrai, n’ébranle pas une seule seconde la volonté de Mc Murray, et le comportement, qui le pousse jusqu’à affronter ses collègues, l’arme au poing dans le but de récupérer le magot, ne s’expliquerait dès lors que s’il agissait sous l’effet d’une pulsion suicidaire. Eu égard au profil psychologique esquissé, cela semble peu vraisemblable. D’autre part, j’ai été très surpris que personne ne relève le traitement réservé aux personnages féminins. Elles sont de ravissantes écervelées. Kim Novak, plus potiche que jamais, tombe amoureuse transie (elle obéit comme une oie à toutes les injonctions de son amant) en 14 secondes chrono (le temps de se remaquiller en se regardant dans le rétroviseur durant le « levage » de son capot – métaphore subtile… – par Mc Murray). Dorothy Malone, elle, est prise à partie par un type très insistant qu’elle a eu la faiblesse de ramener jusqu’à son immeuble, mais succombe en un éclair au charme du policier baraqué (on la verra mimer la corpulence de celui-ci à sa roommate, soulignant par là son appréciation de la carrure de celui-ci) qui l’a débarrassée de l’opportun, policier dont l’idéal féminin pourra se prétendre être au moins à moitié honnête versus, je cite, les « voleuses, entôleuses, garces », ce à quoi Mc Murray le met en garde car ce sont les plus « roublardes ».
Et d’ailleurs, l’argent (vison, auto) représente le lien unique entre Novak et son gangster d’amoureux, d’après Mc Murray. Cette accumulation de maximes caricaturales et cette fuite en avant animée par « la bêtise au front de taureau » fustigée par Charles, m’ont paru extrêmement vieillies.
Pour ce coup, STRANGERS WHEN WE MEET m’a semblé beaucoup plus intéressant. Sur une base de scénario vieux comme le monde (des histoires d’attirances extra-conjugales au sein d’un neighborhood de Los Angeles) et exploité encore aujourd’hui par des séries à très gros succès, les personnages sont peints avec beaucoup plus de subtilité. Et le charisme de Kirk Douglas me semble tellement plus vraisemblable, alors même que Kim Novak y résistera bien plus longtemps que dans le cas précédent. J’ai beaucoup aimé la scène du premier regard échangé, devant l’école, où Novak s’accroupit afin de fermer le manteau de son fils et dont le visage apparaît ainsi dans le cadre la fenêtre de la portière passager de la voiture de Douglas. Reconnaissons aussi que le scénario est plus riche que le motif de base et l’originalité apportée par la profession de Douglas, architecte, offre le formidable leitmotiv de la construction de la villa, laquelle offre elle-même l’opportunité de rencontres piquantes entre son commanditaire, écrivain désabusé alcoolique (là aussi, que du classique) très finement campé par Ernie Kovacs (même si là encore il est accompagné d’une idiote) ou de rencontres des amants dans cette maison qui demeurera un phantasme représentant l’écrin d’une vie commune impossible. Et comment ne pas jouir de l’ambiguïté du personnage joué par le génial Walter Matthau ? Pour le coup, j’ai découvert SEA OF LOVE auquel vous faisiez allusion via une citation de la scène du supermarché et j’avoue être très réservé quant à votre proposition. Hormis le travelling latéral le long des rayons et les amoncellements réglementaires de boîtes de conserve traversant le champ, la scène de voyeurisme entre Al Pacino et Ellen Barkin ne me semble pas avoir quelque rapport avec celle tournée par Quine. Elle me semble même antagoniste puisque c’est dans celle-ci que Douglas lance à Novak qu’elle n’est pas une femme si attirante que ça, et qu’elle donne lieu à l’échange malencontreux, comme un acte manqué, d’un paquet de Corn Flakes acheté par Novak et qui, via un échange entre caddies, finit entre les mains, étonnées, de l’épouse de Douglas (Barbara Rush), constituant de fait un ressort du scénario. La qualité de la copie ne rendait pas compte hélas de la photo en Cinémascope et Eastman Color, qui convient si bien à la Californie. Aussi, malgré une fin très conventionnelle, comme Pierre, je vote pour cet opus-ci, plutôt que pour l’autre.
Amicalement.
D. H.
INCIDENT DE FRONTIERE est déjà sorti.
A paraître, pour Noël, un coffret toujours chez Wild side, avec quelques titres déjà dispos + Border incident :
T-Men, Side street, Marché de brutes, Le Petit arpent et Côte 465.
Belle réédition, donc. Merci pour ces notes sur les Films noirs.
« FILM NOIR CLASSICS II (sous titres anglais) nous offre HUMAN DESIRE, le remake de la BÊTE HUMAINE par Lang qui m’avait plu… »
J’ai vu ce film pour la première fois il y a quelques jours, Gloria Grahame et Broderick Crawford sont très bien mais Glenn Ford est toujours aussi fade, il n’a pas en comparaison le sex-appeal que Jean Gabin avait et qui rendait son personnage bien + crédible …
NIGHTFALL est passé il y a peu au Ciné-Club de la 3, merci Mr Brion.
Sur NIGHTFALL, j’avais eu la chance de lire le livre de Goodis (chez Rivages Noir) avant de découvrir le film diffusé au cinéma de minuit. Je trouve qu’Aldo Ray et Anne Bancroft sont bien dans leurs rôles et le début du film jusqu’à leur rencontre restitue bien l’atmosphère du roman. C’est ensuite que les choses se gâtent : Tourneur et son scénariste ont passé à la moulinette l’histoire tortueuse et psychologique écrite avec un talent fou par Goodis. Tourneur n’en fait plus qu’une course au mâgot… Le film ne dure qu’1h15. Il en aurait presque fallu le double pour restituer toute la complexité de l’histoire écrite par Goodis. Dommage… Et pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que seul Tourneur (ou Lang) était en mesure de réussir l’adaptation de ce roman…
A Damien Doussin
Je viens de voir NIGHTFALL et j’ai trouvé ce polar très réussi. Mais je ne suis pas d’accord avec vous car je n’ai pas eu l’impression d’un fin gâchée : au contraire, cette certes « course au mâgot », est extraodinaire par ses magnifiques plans dans la neige ! De plus , je trouve que la durée du film est parfaitement calculée : en 1h15, tout est dit, simple et efficace.
C’est amusant car le (très grand) film des frères Coen FARGO est assez inspiré de NIGHTFALL.
I think Lerner’s minimalistic style is quite apt for the constricted mean little world of the Edwards character (whose end fits the parameters of his vision)in MURDER BY CONTRACT. In the broader canvas of CITY OF FEAR, the same approach just looks impoverished especially when some distraction from the inanities of the plot (radioactive explosive kept in prison lab presumably to facilitate theft of same and stored in container slightly less permeable than lunchbox thermos to permit slow irradiation of thieving convict, yes, it’s Edwards again) would be most helpful. As would characters like the Welcome to L.A. duo of hoods in MURDER… who seem to have driven in from the future, possibly from some Cassavetes movie.
bonjour monsieur Tavernier,
L’idée comme quoi The sniper est l’antithèse de Dirty Harry me paraît bien vue. Me permettrez vous alors de dire alors qu’autant Dirty Harry est sec, nerveux et percutant autant le film de Dmytrik est lent et plombé par les intentions des auteurs? C’est peut-être malheureux pour le progressisme mais je crois que ne pas tenter d’expliquer le comportement du meurtrier rend le film meilleur.
Human desire est un très grand film de Fritz Lang, vraiment sous-estimé à mon sens. Je l’ai trouvé aussi presque aussi tragique, aussi épuré que L’invraisemblable vérité et La cinquième victime.
Je suis peut-être dingo mais Pushover, à mon avis le chef d’oeuvre de Quine, me fait penser à Jean-Pierre Melville autant qu’à Assurance sur la mort. La relative abstraction de la mise en scène peut-être, la conscience des codes du noir, l’objectif essentiellement « fascinatoire » de la mise en scène d’un réalisateur amoureux.
Tout à fait d’accord avec vous sur Nightfall dont le final m’a fait pensé à Fargo (mais Tourneur filme mieux la campagne enneigée que les frères Coen).
Dans les polars français récents, qu’avez vous pensé de La proie et du Convoyeur? Je tiens Le convoyeur pour un authentique chef d’oeuvre.
Bonjour Monsieur,
Encore plein de références que je vais m’empressé de trouver!
Je souhaitais pour ma part vous conseiller de visionner « Animal Kingdom » de David Michôd, je suis sur que ce film noir australien saura trouver grâce à vos yeux!
Bonne continuation et encore bravo pour votre blog.
Godefroy
A Godefroy
J’ai beaucoup aimé ce film.