Coffrets et redécouvertes : Pascal Thomas, Costa-Gavras et Lino Brocka
16 avril 2018 par Bertrand Tavernier - DVD
COFFRETS
Sur le COFFRET FEUILLADE (Gaumont), que dire sinon qu’il est indispensable. Que revoir FANTOMAS avec bien sûr Juve et Fandor ou LES VAMPIRES est une expérience envoûtante. Comme ce cinéma tient le coup, comme il paraît souvent moderne dans sa facture. Le travail d’édition est exceptionnel.
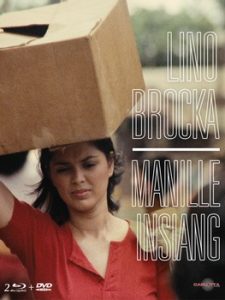 Je n’aurai pas assez de mots pour célébrer la beauté incandescente du COFFRET LINO BROCKA et cette plongée dans la misère où se débat l’héroïne de INSIANG. Rarement on a filmé avec une telle force la promiscuité avec ses dérapages, la puissance d’une mentalité machiste que de beaux esprits ont tort de réduire aux hétérosexuels blancs. Brocka pose un regard de chagrin et de pitié sur cette histoire de viol et de revanche. Comme l’écrit Critikat : « Tourné en onze jours en décor réel avec des acteurs professionnels peu connus, le film affirme une mise en scène âpre, allant à l’essentiel par des zooms qui mettent en exergue les sujets principaux ou de coupes abrasives qui accélèrent brusquement la fin des scènes. Il documente le labeur des femmes, toutes prisonnières d’étals où elles vendent de l’épicerie ou du poisson, et l’oisiveté malfaisante des hommes.
Je n’aurai pas assez de mots pour célébrer la beauté incandescente du COFFRET LINO BROCKA et cette plongée dans la misère où se débat l’héroïne de INSIANG. Rarement on a filmé avec une telle force la promiscuité avec ses dérapages, la puissance d’une mentalité machiste que de beaux esprits ont tort de réduire aux hétérosexuels blancs. Brocka pose un regard de chagrin et de pitié sur cette histoire de viol et de revanche. Comme l’écrit Critikat : « Tourné en onze jours en décor réel avec des acteurs professionnels peu connus, le film affirme une mise en scène âpre, allant à l’essentiel par des zooms qui mettent en exergue les sujets principaux ou de coupes abrasives qui accélèrent brusquement la fin des scènes. Il documente le labeur des femmes, toutes prisonnières d’étals où elles vendent de l’épicerie ou du poisson, et l’oisiveté malfaisante des hommes.
Ces cousins d’Asie du sud-est des ragazzi filmés quelques années plus tôt dans le Trastevere, imposent au sexe faible des relations de violence et de possession. Comme chez PPP, filmer pour la première fois les lieux et les corps des oubliés de la société ne vaut que pour les hisser à hauteur de mélodrame. Unique figure de pureté, la jeune Insiang s’annonce d’emblée comme la grande sacrifiée de ce monde corrompu. Aimée, instrumentalisée, convoitée, jugée : chaque membre de son entourage en viendra à la trahir, la poussant sur la voie d’un désir de revanche froid et calculateur. Car comme chez Pasolini également, la misère ne laisse aux pauvres d’autre choix que de se violenter entre eux. »
COFFRET LA LIBÉRATION (Bach Films, DVD et Blu-ray)
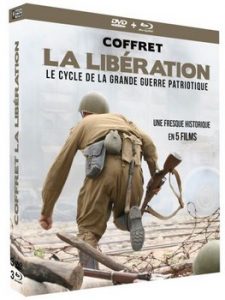 Cinq films russes de Youri Ozerov présentés dans de belles copies, filmés avec des moyens énormes, des masses de figurants, de tanks, ce qui nous vaut des séquences rarement vues, le plus souvent tournées en plans larges pour bien montrer les qualités, les vertus de l’Armée Rouge dont on minimise souvent le rôle. On ne voit guère, propagande oblige, les souffrances individuelles… Dans OPÉRATION BAGRATION, on nous offre un mini remake de NORMANDIE NIEMEN du point de vue soviétique. Bonne occasion de rappeler le film sobre de Jean Dréville, dialogué par Charles Spaak, où tout le monde parlait sa langue (Gaumont).Ces cinq longs-métrages battent sans doute tous les records quant au nombre de maréchaux et de généraux super médaillés : on en voit plusieurs dizaines par film. Staline est montré de manière bienveillante comme quelqu’un qui écoute et on ne pointe pas les nombreuses erreurs commises au début et l’extermination de nombreux officiers supérieurs. Les alliés sont naturellement fourbes et guère ressemblants. Il faut voir en priorité LA BATAILLE POUR BERLIN et le DERNIER ASSAUT où l’on trouve des plans stupéfiants. Ce qui précède est parfois monotone et on cherche un point de vue original comme chez Ermler ou du lyrisme à la Dovjenko.
Cinq films russes de Youri Ozerov présentés dans de belles copies, filmés avec des moyens énormes, des masses de figurants, de tanks, ce qui nous vaut des séquences rarement vues, le plus souvent tournées en plans larges pour bien montrer les qualités, les vertus de l’Armée Rouge dont on minimise souvent le rôle. On ne voit guère, propagande oblige, les souffrances individuelles… Dans OPÉRATION BAGRATION, on nous offre un mini remake de NORMANDIE NIEMEN du point de vue soviétique. Bonne occasion de rappeler le film sobre de Jean Dréville, dialogué par Charles Spaak, où tout le monde parlait sa langue (Gaumont).Ces cinq longs-métrages battent sans doute tous les records quant au nombre de maréchaux et de généraux super médaillés : on en voit plusieurs dizaines par film. Staline est montré de manière bienveillante comme quelqu’un qui écoute et on ne pointe pas les nombreuses erreurs commises au début et l’extermination de nombreux officiers supérieurs. Les alliés sont naturellement fourbes et guère ressemblants. Il faut voir en priorité LA BATAILLE POUR BERLIN et le DERNIER ASSAUT où l’on trouve des plans stupéfiants. Ce qui précède est parfois monotone et on cherche un point de vue original comme chez Ermler ou du lyrisme à la Dovjenko.
Pour se détendre, un retour au coffret PRESTON STURGES est indispensable (Wild Side) En dehors d’INFIDÈLEMENT VÔTRE qui s’épuise après le premier tiers et de HAIL THE CONQUERING HERO qui ne tient pas toutes ses promesses, quel régal. De CHRISTMAS IN JULY (un pur délice) à THE PALM BEACH STORY avec ce personnage de milliardaire qui note dans un carnet toutes ses dépenses mais ne fait jamais d’additions, aux VOYAGES DE SULLIVAN, c’est une cure de joies, d’ironie. J’ai déjà évoqué la plupart de ces œuvres. Dommage de n’avoir pas inclus l’irrésistible MIRACLE AU VILLAGE/THE MIRACLE OF MORGAN CREEK. Très bonnes interventions de Marc Cerisuelo et Philippe Garnier.
COFFRET PASCAL THOMAS
Autre grand moment de plaisir que cette plongée dans les films de Pascal Thomas, l’occasion de revoir ces merveilleux coups d’essai qu’étaient Le POÈME DE L’ÉLÈVE MIKOVSKY, ce court métrage où déjà apparaissent tous ses personnages (pas encore les filles), ces notations drolatiques et parfois très dures – bizutages violents, humiliation dans le voisinage des parents (il y a un plan extraordinaire sur Mikovsky, le souffre-douleur qui vient courir les rejoindre) – qu’on retrouve dans LES ZOZOS. Même dans une œuvre nettement plus relâchée comme LA SURPRISE DU CHEF (et que Pascal Thomas affirme n’avoir jamais vue), on trouve un premier quart d’heure absolument hilarant où Hubert Watrinet, rédacteur en chef d’un magazine, parvient à répondre instantanément à toutes les questions, que ce soit sur l’économie, l’évolution d’un mouvement pictural avec Mondrian et Klee, l’ouverture du diaphragme à telle lumière, le temps que prend un trajet avec les bonnes correspondances en queue ou en tête de train.
 Et la redécouverte de PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE a été un grand moment d’émotion devant la justesse des gestes, du dialogue, la manière frontale dont Pascal Thomas aborde, dans cette éducation sentimentale campagnarde, des petits faits concrets qu’on n’évoquait pas dans les films de cette époque, l’arrivée des règles. C’est toute une France qui revit avec ses personnages chaleureux et irrésistibles comme ce père en apparence sévère que campe de manière gouleyante un Jean Carmet royal, totalement à l’aise avec des actrices peu professionnelles mais rayonnantes de fraicheur et de vérités : la merveilleuse et si juste Annie Colé, l’un des plus beaux personnage d’adolescente, n’avait joué que dans LES ZOZOS. Et Thomas mélangeait ces amateurs (Frédéric Duru et des gens du village) avec des comédiens aguerris comme Hélène Dieudonné qui jouait au temps du muet et Daniel Ceccaldi. Son arrivée dans PLEURE PAS… nous vaut plusieurs moments d’anthologie : un fin de repas où Carmet rote (« honneur à la cuisinière) et une tentative insistante de drague (qu’on appellerait maintenant, à juste titre, du harcèlement) qui échoue lamentablement face la résistance discrète mais efficace d’Annie Colé. Bernard Menez en dragueur indécollable (et finalement assez bonne patte) est éblouissant. Lui aussi a plusieurs moments qu’on n’oublie pas, notamment quand il se prépare à faire l’amour. Nul puritanisme dans le regard de Thomas mais une tendresse parfois gaillarde, parfois délicate que vient pimenter un sens aigu de la cocasserie.
Et la redécouverte de PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE a été un grand moment d’émotion devant la justesse des gestes, du dialogue, la manière frontale dont Pascal Thomas aborde, dans cette éducation sentimentale campagnarde, des petits faits concrets qu’on n’évoquait pas dans les films de cette époque, l’arrivée des règles. C’est toute une France qui revit avec ses personnages chaleureux et irrésistibles comme ce père en apparence sévère que campe de manière gouleyante un Jean Carmet royal, totalement à l’aise avec des actrices peu professionnelles mais rayonnantes de fraicheur et de vérités : la merveilleuse et si juste Annie Colé, l’un des plus beaux personnage d’adolescente, n’avait joué que dans LES ZOZOS. Et Thomas mélangeait ces amateurs (Frédéric Duru et des gens du village) avec des comédiens aguerris comme Hélène Dieudonné qui jouait au temps du muet et Daniel Ceccaldi. Son arrivée dans PLEURE PAS… nous vaut plusieurs moments d’anthologie : un fin de repas où Carmet rote (« honneur à la cuisinière) et une tentative insistante de drague (qu’on appellerait maintenant, à juste titre, du harcèlement) qui échoue lamentablement face la résistance discrète mais efficace d’Annie Colé. Bernard Menez en dragueur indécollable (et finalement assez bonne patte) est éblouissant. Lui aussi a plusieurs moments qu’on n’oublie pas, notamment quand il se prépare à faire l’amour. Nul puritanisme dans le regard de Thomas mais une tendresse parfois gaillarde, parfois délicate que vient pimenter un sens aigu de la cocasserie.
 CONFIDENCES POUR CONFIDENCES est un pur chef d’œuvre et peut-être le film le plus personnel de son réalisateur : une chronique douce-amère, qui prend son temps avec les sentiments, les déceptions, les écorchures de la vie dont la conclusion poignante évoque le « désespoir tranquille » dont parle Henry David Thoreau : cette rencontre sous la pluie où les deux protagonistes se rendent compte qu’il sont passé à côté l’un de l’autre, où l’on sent l’usure du temps, le poids de ce qu’on a vécu, n’a rien à envier avec la conclusion si célèbre de LA FIÈVRE DANS LE SANG. Toute une vie qui part de Courbevoie et qui se termine provisoirement sous des trombes d’eau. Une vie où l’on croise des personnages à la fois extraordinaires et quotidiens, de ce couple de parents magistralement incarnés par Daniel Ceccaldi, ce père qui n’en fout pas une rame et Laurence Lignères, leurs trois filles à la fois soudées et si différentes et ce cousin, une des créations immenses de Michel Galabru, qui vient se réchauffer auprès de leur malheur. Ce cousin fort en gueule (mais terriblement faible), ancien militaire qui lance : « On a perdu l’Algérie mais on a gardé les Arabes. » La séquence où il se fait lourder par la mère est anthologique. CONFIDENCES POUR CONFIDENCES est admirablement écrit avec Jacques Lourcelles et le dialogue est un régal. Dans une autre chronique, je reviendrai sur CELLES QU’ON N’A PAS EUES et LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS, sans oublier LE CHAUD LAPIN (toujours Lourcelles comme LA DILETTANTE) et son fameux gag.
CONFIDENCES POUR CONFIDENCES est un pur chef d’œuvre et peut-être le film le plus personnel de son réalisateur : une chronique douce-amère, qui prend son temps avec les sentiments, les déceptions, les écorchures de la vie dont la conclusion poignante évoque le « désespoir tranquille » dont parle Henry David Thoreau : cette rencontre sous la pluie où les deux protagonistes se rendent compte qu’il sont passé à côté l’un de l’autre, où l’on sent l’usure du temps, le poids de ce qu’on a vécu, n’a rien à envier avec la conclusion si célèbre de LA FIÈVRE DANS LE SANG. Toute une vie qui part de Courbevoie et qui se termine provisoirement sous des trombes d’eau. Une vie où l’on croise des personnages à la fois extraordinaires et quotidiens, de ce couple de parents magistralement incarnés par Daniel Ceccaldi, ce père qui n’en fout pas une rame et Laurence Lignères, leurs trois filles à la fois soudées et si différentes et ce cousin, une des créations immenses de Michel Galabru, qui vient se réchauffer auprès de leur malheur. Ce cousin fort en gueule (mais terriblement faible), ancien militaire qui lance : « On a perdu l’Algérie mais on a gardé les Arabes. » La séquence où il se fait lourder par la mère est anthologique. CONFIDENCES POUR CONFIDENCES est admirablement écrit avec Jacques Lourcelles et le dialogue est un régal. Dans une autre chronique, je reviendrai sur CELLES QU’ON N’A PAS EUES et LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS, sans oublier LE CHAUD LAPIN (toujours Lourcelles comme LA DILETTANTE) et son fameux gag.
Comme l’écrit Jérémie Couston dans TELERAMA : « Quand je regarde un film de Pascal Thomas (période 1973-1981), je n’ai pas seulement l’impression de voir palpiter la France de Giscard qui m’a vu naître, j’ai carrément le sentiment de voir, étalée sur grand écran, la vie quotidienne et intime de mes propres parents. D’où un pincement au cœur, accompagné d’un léger vertige spatio-temporel. Comme si j’étais autorisé à voyager dans le passé pour assister aux scènes d’enfance que ma mémoire a effacées. Un coffret DVD vient justement de sortir pour relancer la machine à remonter le temps, qui rassemble sept comédies issues de cette décennie prodigieuse, de loin la plus fertile, et la plus personnelle, de son auteur. Une énumération s’impose tant les titres des films de Pascal Thomas possèdent, déjà, une irrésistible touche seventies : Les Zozos (1973), Pleure pas la bouche pleine ! (1973), Le Chaud Lapin (1974), La Surprise du chef (1976), Confidences pour confidences (1979), Celles qu’on n’a pas eues (1981), Les Maris, les femmes, les amants (1989). Ce dernier film, bien que réalisé après huit années de pause, a toute sa place dans le lot car il est très proche des précédents, tant dans le style (naturaliste) que dans l’esprit (libertaire). Je me souviens avoir lu une critique de Chacun cherche son chat à sa sortie, dans Positif, qui disait très justement que si les cinéphiles du futur se demandent un jour à quoi ressemblait la France de 1996 dans le quartier de Bastille, à Paris, le film de Klapisch leur en donnera une idée précise. Il en va de même avec les films de Pascal Thomas, qui ont cette capacité rare et précieuse, bien que souvent méprisée par les esthètes, de capter l’air du temps. Pour savoir comment on vivait dans un village du Poitou au début des années 1970, il faut voir le délicieux Pleure pas la bouche pleine ! Pour partager la vie d’une famille de la classe moyenne dans les années 1960, à Courbevoie, il faut se précipiter sur l’émouvant Confidences pour confidences. Ce parfum de nostalgie familiale et provinciale, de pot-au-feu et de crème crue, qui s’échappe des comédies de Pascal Thomas, lui a valu d’être classé parmi les antimodernes, à l’autre bout du chemin défriché par ses aînés de la Nouvelle Vague. »
COFFRETS COSTA-GAVRAS
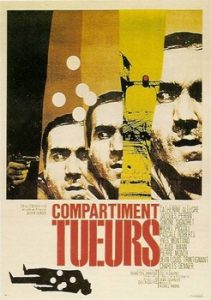 Dans le volume 1, je signalerais COMPARTIMENT TUEURS qui tient le coup tant pour le rythme que pour les acteurs tous formidables jusque dans les petits rôles (Monique Chaumette dont l’apparition est épatante et Bernadette Lafont). Mais surtout ce qui m’a touché au-delà de l’intrigue policière, c’est comment le film, à travers cette histoire de meurtres, saisissait toute une époque à travers déjà l’univers des wagons-lits, des voyages en train qui duraient une nuit avec des rituels qu’on ne connaît plus, des rapports familiaux qui depuis se sont désintégrés. Le poids de la famille est important pour plein de personnage et de manière touchante : Perrin, Catherine Allégret qui est délicieuse. Et puis il y a ces studios sans téléphone et les billets de quai, toute une France qui devient historique, ce qui ajoute de la chair, de la nostalgie à cette histoire bien racontée. Montand est superbe, tout comme Piccoli dans un personnage très glauque et Charles Denner, une fois de plus, irrésistible.
Dans le volume 1, je signalerais COMPARTIMENT TUEURS qui tient le coup tant pour le rythme que pour les acteurs tous formidables jusque dans les petits rôles (Monique Chaumette dont l’apparition est épatante et Bernadette Lafont). Mais surtout ce qui m’a touché au-delà de l’intrigue policière, c’est comment le film, à travers cette histoire de meurtres, saisissait toute une époque à travers déjà l’univers des wagons-lits, des voyages en train qui duraient une nuit avec des rituels qu’on ne connaît plus, des rapports familiaux qui depuis se sont désintégrés. Le poids de la famille est important pour plein de personnage et de manière touchante : Perrin, Catherine Allégret qui est délicieuse. Et puis il y a ces studios sans téléphone et les billets de quai, toute une France qui devient historique, ce qui ajoute de la chair, de la nostalgie à cette histoire bien racontée. Montand est superbe, tout comme Piccoli dans un personnage très glauque et Charles Denner, une fois de plus, irrésistible.
 Revoir SECTION SPÉCIALE a été une expérience emballante. Le film n’a pas pris une ride. Ce que cela dit sur la Justice est incroyablement actuel même si on ne peut pas comparer les époques. Le portrait qu’il trace de ces magistrats accrochés à leurs privilèges, prêt à renier, à enterrer tout ce qui fonde la Loi, à accepter des sentences rétroactives (ce qui stupéfie les Allemands) qui piétinent toute notion de Justice pour faire plaisir au Pouvoir, est glaçant. Comme disait un journaliste du Canard, il y a eu des militaires qui se sont battus pour Dreyfus mais aucun magistrat. Mais si le film touche, c’est parce que le propos est incarné à travers des acteurs irréprochables, qui se sont tous investis. On sent la proximité que Costa a avec eux à la manière dont ils s’emparent des scènes et des personnages. Ce sont des qualités que j’adore chez Becker ou Renoir et là dans le moindre petit rôle on retrouve cette veine. Pas seulement chez Galabru, admirable dans sa manière de passer de la timidité modeste (son entrée est formidable) à un sursaut de dignité et d’indignation qui cloue Louis Seigner. Lequel Seigner dissèque la descente aux enfers de son personnage, qui passe de la rigueur morale à la servilité. Il faut le voir s’énervant au téléphone pour son voyage à Agen, se défoulant ainsi de sa bassesse. Et Jean Bouise qui brusquement, refuse de se plier aux ordres se dissociant. Perrin, dès son apparition donne une extraordinaire force émotionnelle à l’avocat qu’il incarne. Enfin tous de Barbier à Bertheau et bien sûr de Lonsdale à François Maistre. Et il y a ces brusques irruptions de la vie quotidienne à Vichy, cette femme qui perd une poule et la pourchasse, ces deux gendarmes contents que l’heure du déjeuner arrive (ah, ce sourire du second dont on se dit qu’il doit être un fils de paysan rien qu’avec cette réaction, si juste). Et Piéplu se promenant dans les couloirs du Palais, serrant les mains avec jovialité après avoir envoyé trois personnes à la mort. Costa a su aussi capter ce qu’il y avait de dérisoire et d’absurde dans la théâtralité de ce procès avec ces juges en habit qui sortent pompeusement pour revenir avec une sentence connue à l’avance qui multiplie par dix, par cent les premières peines. Car, comble de l’iniquité, on jugeait des gens déjà jugés.
Revoir SECTION SPÉCIALE a été une expérience emballante. Le film n’a pas pris une ride. Ce que cela dit sur la Justice est incroyablement actuel même si on ne peut pas comparer les époques. Le portrait qu’il trace de ces magistrats accrochés à leurs privilèges, prêt à renier, à enterrer tout ce qui fonde la Loi, à accepter des sentences rétroactives (ce qui stupéfie les Allemands) qui piétinent toute notion de Justice pour faire plaisir au Pouvoir, est glaçant. Comme disait un journaliste du Canard, il y a eu des militaires qui se sont battus pour Dreyfus mais aucun magistrat. Mais si le film touche, c’est parce que le propos est incarné à travers des acteurs irréprochables, qui se sont tous investis. On sent la proximité que Costa a avec eux à la manière dont ils s’emparent des scènes et des personnages. Ce sont des qualités que j’adore chez Becker ou Renoir et là dans le moindre petit rôle on retrouve cette veine. Pas seulement chez Galabru, admirable dans sa manière de passer de la timidité modeste (son entrée est formidable) à un sursaut de dignité et d’indignation qui cloue Louis Seigner. Lequel Seigner dissèque la descente aux enfers de son personnage, qui passe de la rigueur morale à la servilité. Il faut le voir s’énervant au téléphone pour son voyage à Agen, se défoulant ainsi de sa bassesse. Et Jean Bouise qui brusquement, refuse de se plier aux ordres se dissociant. Perrin, dès son apparition donne une extraordinaire force émotionnelle à l’avocat qu’il incarne. Enfin tous de Barbier à Bertheau et bien sûr de Lonsdale à François Maistre. Et il y a ces brusques irruptions de la vie quotidienne à Vichy, cette femme qui perd une poule et la pourchasse, ces deux gendarmes contents que l’heure du déjeuner arrive (ah, ce sourire du second dont on se dit qu’il doit être un fils de paysan rien qu’avec cette réaction, si juste). Et Piéplu se promenant dans les couloirs du Palais, serrant les mains avec jovialité après avoir envoyé trois personnes à la mort. Costa a su aussi capter ce qu’il y avait de dérisoire et d’absurde dans la théâtralité de ce procès avec ces juges en habit qui sortent pompeusement pour revenir avec une sentence connue à l’avance qui multiplie par dix, par cent les premières peines. Car, comble de l’iniquité, on jugeait des gens déjà jugés.
Dans le volume 2, j’avais évoqué ici même LE COUPERET, remarquable adaptation par Costa-Gavras et Jean-Claude Grumberg d’un fort bon roman de Donald Westlake Le héros de ce livre commettait des crimes dans plusieurs états si bien que cela brouillait les pistes (à mon avis, cela foutait par terre l’adaptation française de LA MARIÉE EST EN NOIR). Costa et Grumberg avaient eu l’idée de génie de transposer l’action dans ces zones inter-frontalières entre la France, la Belgique et le Luxembourg. En attendant de revoir LE CAPITAL ou CONSEIL DE FAMILLE, je recommande chaleureusement MUSIC BOX, œuvre très puissante sur la mémoire, magnifiquement jouée par Jessica Lange.
 Dans mon souvenir BETRAYED/LA MAIN DROITE DU DIABLE, également produit par Irwin Winkler, était plus inégal, en partie à cause du scénario de Joe Esterhaz qui était beaucoup moins bon que celui de MUSIC BOX. Ce fut d’ailleurs un scénariste plus que discutable qui écrivait souvent au flanc et dont plusieurs œuvres furent portées, dynamisées, vivifiées par les metteurs en scène quoi qu’il en dise dans ses conseils terriblement égocentriques : « 1. Ne voyez pas trop de films récents. La plupart des films qui sortent aujourd’hui sont épouvantables. Ils vous déprimeront. Vous penserez : « Comment ont-ils pu porter à l’écran cet abominable scénario plutôt que d’acheter le mien ? » Epargnez-vous cette angoisse. Lisez plutôt un bon livre. 2. Ne mâchez pas vos mots. Si l’idée que vous suggère un exécutif est merdique, ne dites-pas « Eh bien c’est intéressant, mais… ». Dites : « C’est vraiment une idée merdique. » Les personnes à qui vous avez affaire ne sont pas stupides – elles sont juste futiles. Au fond de leur cœur, elles savent que cette idée est merdique. 3. Ne les laissez pas vous convaincre de changer ce que vous avez écrit. Un réalisateur n’est pas un auteur. Un producteur ou un exécutif non plus. Vous gagnez votre vie en écrivant. C’est vous le pro. Ils sont des amateurs. Des dilettantes au mieux. Traitez-les en tant que tels. Faites-leur sentir que c’est ce qu’ils sont. 4. Ne pitchez pas des histoires, écrivez des spec-scripts. Pourquoi essayer de convaincre une salle pleine d’égocentriques incultes que vous pouvez écrire un bon scénario sur tel ou tel sujet ? Asseyez-vous simplement et écrivez ce fichu sujet. C’est bien plus honnête de faire bien quelque chose plutôt que de promettre de le faire bien. 5. Ecrivez avec votre cœur. La vie est courte; bien plus courte que vous ne le pensez. Ne faites pas du travail de mercenaire. Si un studio veut vous embaucher pour écrire quelque chose, faites-le uniquement si le job a une résonance spirituelle, psychique ou sexuelle en vous. 6. Mentez toujours au sujet de votre premier jet. J’ai prétendu que je travaillais sur le scénario de BASIC INSTINCT depuis des années lorsque je l’ai vendu pour une somme record. Lorsque le film est devenu le plus gros succès commercial de l’année 1992, j’ai dit la vérité : il m’a fallu treize jours pour l’écrire. 7. Rappelez-vous les secrets de famille. Si vous êtes bloqué, ne savez pas à propos de quoi écrire, pensez à toutes ces choses dont on ne parle pas au sein de votre famille. Quelque-part là-dedans se cache au moins un bon scénario. 8. Face au réalisateur, ne pliez-pas. Qu’importe à quel point il est charmant, le réalisateur n’est ni votre ami, ni votre collaborateur. Il est votre ennemi. Il veut imposer sa vision créative par rapport à la vôtre. Il veut prendre ce que vous avez écrit, se l’approprier et en retirer tout le crédit. 9. Noircissez un peu votre cœur. Mon ancien et très cher agent, Guy McElwaine, m’a dit: « Il n’y a pas de cœur plus noir que le cœur noir d’un agent. » Même s’il a été mon agent pendant très longtemps – et même si je l’aimais vraiment – est arrivé un jour où je l’ai viré. 10. Ne laissez pas les bâtards vous descendre. Si vous ne parvenez pas à vendre le scénario, ou si vous vendez le scénario mais qu’ils engagent un autre scénariste pour le massacrer, ou si le réalisateur s’attribue tout le mérite de l’écriture dans les interviews, ou si les acteurs prétendent avoir improvisé vos meilleurs répliques, ou si vous êtes mis à l’écart des conférences de presse, asseyez-vous simplement et écrivez un autre scénario. Et si la même mésaventure vous arrive avec celui-là, écrivez-en un autre, et un autre et encore un autre, jusqu’à ce que vous en ayez un qui soit porté sur grand écran par un réalisateur, mais avec votre propre vision. »
Dans mon souvenir BETRAYED/LA MAIN DROITE DU DIABLE, également produit par Irwin Winkler, était plus inégal, en partie à cause du scénario de Joe Esterhaz qui était beaucoup moins bon que celui de MUSIC BOX. Ce fut d’ailleurs un scénariste plus que discutable qui écrivait souvent au flanc et dont plusieurs œuvres furent portées, dynamisées, vivifiées par les metteurs en scène quoi qu’il en dise dans ses conseils terriblement égocentriques : « 1. Ne voyez pas trop de films récents. La plupart des films qui sortent aujourd’hui sont épouvantables. Ils vous déprimeront. Vous penserez : « Comment ont-ils pu porter à l’écran cet abominable scénario plutôt que d’acheter le mien ? » Epargnez-vous cette angoisse. Lisez plutôt un bon livre. 2. Ne mâchez pas vos mots. Si l’idée que vous suggère un exécutif est merdique, ne dites-pas « Eh bien c’est intéressant, mais… ». Dites : « C’est vraiment une idée merdique. » Les personnes à qui vous avez affaire ne sont pas stupides – elles sont juste futiles. Au fond de leur cœur, elles savent que cette idée est merdique. 3. Ne les laissez pas vous convaincre de changer ce que vous avez écrit. Un réalisateur n’est pas un auteur. Un producteur ou un exécutif non plus. Vous gagnez votre vie en écrivant. C’est vous le pro. Ils sont des amateurs. Des dilettantes au mieux. Traitez-les en tant que tels. Faites-leur sentir que c’est ce qu’ils sont. 4. Ne pitchez pas des histoires, écrivez des spec-scripts. Pourquoi essayer de convaincre une salle pleine d’égocentriques incultes que vous pouvez écrire un bon scénario sur tel ou tel sujet ? Asseyez-vous simplement et écrivez ce fichu sujet. C’est bien plus honnête de faire bien quelque chose plutôt que de promettre de le faire bien. 5. Ecrivez avec votre cœur. La vie est courte; bien plus courte que vous ne le pensez. Ne faites pas du travail de mercenaire. Si un studio veut vous embaucher pour écrire quelque chose, faites-le uniquement si le job a une résonance spirituelle, psychique ou sexuelle en vous. 6. Mentez toujours au sujet de votre premier jet. J’ai prétendu que je travaillais sur le scénario de BASIC INSTINCT depuis des années lorsque je l’ai vendu pour une somme record. Lorsque le film est devenu le plus gros succès commercial de l’année 1992, j’ai dit la vérité : il m’a fallu treize jours pour l’écrire. 7. Rappelez-vous les secrets de famille. Si vous êtes bloqué, ne savez pas à propos de quoi écrire, pensez à toutes ces choses dont on ne parle pas au sein de votre famille. Quelque-part là-dedans se cache au moins un bon scénario. 8. Face au réalisateur, ne pliez-pas. Qu’importe à quel point il est charmant, le réalisateur n’est ni votre ami, ni votre collaborateur. Il est votre ennemi. Il veut imposer sa vision créative par rapport à la vôtre. Il veut prendre ce que vous avez écrit, se l’approprier et en retirer tout le crédit. 9. Noircissez un peu votre cœur. Mon ancien et très cher agent, Guy McElwaine, m’a dit: « Il n’y a pas de cœur plus noir que le cœur noir d’un agent. » Même s’il a été mon agent pendant très longtemps – et même si je l’aimais vraiment – est arrivé un jour où je l’ai viré. 10. Ne laissez pas les bâtards vous descendre. Si vous ne parvenez pas à vendre le scénario, ou si vous vendez le scénario mais qu’ils engagent un autre scénariste pour le massacrer, ou si le réalisateur s’attribue tout le mérite de l’écriture dans les interviews, ou si les acteurs prétendent avoir improvisé vos meilleurs répliques, ou si vous êtes mis à l’écart des conférences de presse, asseyez-vous simplement et écrivez un autre scénario. Et si la même mésaventure vous arrive avec celui-là, écrivez-en un autre, et un autre et encore un autre, jusqu’à ce que vous en ayez un qui soit porté sur grand écran par un réalisateur, mais avec votre propre vision. »
REDÉCOUVERTES
LES GRANDES MANŒUVRES (TF1)
 Je revois LES GRANDES MANŒUVRES dans une copie enfin regardable et suis tombé sous le charme : scénario inventif et intelligent avec tout à coup des trouvailles drolatiques étonnantes (les chapeaux qui se mettent à parler). On peut y admirer toute une flopée de seconds rôles ou de vedettes débutantes (Claude Rich, Piccoli), tous bien distribués, dans des rôles qui ne sont pas simplement des faire-valoir : de Yves Robert à Pierre Dux, de Dany Carrel, délicieuse, à une Brigitte Bardot excellente et à croquer, sans oublier Jacqueline Maillan et Madeleine Barbulée, Jacques Fabbri. Clair croque aussi bien le coté rance, aigri de la province, que la délicatesse de certains sentiments, la frustration, la solitude chez Michèle Morgan, la vanité blessée qui se transforme en amour chez Gérard Philippe qui est magnifique d’élégance et de subtilité. Osons un sacrilège et citons Lucien Logette dans Jeune Cinéma, excellente revue : « C’est un film qui tient nettement mieux le coup et qui est beaucoup plus réussi qu’ELENA ET LES HOMMES. » Et je ne parle pas du DÉJEUNER SUR L’HERBE. Ce, malgré un côté un peu ripoliné dans les décors qu’on peut défendre car il fait ressortir la cruauté discrète de certaines péripéties. Qualité Française ? Si cette expression qui désigne un savoir-faire réel mais anonyme convient parfaitement à certains Delannoy ou Carné des années 50, à des réalisations de Lampin, Dréville, elle ne s’applique pas aux GRANDES MANŒUVRES où Clair est présent dans chaque plan, chaque réplique. Idem pour Claude Autant-Lara (sauf LE COMTE DE MONTE CRISTO) et Duvivier même dans ses échecs (sauf LA FEMME ET LE PANTIN). Cette expression servait à défendre coûte que coûte les erreurs manifestes, les plantages, les fautes de goût des cinéastes qu’il fallait vénérer pour de justes raisons : la distribution d’ELENA est une suite d’erreurs. Personne ne joue avec personne. Il n’y a aucune entente entre les comédiens et le scénario est écrit à la va vite. Et Renoir semble totalement coupé de la France. Il a le regard d’un cinéaste américain et recycle des recettes, des souvenirs. LE CAPORAL ÉPINGLÉ est meilleur (même si l’on voit que la guerre de 40 reste pour lui la guerre de 14). Il faut faire comme si ces dérapages étaient des innovations, ce qui arrive dix fois sur cent. Le mépris justifié de Renoir pour la technique (qui entraîne des jugements imbéciles, mesquins des adorateurs de la technique style Le Chanois) lui faisait braver les règles dans les années 30 et était porté par une extraordinaire énergie créatrice en symbiose avec le pays. Après la réussite de FRENCH CANCAN, elle est en veilleuse et ses zélateurs l’ont conforté dans ses fourvoiements.
Je revois LES GRANDES MANŒUVRES dans une copie enfin regardable et suis tombé sous le charme : scénario inventif et intelligent avec tout à coup des trouvailles drolatiques étonnantes (les chapeaux qui se mettent à parler). On peut y admirer toute une flopée de seconds rôles ou de vedettes débutantes (Claude Rich, Piccoli), tous bien distribués, dans des rôles qui ne sont pas simplement des faire-valoir : de Yves Robert à Pierre Dux, de Dany Carrel, délicieuse, à une Brigitte Bardot excellente et à croquer, sans oublier Jacqueline Maillan et Madeleine Barbulée, Jacques Fabbri. Clair croque aussi bien le coté rance, aigri de la province, que la délicatesse de certains sentiments, la frustration, la solitude chez Michèle Morgan, la vanité blessée qui se transforme en amour chez Gérard Philippe qui est magnifique d’élégance et de subtilité. Osons un sacrilège et citons Lucien Logette dans Jeune Cinéma, excellente revue : « C’est un film qui tient nettement mieux le coup et qui est beaucoup plus réussi qu’ELENA ET LES HOMMES. » Et je ne parle pas du DÉJEUNER SUR L’HERBE. Ce, malgré un côté un peu ripoliné dans les décors qu’on peut défendre car il fait ressortir la cruauté discrète de certaines péripéties. Qualité Française ? Si cette expression qui désigne un savoir-faire réel mais anonyme convient parfaitement à certains Delannoy ou Carné des années 50, à des réalisations de Lampin, Dréville, elle ne s’applique pas aux GRANDES MANŒUVRES où Clair est présent dans chaque plan, chaque réplique. Idem pour Claude Autant-Lara (sauf LE COMTE DE MONTE CRISTO) et Duvivier même dans ses échecs (sauf LA FEMME ET LE PANTIN). Cette expression servait à défendre coûte que coûte les erreurs manifestes, les plantages, les fautes de goût des cinéastes qu’il fallait vénérer pour de justes raisons : la distribution d’ELENA est une suite d’erreurs. Personne ne joue avec personne. Il n’y a aucune entente entre les comédiens et le scénario est écrit à la va vite. Et Renoir semble totalement coupé de la France. Il a le regard d’un cinéaste américain et recycle des recettes, des souvenirs. LE CAPORAL ÉPINGLÉ est meilleur (même si l’on voit que la guerre de 40 reste pour lui la guerre de 14). Il faut faire comme si ces dérapages étaient des innovations, ce qui arrive dix fois sur cent. Le mépris justifié de Renoir pour la technique (qui entraîne des jugements imbéciles, mesquins des adorateurs de la technique style Le Chanois) lui faisait braver les règles dans les années 30 et était porté par une extraordinaire énergie créatrice en symbiose avec le pays. Après la réussite de FRENCH CANCAN, elle est en veilleuse et ses zélateurs l’ont conforté dans ses fourvoiements.
 Autre redécouverte fastueuse, LA FÊTE A HENRIETTE (Pathé) qui est souvent sous-estimée, procure une jubilation de tous les instants. On a beaucoup glosé sur les affrontements entre les deux scénaristes que l’on réduit de manière simplificatrice à des autoportraits déguisés de Jeanson et Duvivier. Il y a beaucoup d’autres modèles. On peut juste constater que Duvivier se sert du personnage de Crémieux pour se moquer de lui-même, de ces plans de traviole qu’il glissait dans certains films notamment dans le très bon sketch avec Pierre Blanchard de CARNET DE BAL. Cette référence ironique fut décrite dans les Cahiers du Cinéma comme une volonté de plagier Welles, alors que ce genre de plan Duvivier les avait tournés des années avant CITIZEN KANE. Mais ce qui m’a aussi touché dans le film et qu’on mentionne rarement, ce sont toutes ces scènes de bal dans les rues, ces orchestres, ces foules de danseurs. Certains plans incroyablement spectaculaires sont visiblement volés (le bal près de la Madeleine) et le montage qui les unit à partir de la valse d’Auric est un grand moment de cinéma et un hymne au Paris populaire.
Autre redécouverte fastueuse, LA FÊTE A HENRIETTE (Pathé) qui est souvent sous-estimée, procure une jubilation de tous les instants. On a beaucoup glosé sur les affrontements entre les deux scénaristes que l’on réduit de manière simplificatrice à des autoportraits déguisés de Jeanson et Duvivier. Il y a beaucoup d’autres modèles. On peut juste constater que Duvivier se sert du personnage de Crémieux pour se moquer de lui-même, de ces plans de traviole qu’il glissait dans certains films notamment dans le très bon sketch avec Pierre Blanchard de CARNET DE BAL. Cette référence ironique fut décrite dans les Cahiers du Cinéma comme une volonté de plagier Welles, alors que ce genre de plan Duvivier les avait tournés des années avant CITIZEN KANE. Mais ce qui m’a aussi touché dans le film et qu’on mentionne rarement, ce sont toutes ces scènes de bal dans les rues, ces orchestres, ces foules de danseurs. Certains plans incroyablement spectaculaires sont visiblement volés (le bal près de la Madeleine) et le montage qui les unit à partir de la valse d’Auric est un grand moment de cinéma et un hymne au Paris populaire.
Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Lectures : Jean Rollin, Michael Curtiz et William Wyler
- Article précédent : Lectures : stars de la folk, mythe western et mémoires de cinéaste et de cinéphile
Articles similaires
Commentaires (423)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)

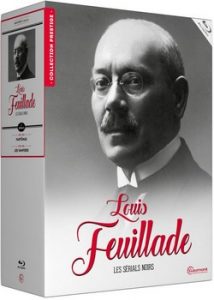

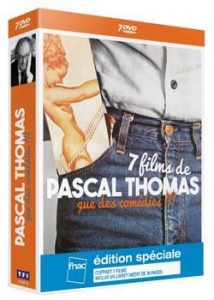
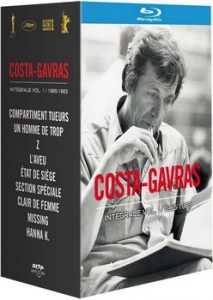
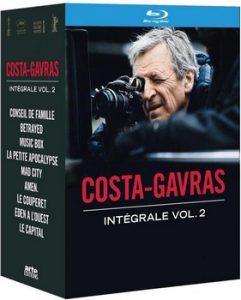
Cher Bertrand Tavernier,
pardon de revenir sur un détail qui me tourmente ( un peu). Un détail donc ; vous dites dans votre série que la musique de Grunenwald pour BEBE DONGE anticipe sur ce que composeront des minimalistes tels que Philip Glass. ( Avec votre honnêteté coutumière, vous avez dit récemment que Louis Dunoyer a précisé : avec des harmonies moins basiques.) Ce point me touche ; je n’ai rien contre Philip Glass, qui est un musicien tout à fait défendable , et assez pertinent dans sa façon d’utiliser l’orchestre – je dis ça parce qu’au piano seul , l’intérêt dégringole sérieusement à mon goût. Ce qui pose problème est la généralisation de cette esthétique minimale ; on a le sentiment que certains cinéastes adorent ce type de musique parce qu’elle ne dérange rien. Comme le visage de Mosjoukine dans la célèbre expérience de Koulechov, elle peut tout exprimer ; et ne vient pas empiêter sur le pouvoir de l’image. Il y a des gens comme Desplat qui savent en tirer parti et servir le film, mais souvent on ne fait qu’installer une grisaille passe-partout ; Glass is the new black.
Ce qui suscite ce message est la découverte d’une pièce de Liszt, dans sa période mystique : un motet à Ste Cécile , dont le début est plus Glassien que Glass. Evidemment avec des finalités , une esthétique , une généalogie bien différentes. Il y a je crois des travaux sur ce fil minimaliste au cours de l’histoire, peut être moins sur l’usage qui en a été fait au cinéma. Bien sûr le merveilleux moment des « Enfants terribles » , une déambulation au son du concerto pour 4 claviers de Vivaldi-Bach ; Cocteau se targuait d’ailleurs d’avoir contribué à faire aimer Vivaldi par ce film. Bien sûr BEBE DONGE . Bien sûr Herrmann, pour des raisons différentes. Et , hors cinéma , un moment nocturne et magique du concerto pour 2 pianos de Poulenc, fin du 1er mouvement , qui ne doit rien à Glass, et beaucoup au gamelan Balinais – via Debussy peut-ëtre… Pardon d’être un peu long sur ce détail qui m’importe.
A Denis Fargeat
Je ne donnais aucun avis artistique sur la musique de Glass. J’aime certaines de ses compositions mais comme vous le dites le minimalisme érigé en théorie m’exaspère. Je voulais juste signaler que parmi les rares musiques de films récents à être défendues figurent celles composées par Glass et je demandais à leurs admirateurs d’aller écouter Grunenwald compositeur qu’ils devaient totalement ignorer
A Bertrand Tavernier
Merci pour votre réponse et votre éclairage, je n’avais pas compris vos propos sous cet angle. De mon côté je suis un peu épidermique sur la pauvreté harmonique des imitateurs de Glass, désolé. On a l’impression que l’oreille du spectateur n’admet plus que des accords simplets ; Carter Burwell racontait avoir dû lutter longtemps pour défendre UNE dissonance dans sa musique pour TWILIGHT, ça rappelle les discussions Prokofiev-Staline sur les accords « bourgeois »…
En tous cas souhaitons que le concert que vous préparez ( si j’ai bien compris , « Bébé Donge », « Rafles sur la ville » de Legrand ….) amène un large public à découvrir l’apport de Grunenwald au cinéma. Grand merci en tous cas.
A Denis Fargeat
Pour le moment l’éditeur de Bébé Donne, Warner Chappel ne veut pas reconnaitre à Louis Dunoyer le statut d’arrangeur alors qu’il a du entièrement reconstituer une partition à l’oreille, en visionnant le film et qu’ils n’ont rien gardé de cette même partition même pas le conducteur. Ils ont peur de perdre 1/12ème. OPn continue à se battre
… je me trouve un peu bête , peu après le dernier post j’entends l’annonce du concert à la radio. Et c’est conséquent! https://www.maisondelaradio.fr/musique-de-film-bertrand-tavernier
A Bertrand
L’attitude de Warner Chapell est révoltante, hélas pas étonnante ; j’imagine que la musique de Grunenwald est arrivée dans leur catalogue au fil des achats, faillites, fusions de divers éditeurs , eux ne se comportent pas en éditeurs mais en gestionnaires de fond de pension. Avec une arrogance de hobereau. Tout mon soutien à vous et Louis Dunoyer dont je ne connais que « Les empires de la lune » – une merveille d’intelligence et de poésie, en même temps que la preuve qu’on peut faire une oeuvre musicale accessible, populaire sans rien céder à la qualité et l’exigence.
A Denis.Je vais voir cet après midi »Au poste » le 6ème long métrage de Dupieux qui est un cinésate inclassable et surtout indépendant.Pas d’accord avec vous sur « Réalité »qui n’est pas long dans la narration iconoclaste et absurde du réalisateur.Fils spirituel des Marx brothers,des Monthy Python,de Tati et Buster Keaton,Dupieux à un sens inné de la derision intelligente mais aussi une imagination débordante(voir « Rubber »ou son premier film »Steack »avec déjà Jonathan Lambert qui est devenu son acteur de chevet).Enfin ne dédaignez pas d’écouter les morceaux de Mr Oizeau qui sont là aussi des musiques de notre époque glacante et pessimiste.
A Yves
Je vais essayer de le voir aussi.Pour « Réalité » , ça doit venir de moi, pas en forme quand je l’ai vu… Dupieux est, certes, une sorte d’héritier des burlesques que vous citez, entre surréalisme et géométrie du gag, mais aussi un musicien electro qui déclare « articuler ses créations autour du « grand n’importe quoi », et utiliser ses machines « totalement au hasard » ». Pour autant il semble être très exigeant sur l’agencement des séquences, et cette tension entre hasard et contrôle profite à son cinéma. Je vois qu’il a débuté dans le monde de l’image en travaillant sur les clips de Michel Gondry, qui sont autant de petits chef d’oeuvres. On voit ce qui les rapproche, un goût de la géomètrie, un sérieux sens du jeu, et ce qui les sépare : Dupieux à mon sens tient mieux la distance du long métrage que Gondry.
A Yves
Vu !
Bien aimé , un peu long peut-être (1h13 quand même , le Dupieux compte double, ce n’est pas forcément un défaut, ni une qualité d’ailleurs. A 4 euros la séance hier, c’était avantageux). Très bien joué, surtout Grégoire Ludig et Marc Fraize que je découvre. On dirait « Garde à vue » de Miller, sur un scénario de Bunuel et Carrière, filmé par … Quentin Dupieux. Et c’est – presque- un film familial, à part 2 3 notations gore.
À Bertrand : il faut vraiment que les techniciens qui s’occupent de votre blog règlent le problème. Tout ou presque est rayé, et c’est illisible !! Il leur faut juste trouver la balise fautive en admin (en coulisses pour vulgariser) et la retirer.
La principale vertu du cinéma à contenu social, est qu’il provoque plus de réactions que les productions europacorp. Puisqu’on évoque 68 sur cette même page, le hasard a voulu que je revoie les films de Claude Faraldo : THEMROC et BOF, ANATOMIE D’UN LIVREUR. Deux comédies sociales hilarantes et profondément anarchistes. Des films qui plaident pour l’abolition pure et simple du travail, à une époque où on pouvait démissionner le lundi et être embauché ailleurs le vendredi. Dans Bof c’est même le père qui encourage son fils à arrêter de bosser. Ces films étaient-ils subversifs en leur temps ? Moins sans doute qu’ils ne le seraient aujourd’hui, et on ne pensait sûrement pas qu’un jour on ferait des films sur des gens qui manifestent pour conserver leur état de servitude. Quelqu’un a-t’il vu le film de Gaël Morel (passé en vitesse) où Sandrine Bonnaire suit la délocalisation de son usine au Maroc pour garder son emploi ?
A Bertrand,
je ne sais si vous avez remarqué mais une grande partie du forum de cette page est striée.
Est-ce du à la vindicte d’un hacker sauvage ou le blog a-t-il traversé la 4ème dimension…..ou la Black Lodge de Twin Peaks?
à Bertrand: vous avez remarqué qu’une grande partie des commentaires plus anciens sont rayés? Y compris quand on en dépose un nouveau? Ceci dit ça reste lisible!
enfin, quand on répond à un ancien message je veux dire… bon, une aspirine vite!
a MB
du modérateur
Problème corrigé : une faute de frappe a ouvert une balise HTML sans la fermer ce qui a impacté toute la suite du fil…
J’ai modifié le commentaire en question et tout est en ordre : pas de hacker sauvage en vue donc..
Euh de mon côté, pas vraiment lisible, il en résulte une étrange impression , plus hurlante que subliminale : tout ce que vous lisez est faux ( ou: lisez, mais n’en tenez pas compte.). Une expérience à tenter, mais pas longtemps.
Ah , et je m’aperçois que mes cachets d’aspirine sont également barrés d’un trait! Je me barre. Courage à tous !
Bonjour à tous,
Juste pour reparler un instant d’EN GUERRE… je trouve le film indiscutablement généreux mais contradictoire et raté. Plusieurs ne seront pas d’accord, désolé… Une grave question à la fin…
Le plus intéressant du film consiste en l’exposé d’une situation qui en rappelle malheureusement bien d’autres : il y a deux ans, une usine possédée par un grand groupe aurait dû fermer mais les salariés ont accepté une réduction de leur salaire contre une promesse de maintien des emplois. L’usine fait des bénéfices, cependant, le groupe allemand propriétaire de l’usine veut la fermer car le taux de profit n’est pas assez élevé. Les salariés se battent de toutes leurs forces…
On ne voit pas souvent au cinéma un repreneur refuser l’offre d’un acheteur et on apprend (moi, en tout cas) que la loi française n’oblige un groupe qu’à chercher un repreneur et pas du tout à accepter la meilleure offre… Tout le reste du film semble être un schéma abstrait de ce qu’est une lutte pour l’emploi dans le capitalisme financier mondialisé, commun à plusieurs luttes (selon le metteur en scène, « le cas de Perrin Industrie décrit dans le film, c’est Goodyear, Continental, Allia, Ecopla, Whirlpool, Seb, Seita, etc. »). C’est donc un projet général très louable de décrire toutes ces situations en une seule, avec une grande netteté dans les enjeux sociaux et économiques.
Mais à force d’abstractions, le film ne montre pas d’êtres humains, seulement des méthodes capitalistes qui sont très connues du spectateur qui a lu Jacques Généreux, Frédéric Lordon ou Serge Halimi, vu La Mise à mort du travail ou Les Vivants et les Morts (avec lequel il partage beaucoup de choses, sauf la durée qui permettait un approfondissement magnifique et j’ai envie de comparer les deux). Bref, on peut très bien n’avoir aucune surprise devant ce film. Il reste assez intéressant pour un adolescent ou un jeune adulte qui veut en savoir plus sur le capitalisme du XXIe siècle.
Il y a plus problématique et, bien que les idées au centre du film sont les plus généreuses et justes socialement, économiquement, humainement, de graves défauts viennent irrémédiablement entacher leur exposition.
Dans La Loi du marché, avant que le personnage de Lindon ne trouve un emploi, chaque scène constituait une humiliation, une violence symbolique. On le voyait rapidement et, quand une scène commençait, on était sûr qu’elle allait mal se terminer quoi qu’il arrive : cette programmation du déroulement du film le rendait très lourd et démonstratif. Dans En guerre, on en est presque là : d’abord 95% du film est consacré aux actions syndicales et pendant 1h15, toutes les scènes de lutte se terminent au désavantage des salariés. Il y a bien une scène d’entente des syndicats mais cette entente se fissurera vite et ne se reformera pas. Au bout d’1h15, une scène se termine plutôt bien (quand on apprend que le patron allemand a accepté de rencontrer les salariés et que les syndicats ont trouvé un repreneur dont le projet est viable) mais comme c’est seulement pour rencontrer les salariés, on voit bien que le patron ne se sent obligé à rien du tout (il ne fait pas de nouvelles propositions avant la rencontre) et que comme précédemment, cette rencontre pourrait bien être tout aussi décevante pour les salariés, ce qui ne manque pas d’arriver. Le film est donc très monotone sous cet aspect, ce qui contribue à lui enlever tout caractère surprenant.
Chez Mordillat, il n’y a pas du tout cette linéarité, des évènements viennent encourager et rassurer les salariés avant que d’autres ne les désolent. Il y a surtout un grand nombre de scènes chaleureuses, vivantes, drôles, intimistes montrant la vie privée des ouvriers en lutte, qui équilibrent la violence sociale subie par ailleurs.
Le plus grave est la contradiction fondamentale entre les idées qui parcourent le film et la manière dont elles sont mises en œuvre.
Le film fait manifestement l’éloge des luttes syndicales (il est dit plusieurs fois que Laurent est à la CGT ; ses opposants appartiennent à un syndicat d’entreprise imaginé pour le film, alors que les noms des syndicats serviles sont bien connus…). Mais en réalité il y a vraiment un seul personnage principal et, miracle, c’est un super-héros : il est d’une ténacité et d’un courage à toute épreuve, toutes ses décisions, tous ses choix sont les bons, jamais il ne semble hésiter, c’est toujours lui qui semble tout faire et qui est en première ligne dans les négociations (personne ne le relaie) ; c’est d’ailleurs pour lui l’occasion de tirades développées et assez bien senties ; c’est le seul personnage dont on voit un peu la vie privée (sa femme, sa fille enceinte pour qui il est un « héros », en toutes lettres, si jamais le spectateur ne s’en était par rendu compte). Même quand il est bourré, c’est lui qui dirige la conversation (la phrase à répéter sans se tromper), c’est lui le centre de la scène. Même quand il traite quelqu’un de pauvre con, il retire tout de suite gentiment. Et bien sûr la fin du film surenchérit encore dans le caractère héroïque et tragique de Laurent. On se croirait dans Moi, Daniel Blake.
Laurent a bien une collègue syndicaliste, Mélanie, une femme, mais elle est nettement moins parfaite : elle fait les mêmes choix que lui mais elle n’a pas vraiment droit à la parole : dans les actions et les réunions de négociation, elle a au mieux une phrase de temps en temps, attention, une seule à la fois. Elle fait preuve de courage puisqu’elle a deux enfants à charge et en train de se séparer ; on l’apprend quand elle parle à Laurent qui lui demande à propos de son ami : « Il ne comprend pas, il n’est pas admiratif ? ». Le dialogue montre au passage que Laurent lui, comprend, et ne dit que des banalités sur Mélanie (sa situation douloureuse sonne tout à fait juste mais n’est pas explorée davantage). Et le moment où elle prend le plus longtemps la parole, elle fait surtout l’éloge de Laurent qui lui a toujours redonné courage.
Il y a un personnage d’avocate dont la connaissance du droit aurait pu permettre de répartir plus équitablement les qualités humaines et l’efficacité dans la lutte, mais on la voit trop peu et ce n’est jamais elle qui a le dernier mot. (Et pourquoi la CGT ne fait pas appel de la décision de justice ?)
Au lieu d’un groupe d’activistes, on voit donc surtout un super-héros et son comparse sans grand intérêt. Un peu individualiste, tout ça… Brizé fait reposer tout le film sur Lindon et pas sur ses acteurs non professionnels dont il ne tire pas grand-chose et auxquels il ne semble pas faire confiance. Pourquoi devait-il y avoir un acteur professionnel de toute façon ? Pourquoi n’avoir pas choisi que acteurs non professionnels (sinon pour parvenir à faire le film) ? On dirait un peu un de ses biopics américains récents édifiants où le héros est seul contre la société toute entière et en perd la vie…
Chez Mordillat, c’est exactement le contraire : il y a un personnage principal (Robinson Stévenin) mais il n’a rien d’un super-héros et dès le début une scène choquante de violence conjugale nous en prévient, et d’autres mensonges suivront… Autour de lui gravitent de nombreux autres personnages qui ont une grande importance, il n’est pas le centre, le moteur unique de toutes les scènes. On y voit d’autres ouvriers, plus anciens et plus respectés que lui, un ouvrier d’origine arabe, etc. et surtout les femmes ont une très grande place, les ouvrières et une journaliste de Libération. On y verra même les dissentions entre les hommes et les femmes… et puis finalement ces deux manifestations qui se rassemblent, dans une lutte commune.
Les capitalistes (direction de l’usine, du groupe français, du groupe allemand), eux, et leur soutien (le conseiller de l’Elysée) ne sont montrés que dans les réunions avec les syndicalistes, donc c’est le festival habituel de novlangue libérale hypocrite : si on en n’a peu entendu, c’est choquant ; si on connaît, c’est fort prévisible. Leurs interventions, aussi vraies et justes soient-elles, n’ont là non plus rien de surprenant, tellement le discours capitaliste s’est bien rôdé en France depuis 1983…
Chez Mordillat, c’est encore très différent : on y voit l’hypocrisie et la langue de bois mais c’est beaucoup plus riche : on y voit des ouvriers passer contremaîtres (François Morel et l’ami de Robinson Stévenin) donc changer d’avis, et certains hésiter à céder au chantage. On y voit surtout la direction, à la fois entre eux (avec des scènes très fortes où celui qui met en œuvre le plan de licenciement se rend compte qu’il s’est fait manipuler par son chef et lâcher par ses collègues) et dans leur vie privée (le même cadre qui a des valeurs catholiques conservatrices, donc des principes, qui sont en accord avec ses actions). Mordillat développe en fait très peu les scènes de négociation.
Enfin, il y a cette mise en scène toujours si personnelle de Stéphane Brizé qui à mon avis est très domma-geable au sens et à la force du film.
D’abord, pourquoi ce tremblement perpétuel de l’image, sinon pour donner une impression documentaire, mais qui commence à être usée jusqu’à la corde (parce que de nombreux documentaires criants de vérité s’en passent fort bien), au point que même certains plans des journaux télévisés du film sont tremblés, ce qui me paraît assez faux.
Ensuite, dans presque tous les plans du film, il y a (au moins pendant une partie du plan) un objet ou une personne flou(e) en amorce et une partie du fond de l’image qui est flou, ce qui n’a que pour effet de séparer nettement le personnage filmé de son environnement, en particulier des autres. On filme une action collective et on sépare tout le monde, est-ce bien raisonnable ? Car en outre une très grande partie du temps, il n’y a qu’un seul personnage parlant à l’écran, en assez gros plan, l’autre éventuel écoutant ou ne prenant pas part à la discussion, ce qui contribue à cet isolement assez radical des personnages les uns des autres. Il n’y a donc pas de composition visuelle qui donnerait de la force aux affrontements, comme dans le grand cinéma classique, ou même, avec un seul personnage présent, dans les recherches visuelles sophistiquées des films de Kijû Yoshida). Cette utilisation du flou enlève aussi de la force aux scènes, parfois : quand un personnage s’énerve contre un autre et le prend par le col, on ne voit plus celui qui est agressé car il est caché par un personnage flou en amorce… comment s’intéresser ?
Parfois c’est le montage et la musique qui sont incompréhensibles. Il y a des scènes un peu violentes (par exemple, où les salariés se font dégager par des CRS, dans les locaux du Medef ou devant l’usine) avec une musique électronique angoissante. Mais pourquoi y a-t-il exactement le même genre de musique sur la manifestation, tout au début du film, où rien ne se produit ? Et la même scène est montée de manière extrêmement rapide, les angles se tordent, la caméra devient épileptique, ça devient cauchemardesque… Sans doute Brizé veut-il montrer que les actions vont dégénérer et avoir des conséquences violentes, mais c’est surprenant qu’il ne filme pas l’unité, la force commune de ceux qui manifestent ensemble…
Le film de Brizé est parfaitement déprimant par son absence complète d’espoir, qui est aveugle, vu la richesse des idées anticapitalistes qui existent (certes difficiles à mettre en œuvre). S’il fait croire qu’il n’y a pas d’alternative, il fait le jeu des capitalistes. Les Vivants et les Morts, La Grève, Viva Zapata !, Le Sel de la terre, Les Camarades (Mario Monicelli), Comrades, L’Homme de fer, Classe de lutte, The Navigators, Tous au Larzac, Merci patron ! donnent une image autrement plus positive et parfois enthousiasmante des luttes collectives, bien plus mobilisatrice.
QUESTION : j’aimerais avoir vos lumières sur un sujet grave. Selon vous, quels sont les films, ayant eu un écho ou du succès, qui ont lancé la mode toujours actuelle de filmer les personnages de dos, de trois quarts, du siège arrière de la bagnole ? Leurs auteurs nous doivent d’énormes dommages et intérêts (je me constitue partie civile demain).
A Cecil faux
Je ne peux répondre qu’à la dernière question, n’ayant pas vu le film de brisé. Quand on a supprimé les transparences et voulu filmer dans une vraie voiture, si on refuse les voitures travellings qui parfois ont une plateforme trop haute et tanguent légèrement) et si on n’a pas le temps d’installer un système qui permette de filmer à travers les fenêtres ou le pare brise (cela demande du temps et du materiel), le meilleur endroit pour filmer est sur la banquette arrière ou l’on a du recul et on peut obtenir un trois quart sur le conducteur. Souvent question de temps et de pognon. Filmer le conducteur est un peu plus facile. On peut se mettre sur le siège passager en déport. Et les voitures françaises sont beaucoup moins larges que les américaines
A Cecil Faux
Je vous recommande de voir ou revoir JUSQU’AU BOUT, un téléfilm de Maurice Failevic inspiré par la lutte que menèrent les salariés d’une usine Seveso, menaçant de la faire sauter suite à la fuite de la direction. Failevic avait mêlé de vrais salariés à la distribution, menée par un Bernard Pierre Donnadieu implacable en négociateur de la CGT. Je partage avec vous ce regret que En guerre soit trop complaisant avec ses personnages, observés sous un seul angle. On a le sentiment que Brizé n’a pas voulu prendre de risque à ce niveau-là, par crainte de ne pas être complètement de leur côté. Failevic avait embrassé plus complètement ses protagonistes, et plusieurs fois en regardant le film, je me suis fait piéger à dire « non là ils vont trop loin » trouvant même qu’ils étaient mal élevés à l’égard du négociateur du gouvernement plein de bonne volonté et d’égard pour eux, à l’encontre duquel ils manifestaient, contre leur propre intérêt, un certain ressentiment de classe. Failevic regardait ses ouvriers d’homme à homme, alors que Brizé a un regard qu’on pourrait qualifier de religieux.
Au sujet des travellings voiture, il y a la scène mémorable du Hold-Up dans GUN CRAZY, filmée de l’arrière d’un véhicule, anticipant d’une dizaine d’années tout ce qu’a fait la nouvelle vague de ce point de vue.
Merci pour le conseil, très intéressant, je ne connaissais même pas le réalisateur. S’il y a pas mal de personnages, s’il mélange acteurs et non-professionnels, ça semble être une bonne option qui ne hiérarchise pas, ne sanctifie pas certains au détriment des autres, d’autant que Donnadieu n’est pas une star comme Lindon (mais super et comme il faisait peur dans La Passion Béatrice !).
A Cecil Faux
Donnadieu était devenu une star à la télé et Faillevic est un des grands et des plus célèbres réalisateur de TV. Il a aussi fait une sorte de série sur la guerre d’Algérie co réalisée par un Algérien
Ce (télé) film est il aisément accessible? Son sujet, son projet m’intriguent or je n’en avais pas entendu parler.
A l’évidence, bien des voies sont possibles pour parler social en France mais je préfère celle de l’action, de l’énergie type Ken Loach à celle du constat type Dardenne mais cela est affaire de goûts et de choix idéologiques.
Vous avez Bertrand plutôt l’habitude de montrer des personnages qui, malgré l’adversité, prennent les difficultés à bras le corps comme dans L 627, ça commence aujourd’hui ou Holy Lola et j’avoue que cela me fait plus de bien que l’accompagnement de la déréliction de Rosetta ( d’eux je préfère de très loin La promesse ou Le fils).Et cela est important dans ce monde désenchanté de 2018.
A Ballantrae
J’aime les personnages qui ne veulent pas laisser les autres sur le bord de la route
à Ballantrae: je suis d’accord sur ROSETTA que je trouve un peu complaisant et défaitiste, comme celui avec Cotillard, pourtant ce dernier est très attachant.
A Ballantrae
Vous trouvez le DVD de JUSQU’AU BOUT sur sur Priceminister. Mots clés : Jusqu’au bout. Failevic.
A MB
ROSETTA n’est pas plus un film sur le défaitisme que sur l’optimisme, c’est un film sur la régression d’un individu vers un état quasi animal : celui qu’on atteint lorsqu’on n’est plus occupé qu’à la satisfaction de ses besoins primaires. Les films des Dardenne que je connais, ont pour sujet un personnage qui s’emploie à accomplir une tâche une seule. DEUX JOURS, UNE NUIT que Frémaux compare très justement à High Noon, avait la même fin que La loi du marché, une fin qui concluait cependant un film répétitif et parfois moyennement bien joué, pas par Cottilard qui, quoi qu’on dise d’elle, est une grande actrice. Le cinéma des Dardenne a davantage à voir avec l’anthropologie qu’avec le cinéma de Brizé, ou jadis de Marin Karmitz, animé de convictions militantes.
à Stéphane/DARDENNE: un film défaitiste et un film sur le défaitisme ce ne serait pas la même chose, de toute façon. Car là, le spectateur se sent concerné à juste baisser les bras devant l’ordre social tout puissant et injuste. Je suis d’acord sur le reste de ce que vous dites. J’ai juste trouvé que l’inénarrable séquence du type qui dans son réduit minable, fait jouer ses solos de batterie enregistrés pour appréciation à Rosetta est allongée en durée au point qu’on y retrouve la même complaisance que s’il les lui faisait écouter au bord d’une piscine de luxe en sirotant des cocktails multicolores.
a Cécil Faux.
Françoise Giroud disait: le plus dur est de faire court.
Désolé mais je me suis arrété en cours de route , j ‘ai trouvé cela répétitif et plutot indigeste.
A Henri Patta
Oui mais il y a des arguments qu’on peut contester mais qui méritent d’être entendus même si j’y vois une influence très forte de Lordon et de la France Insoumise
A Cecil.Votre argumentaire est assez bien développé sur le personnage de Laurent qui est mis ouvertement par Brizé par contre il n’a pas assez mis l’accent sur la cgc et la cfdt qui sont des syndicats réformistes proches du medef et qui ont signés et qui continuent aujourd’hui de signer des conventions collectives ou des départs à la retraite avec des chèques de 30.000 euro puis comme il est indiquez justement dans le film c’est deux ans d’indemnisations de chomage puis les ASS et enfin on se retrouve à 58 piges au RSA.Concernant l’aspect purement technique du film;on doit souligner qu »En guerre »à été tourner en 6 semaines dans l’urgence totale car certains producteurs en France surtout les chaines de tv privées sont frileuses pour des œuvres à caractère social.On ne peut pas comparer non plus ce film avec »Moi Daniel Black »mais plutôt avec »La loi du marché ».Je suis triste de voir que le jury de Cannes n’ait pas attribuer de prix à ce film.Enfin je terminerais en écrivant que dans tous les drames humains il y à des morts souvent injuste mais ici Brizé ne fait pas de Laurent Amadéo un martyr mais un porte parole qui se mouille face à la direction de l’usine,face aux autres syndicats qui ont peur et préfèrent partir avec un petit chèque dans la poche la queue entre les jambes sans rien dire et à tous les opportunistes qui ne sont pas grévistes mais profitent souvent des améliorations des conditions de travail au sein des entreprises et arrivent même à se mettre en maladie lors de grèves perlées comme actuellement à la sncf!!!!
A Yves Rouxel
Mais cannes avait récompensé le précédent. D’autre part les syndicats que vous qualifiez de réformistes ont obtenu des résultats dans les pays de l’Europe du Nord et en Allemagne et dans certains domaines proposent des avancées, des protections faisables alors que le maximalisme de la CGT a parfois stoppé toute avancée. Ce fut le cas à la télévision, à la SFP, à Radio France. Le syndicalisme en France est amoindri par la guerre des égos, la rivalité entre des chefs de clan qui retournent leur veste (Mailly et FO), un refus de s’associer. Ce chacun pour soi est du pain bénie pour la Macronie technocratique. Le mépris du monde populaire, ouvrier, de la ruralité et maintenant de la banlieue éclate chaque jour davantage
A Bertrand.Mme Nicole Notat ancienne représente de la CFDT n’a pas fini sa carrière syndicale à Pole emploi.Concernant le SNJ CGT je reconnais qu’il ne represente pas l’ensemble des journalistes,techniciens,pigistes de France tv ou de Radio France mais c’est le seul syndicat qui à annoncer le retour de l’ORTF d’ici trois an en France avec 4000 à 6000 emplois suppressions de postes.
a Yves Rouxel
Ni Krasucki. Mais là n’est pas la question. Mais aussi une raideur dogmatique, un refus de prendre au corps le statut des intermittents (et de de rayer les chauffeurs, standardistes et autres employés qui auraient du être des salariés) de peur de perdre des voix. Et de très nombreuses personnalités artistiques ont dénoncé cette évolution vers l’ORTF et quand on supprimait leur émission, il n’y avait aucun soutien. La conduite du syndicat CGT des techniciens dans le cinema et leurs affirmations comme quoi mieux valait travailler sur un James Bond que sur LA QUESTION ou L’AFFICHE ROUGE (films issus du PC ou la participation jouait un grand rôle et on demandait qu’on régule cette participation pour protéger les salariés, demande jugée réformiste qui a été repoussée. A cette époque, il y avait 25 films tournés avec ce système, d’Allio, Bernard Paul, JD Simon) qu’ils « auraient interdits s’ils avaient le pouvoir » (déclaration de Guy Lecouvette dans un CA)
Disons qu’à titre personnel les avancées de syndicats type CFDT ressemblent à s’y méprendre à des reculades et leur rôle à une gentille cogestion.Pas trop ma tasse de thé à vrai dire.
Peut-être que cela fonctionne dans les pays du Nord qui ont une propension certaine pour le lissage syndical mais les histoires de la France et de l’Allemagne n’ont pas été exactement les mêmes.
Là c’est sûr le roi Macron est nu et ne cherche pas à masquer son mépris pour bien des pans de la société.
Tout ce qui divise le sert…mais revenons au cinéma car j’ai pu aussi revoir La faute de Zviagintsev sur grand écran et estime qu’il s’agit d’un film immense et terrible.Le craquellement d’une certaine idée de réussite sociale est partout à l’oeuvre et les enfants trinquent dans ce monde bien avare en amour envers l’avenir qu’ils incarnent.
J’ai aussi découvert Tesnota, premier film plutôt réussi mais peut-être moins génial qu’on l’a dit notamment sur le plan esthétique ( je trouve le travail sur la couleur un peu forcé) mais très juste pour la direction d’acteurs et le choix des situations.
L’Est réserve encore fort heureusement de belles surprises!
Je voulais dire Faute d’amour bien sûr, pardonnez moi.
Argumentation très structurée et fouillée qui mérite une plus longue réponse que celle-ci.
Je ne suis pas d’accord en gros avec une partie des reproches ici adressés à S Brizé notamment lorsque vous critiquez au passage Moi, Daniel Blake de Loach que j’avais trouvé juste.
Hélas, dans les faits, les combats sociaux de ces dernières années se sont soldés par des déceptions et des camouflets car les grévistes se heurtent à un bloc dogmatique installé depuis les années 80. S Brizé ne m’a pas révélé des réalités que j’ignorais, il est parvenu à les cristalliser de manière juste: l’union première alors qu’on sait que l’adversaire est bien plus fort, la réflexion sur les limites à ne pas dépasser, le souci de ne pas déraper pour ne pas fournir des armes à ce que l’on combat, l’effritement de l’union sacrée,la manière dont le moral et la vie de famille peut être polluée par le combat, les espoirs et trahisons, le rôle pernicieux des médias qui donnent une lecture facile à analyser.
Sa mise en scène me semble ajustée au sujet: le tremblé des plans n’a rien de systématique mais en revanche je suis frappé par la fluidité du montage.La manière dont les images d’actu s’insèrent dans le flux narratif est assez passionnante.Le film me semble bien choral même si le leader syndical interprété par V Lindon a un rôle clé et central: j’ai l’impression d’avoir croisé ces hommes te ces femmes au quotidien, d’avoir entendu leurs atermoiements et chacun existe à l’écran qu’il parle ou écoute.
Vous comparez ce film avec la série de Mordillat que j’aime bien mais qui me semblait trop feuilletonesque par moments et je lui préférais le roman initial malgré quelques morceaux de bravoure.Justement le film de S Brizé a la couleur non d’un Zola modernisé avec force détails picaresques liés à la vie intime des personnages mais montre combien cette vie privée est comme mise en suspend par le déroulé des combats syndicaux au fil des mois.C’est un choix cinématographique que ne pas embrasser cet aspect qui ne réapparait que sur le tard, de le laisser comme hors champ exactement comme certains films de guerre choisissent de ne pas mettre en situation le héros par des flashbacks sur son passé pour mieux mesurer ce qu’il perd.
Le titre est « en guerre » et c’est une guerre qui nous est montrée.
A Ballantrae.Entièrement d’accord avec vous concernant la vie de famille d’hommes et de femmes qui prennent des responsabilités au sein de syndicat,de commission paritaire,de comités d’établissement ou de permanences sociales ou juridiques dans les services publics.Les 3/4 de ces individus se retrouvent près de la cinquantaine divorcées ou séparées.Celà est montrer dans le film de Brizé.
Merci pour votre réponse, ainsi qu’à tous les autres. Sur le plan des idées, on est tous d’accord, vous, moi, Brizé… et le film montre bien l’impossibilité de changer les règles de manière uniquement locale. Mais il n’est pas mobilisateur pour les changements nécessaires, malheureusement.
Pour la vie privée ou son absence, ce n’est pas gênant, mais dans la mesure où les prises de parole se sont presque uniquement publiques, je trouve que cela ne permet pas de faire émerger des personnages. Et dans la mesure où je n’ai pas été touché, je ne voyais pas l’intérêt du film par rapport à un texte sur le fonctionnement du capitalisme financier. Mais deux personnes qui m’accompagnaient ont été très émues, alors !
Je trouve aussi le Mordillat très romanesque (le suicide par dépit amoureux… mais qui reflète aussi la situation d’un personnage respecté et privé de travail), je comprends votre impression ; je suis tout de même heureux que des personnages du peuple aient droit à ces intrigues sentimentales, d’habitude réservée à la (grande) bourgeoisie.
Puisqu’on parle de politique : si vous ne le saviez pas, Costa-Gavras (ainsi qu’il l’a raconté à Ombres blanches à Toulouse) qu’il était en train d’écrire l’adaptation du livre de Yanis Varoufakis sur le combat (ça pourrait s’appeler « En guerre » aussi) du gouvernement grec contre la troïka en 2015 (« Conversations entre adultes »). Je suis en train de le lire, c’est passionnant et assez ravageur sur les idées et les décisions de certains hommes et certaines institutions… S’il arrive à faire son film, je crois bien que ce serait la première fois qu’on verrait à l’écran ces élus, ces non-élus et leurs conflits…
On est vraiment mal barré avec ces intertitres qui nous gâchent la lecture des posts.A cecil.Vous habitez apparemment sur toulouse puisque vous citez Ombre blanche (dont la rue Gambetta va ètre rebaptisée du nom de ces librairies).Enfin ils font un bon boulot à part que la boutique dvd est inabordable et que le vendeur ne connait pas grand chose sur Eustache,Rivette,Rohmer et plein d’autres.
A Yves Rouxel
Quels intertitres ?
Et puis un autre message pour dire qu’il y en a vraiment marre du mercantilisme Star Wars. Il est désormais permanent, 365 par an. Même dans une petite boulangerie d’un village périgourdin, on trouve des produits dérivés. L’an dernier George Lucas a manqué d’étouffer ma grand-mère avec la fève d’une galette des rois, à l’effigie de je ne sais quel personnage de la série. Stop maintenant !
A Stéphane .Boycottez votre boulangerie et essayer de faire votre pain vous mème.C’est que je fait!!!
attaquez Lucas Ltd y’a du pognon à se faire!
Je m’apprêtais à aller voir le Brizé parce que j’adore le réalisateur et je l’ai montré maintes fois ici. Pourtant la bande annonce ne m’y incitait pas forcément et c’est en grande partie parce qu’elle est paradoxalement réussie : en effet à la voir il me semble qu’on y a là un parfait résumé du film… On y retrouve le duo Lindon/Brizé dans un film social : on nous vend le film comme : « vous avez aimé LA LOI DU MARCHE, vous aimerez EN GUERRE ». Or j’ai eu l’impression que Brizé avait entendu les compliments sur LA LOI DU MARCHE et se ré-engouffre donc dans le film social noir à pied joint en mode « docu ». Ce qu’en dit Cécil Faux est intéressant sur ce point. Cela me fait penser à Jean-Baptiste Thoret qui citait Serge Daney : lorsque que l’on voit un film il faut se poser la question : si ce n’était pas un film de cinéma ce serait quoi d’autre : un tract, un opéra ?… Un film qui marque durablement le spectateur ne peut réellement être comparé à autre chose. Brizé pourrait donc avoir fait un film-tract qui promeut la lutte syndicale. (LA LOI DU MARCHE était selon moi très subtil et emportait le spectateur avec le héros et ses doutes, malgré la noirceur du propos). Où serait la place du spectateur là-dedans et que deviendrait sa subjectivité si tout est prémâché avec un super héros syndicaliste luttant contre les méchants capitalistes ? C’est une question posée, à confirmer ou infirmer en voyant le film… Reste que le sujet est toujours d’une brûlante d’actualité et saura toucher émotionnellement : Brizé a ce talent-là qui vaut de toute façon le détour.
A Stephane
Il a d’abord le talent de s’intéresser à des personnages qu’on ne cesse de discréditer. Et dans une négociations syndicales, les rôles sont souvent beaucoup plus tranchées. Certains des reproches m’étonnent même sans avoir vu le film. Je me souviens d’un film de Dominique Cabrera sur une négociation syndicale que j’avais trouvé passionnant. Un des arbitres des élégances avait déploré la prédominance du dialogue… Dans une histoire qui est fondée sur l’affrontement verbal…On croit rêver… On l’a aussi reproché au LINCOLN de Spielberg alors qu’il évoquait toutes les batailles, les joutes verbales (et en coulisses les arrangements) qui avaient donné lieu au 14ème amendement. La parole syndicale est peu présente dans le cinéma français contemporain. Vous faites bien de rappeler Faillevic. Je rappelerai Cabrera, LA COUPE À 10 FRANCS de Condroyer
Bravo pour cette intervention sur la place du discours au cinéma. On a reproche à Spielberg la place du verbe politique alors que justement il s’ingéniait à le dynamiser, à en rendre les enjeux compréhensibles et passionnants.
Douze hommes en colère, Advise and consent ou encore Du silence et des ombres ont su ainsi créer autour de la justice de tels enjeux.
Que le champ politique ( Lincoln, Land and freedom), social ( Violence des échanges…, En guerre) ou militant (120 battements par minute) se rejoignent dans ce primat d’une parole synonyme de pensée de soi et du monde est évident et nécessaire.
Evoquez ici précedemment la suite de la série initiatique « Twin peacks »est un voyage entre le réel et l’iréel,le présent et le passé conjugue le futur et font de cet oeuvre une série pas comme les autres.La prouesse de Lynch et Mark Frost est de nous faire naviguer et d’essayer de nous perdre dans nos pensés profondes sur la mort à travers la disparition de la jeune Laura Palmer.Lynch incarne le chef du département du FBI complètement sourdingue mais plein d’humour.La scène ou l’on voit le personnage de Denise(David Duchovny échappé de X files en travesti)est d’une finesse d’humour qui prouve que le cinéaste est drole.L’agent Dale Cooper(Kyle mac laglan,un peu épaissit)revient dans un double role ou le bien cotoit le mal et vice versa.Les musiques autant dans les films que cette série tiennent une grande importance et colle parfaitement à l’époque froide de la société du 21ème siècle,ou les individus sont désabusés et se forcent à vivre en attendant une mort prochaine.Je conseille à tous de voir »Twin peack »histoire de s’évader un peu.
Twin Peaks avec Kyle Maclachlan, Rouxel!
Plus qu’une évasion, cette saison est l’exploration d’un monde inconnu qui cohabite avec le nôtre.
La sensualité cohabite avec le peur, l’angoisse, le malaise mais aussi le burlesque car Lynch aime rire même si son rire est étrange et ne ressemble à nul autre.
Un petit élément de la généalogie de » Twin Peaks » ( voir https://www.youtube.com/watch?v=1Ry5ZWlUb8s ,à 2’11 .) Elément signalé pat Thierry Jousse dans son émission. Beau générique , que mon épouse a immédiatement rattaché à Lynch – sans connaître l’anecdote signalée ici… Mancini plagie Badalamenti par anticipation. Mais il ne faudrait pas que le Lynchland parasite ce beau blog, aux sujets toujours passionnants.
Et, surprise : cet « Experiment in terror » est présenté par Bertrand.
… je voulais dire , dans le DVD Sidonis que m’en vais quérir.
Finalement, vu hier cet « Experiment in terror » dont François Guerif dit justement que le projet de Blake Edwardes est explicité par le titre : l’incursion d’un auteur de comédie dans le film noir ( avant de se laisser enfermer dans la comédie, parce qu’il s’y sentait chez lui) , une expérimentation de tout ce que le genre lui permet de faire sur le plan technique. Tel quel le film tient bien la route , avec son parti pris de froideur, mais ce n’est pas ce qui me fait le mentionner ici- dans ce fil « Twin Peaks ». Je n’ai pas pris le temps de chercher ce que David Lynch a retenu de ce film , mais je recense quelques éléments un peu « Bon sang , mais c’est bien sûr. » Par ordre d’apparition à l’écran : les basses profondes accompagnent les premières images, dès le logo Columbia, elles seront le signe annonciateur du méchant. Le panneau « Twin Peaks « , là où vivent Lee Remick et sa jeune soeur Stefanie Powers, où l’action va démarrer sec. On apprendra un peu plus tard que le méchant s’appelle Lynch , Red Lynch. Filmé d’abord de façon morcelée, en très gros plan, dans l’ombre,(et son nom n’apparaît qu’au générique de fin), on le reconnaîtra brusquement : Ross Martin, le célèbre Artemus Gordon des « Mystères de l’Ouest. L’essentiel de son rôle étant au téléphone , on peut parler de « Gordon calling », et là on n’est pas très loin de Gordon Cole , l’agent du FBI joué par David Lynch… mais là je JeanDouchettise un peu. « The Gordons », c’est aussi la raison sociale du couple de scénaristes du film, monsieur Gordon Gordon était un ancien du FBI. Bertrand souligne d’ailleurs cocassement la vision des Feds dans le film , efficaces, réactifs, presque parfaits.
Bien . Il y a plein de divulgâchis dans ce que je viens d’écrire , surtout pas mal de vues a posteriori , sans doute pas revendiquées par David Lynch. Mais ces rimes , vous le concéderez, sont troublantes, et c’est toujours amusant d’y songer dans le confort du canapé. Et tant mieux si on renverse un peu la chronologie , la causalité , les emprunts ; le vertige temporel qui en résulte fait pour moi partie des plaisirs du cinéma, des arts en général. Beau DVD en tous cas, qui rend justice à la belle photo de Philip Lathrop (le nom ne me disait rien , mais filmographie impressionnante, on y trouve au milieu de titres bien connus un « Portnoy » tourné dès 1972, petit salut à Philip Roth). La musique de Mancini , le souffle inquiétant de Ross Martin sont bien mis en valeur. Belles contributions complémentaires de F.Guerif, P.Brion et de Bertrand qui avoue ne pas avoir aimé le film à sa sortie: trop maniériste. Suit une magnifique et gourmande réévaluation.