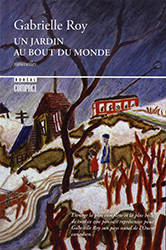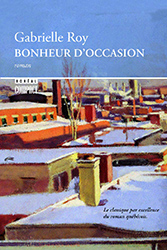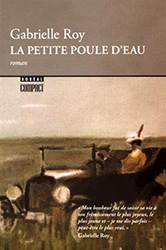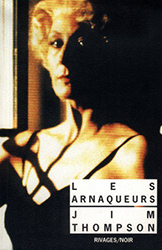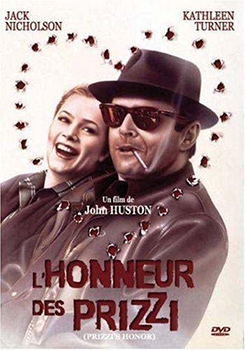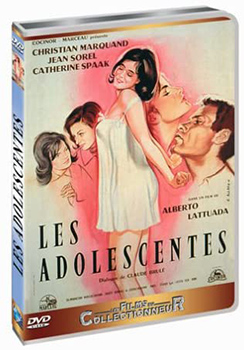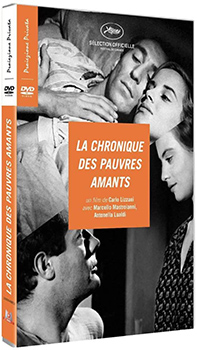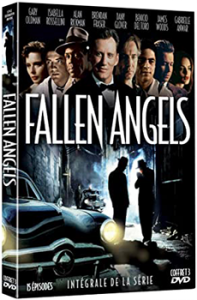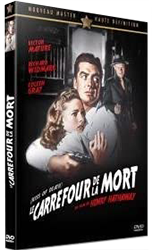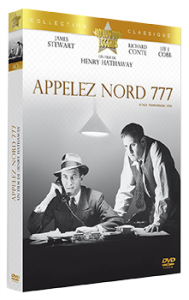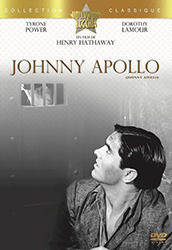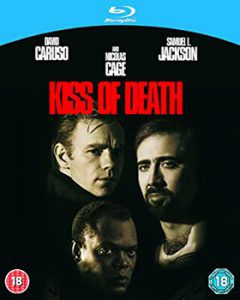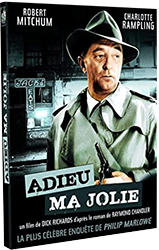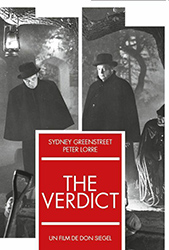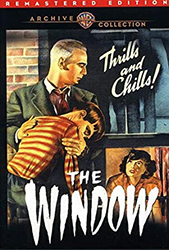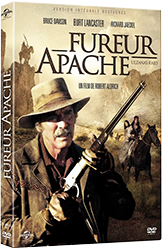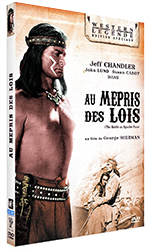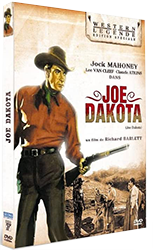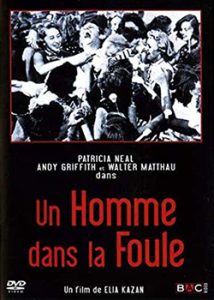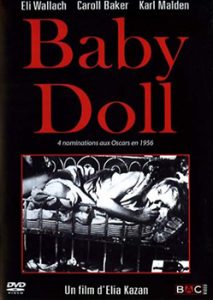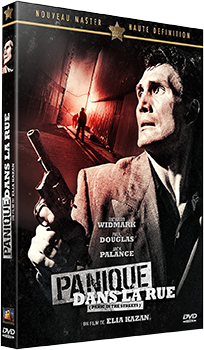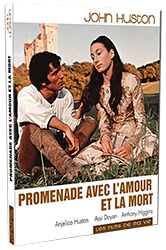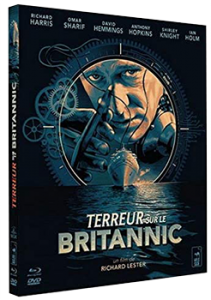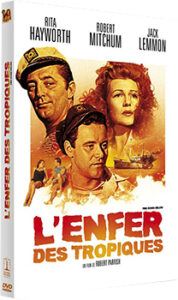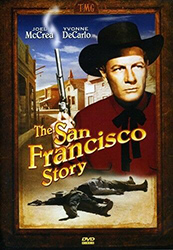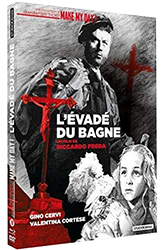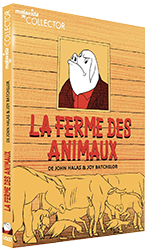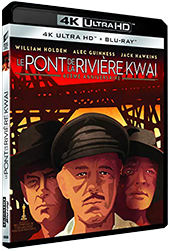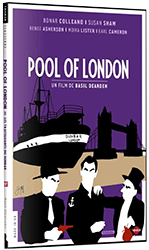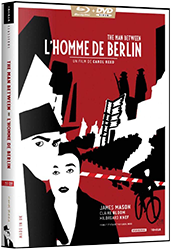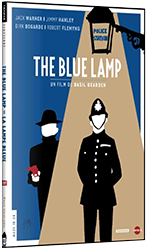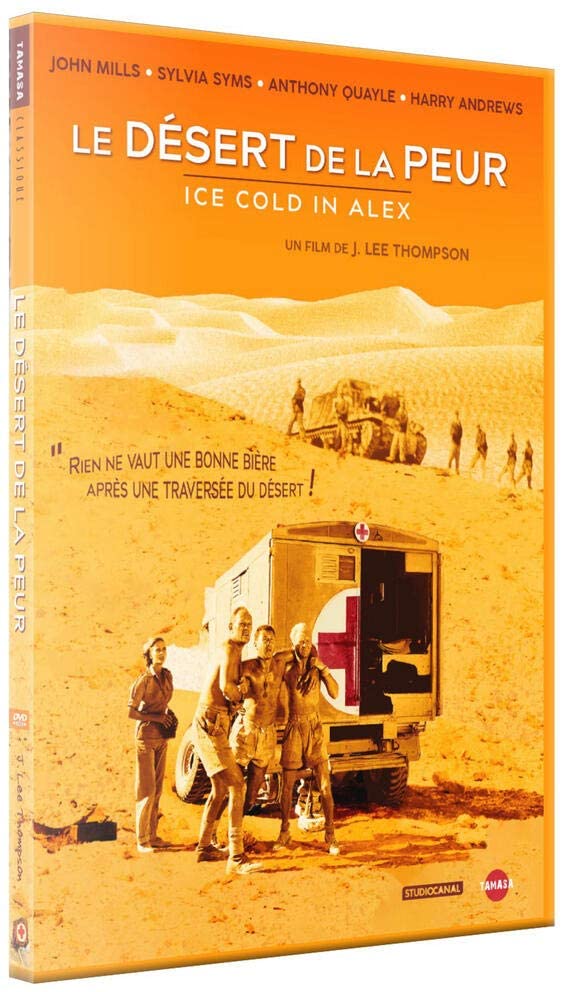Bertrand Tavernier nous a quittés le 25 mars 2021. C’est avec une immense tristesse que nous publions donc ce dernier billet sur ce blog qu’il chérissait tant et pour lequel il ne manquait jamais d’idées et d’énergie, qu’il alimentait avec régularité et générosité depuis son lancement en mai 2005.
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre engagement sur cet espace dont il modérait lui-même les très nombreux commentaires pour laisser libre cours à de passionnantes et passionnées discussions, avec vous toutes et tous, habitué(e)s et cinéphiles curieux/ses.
Pour saluer sa mémoire, nous vous invitons à lire sur le site de la SACD les hommages que lui rendent plusieurs autrices et auteurs qui l’ont côtoyé : https://bit.ly/2Pwu0H5
Et à lire ci-dessous son dernier billet. Il nous avait demandé de le publier maintenant. Nous respectons sa volonté. Et nous modèrerons les commentaires à sa place.
[mise à jour du 02 avril ] Merci à tous pour vos messages en commentaires. Vous êtes nombreux à vous inquiéter de la pérennité de ce blog. Rassurez-vous, il est pour nous inenvisageable que cette somme de savoir et de partage cesse de vous être accessible. Nous réfléchissons à tous les moyens d’en conserver le contenu, de le mettre à disposition et de le faire perdurer pour les lecteurs.
Amicalement,
L’équipe du blog
LIVRES
CHÈRE JODIE de Clovis Goux
 J’avais loué ici du même auteur LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER que m’avait fait découvrir Bertrand Burgalat. Karen et son frère Richard avaient accumulé les tubes avec des chansons réactionnaires, vendant plus de 100 millions de disques. Mais derrière ce succès, se cachait une tragédie que Clovis Goux nous révélait avec un grand talent, autopsiant le monde du show business. Il récidive avec l’extraordinaire CHÈRE JODIE, l’incroyable histoire de John Hinckley Jr, fils à papa grassouillet qui se gave de junk food (ce qu’il mange fait dresser les cheveux sur la tête) et développe une passion pour Jodie Foster, collectionnant ses photos, ses interviews, voyant une dizaine de fois chacun de ses films. Il l’a découverte dans TAXI DRIVER et s’identifie au chauffeur de taxi justicier, Travis Bickle incarné par Robert de Niro. Sauf qu’il est aussi mou, aussi maladroit que Bikle est précis et efficace. Sa mère lui passe tous ses caprices, ignore toutes les règles que tente d’instaurer son mari, souvent absent. Ce jeune homme très gras, très blanc, qui ressemble selon ses dires à un muffin, rêve de devenir une rock star comme son idole John Lennon (sauf qu’il admire aussi Hitler) alors qu’il est totalement dépourvu de talent. Quand ce dernier est assassiné, Hinckley, exaspéré par les silences de Jodie décide de tirer sur le Président Reagan et le ratera. Déclaré irresponsable, il sera enfermé dans un asile jusqu’en 2016. Clovis Goux nous révèle les dessous les plus noirs, les plus glauques de l’Amérique, une Amérique sans conscience ni repère, l’Amérique du mal. Il entrecoupe son récit à l’écriture dense de chapitres brefs et effrayants consacrés à divers tueurs en série qui commettent des meurtres aussi gratuits qu’atroces. Passionnant et terrifiant.
J’avais loué ici du même auteur LA DISPARITION DE KAREN CARPENTER que m’avait fait découvrir Bertrand Burgalat. Karen et son frère Richard avaient accumulé les tubes avec des chansons réactionnaires, vendant plus de 100 millions de disques. Mais derrière ce succès, se cachait une tragédie que Clovis Goux nous révélait avec un grand talent, autopsiant le monde du show business. Il récidive avec l’extraordinaire CHÈRE JODIE, l’incroyable histoire de John Hinckley Jr, fils à papa grassouillet qui se gave de junk food (ce qu’il mange fait dresser les cheveux sur la tête) et développe une passion pour Jodie Foster, collectionnant ses photos, ses interviews, voyant une dizaine de fois chacun de ses films. Il l’a découverte dans TAXI DRIVER et s’identifie au chauffeur de taxi justicier, Travis Bickle incarné par Robert de Niro. Sauf qu’il est aussi mou, aussi maladroit que Bikle est précis et efficace. Sa mère lui passe tous ses caprices, ignore toutes les règles que tente d’instaurer son mari, souvent absent. Ce jeune homme très gras, très blanc, qui ressemble selon ses dires à un muffin, rêve de devenir une rock star comme son idole John Lennon (sauf qu’il admire aussi Hitler) alors qu’il est totalement dépourvu de talent. Quand ce dernier est assassiné, Hinckley, exaspéré par les silences de Jodie décide de tirer sur le Président Reagan et le ratera. Déclaré irresponsable, il sera enfermé dans un asile jusqu’en 2016. Clovis Goux nous révèle les dessous les plus noirs, les plus glauques de l’Amérique, une Amérique sans conscience ni repère, l’Amérique du mal. Il entrecoupe son récit à l’écriture dense de chapitres brefs et effrayants consacrés à divers tueurs en série qui commettent des meurtres aussi gratuits qu’atroces. Passionnant et terrifiant.
 J’ai déjà loué AVENTURES de John Boorman (Marest) et j’en ai profité pour revoir LE POINT DE NON RETOUR, toujours aussi flamboyant avec une utilisation des couleurs et de l’espace qui me laissent hyper admiratifs et LA FORÊT D’ÉMERAUDE dont l’audace, l’invention visuelle laissent pantois. Et aussi le regard porté sur les indigènes si différent de celui qu’on trouve dans de multiples films américains, à commencer par l’utilisation des langues. Léger bémol, Powers Boothe mérite à deux ou trois reprises les reproches que décerne Pascal Minette à Mason. Il a tendance à surexpliquer et forcer son jeu, ce qui affaiblit le personnage, le rend trop visiblement antipathique alors que Charley Boorman est confondant de grâce, de naturel. La conclusion de ce film si en avance (l’utilisation des drogues hallucinogènes héritées de celles qu’on voit dans le film pour guérir, réveiller les souvenirs, fleurit maintenant de manière microdosée à Hollywood).
J’ai déjà loué AVENTURES de John Boorman (Marest) et j’en ai profité pour revoir LE POINT DE NON RETOUR, toujours aussi flamboyant avec une utilisation des couleurs et de l’espace qui me laissent hyper admiratifs et LA FORÊT D’ÉMERAUDE dont l’audace, l’invention visuelle laissent pantois. Et aussi le regard porté sur les indigènes si différent de celui qu’on trouve dans de multiples films américains, à commencer par l’utilisation des langues. Léger bémol, Powers Boothe mérite à deux ou trois reprises les reproches que décerne Pascal Minette à Mason. Il a tendance à surexpliquer et forcer son jeu, ce qui affaiblit le personnage, le rend trop visiblement antipathique alors que Charley Boorman est confondant de grâce, de naturel. La conclusion de ce film si en avance (l’utilisation des drogues hallucinogènes héritées de celles qu’on voit dans le film pour guérir, réveiller les souvenirs, fleurit maintenant de manière microdosée à Hollywood).
Essayez, s’il vous plait (je m’adresse en premier à Ballantrae mais les autres doivent suivre) de découvrir Gabrielle Roy, cette romancière du Manitoba dont il FAUT lire : LA DÉTRESSE ET L’ENCHANTEMENT et FRAGILES LUMIÈRES DE LA TERRE qui contient une série de descriptions chaleureuses et incisives sur les différentes sectes, ethnies qui sont venues se réfugier au Manitoba et au Canada : les Mennonites, les Huttérites, les Ukrainiens, les deux recueils de nouvelles qui contiennent des trésors : LA ROUTE D’ALTAMONT, UN JARDIN AU BOUT DU MONDE. BONHEUR D’OCCASION, LA PETITE POULE D’EAU sont des romans forts, lyriques. Le second retrace avec émotion le sort des Canadiens venus se battre en France en 1917. Deux citations : « Ce bruit de soupir, d’inquiétudes que fait le temps qui passe » et « La mort du présent n’est rien ; c’est la perte de l’avenir en soi qui est déchirante ». Du Manitoba où elle fut institutrice (lire CES ENFANTS DE MA VIE), elle écrivait que l’espace et le ciel sont si immenses que la vue d’un oiseau peut vous briser le coeur : https://citations.ouest-france.fr/citation-gabrielle-roy/mort-present-rien-perte-avenir-18751.html
 Disparition de Michel Le Bris dont j’avais loué plusieurs fois le merveilleux KONG et son dernier essai POUR L’AMOUR DES LIVRES, si utile, si revigorant en ces temps d’ignorance et de dictature du présent. Ne pas oublier que Le Bris parvint à rétablir le texte original de très nombreux ouvrages de Robert Louis Stevenson, qu’il publia ses essais magnifiques, sa correspondance avec Henry James, deux recueils de nouvelles et qu’il nous fit connaître MOONFLEET, le roman qui inspira à Lange LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET, adapté avec une désinvolture étonnante. Jeremy Fox n’existe pratiquement pas dans le livre. On doit aussi à Michel le festival Étonnants Voyageurs que je ne manquais pour rien au monde. C’était un ami cher qui laisse un vide immense.
Disparition de Michel Le Bris dont j’avais loué plusieurs fois le merveilleux KONG et son dernier essai POUR L’AMOUR DES LIVRES, si utile, si revigorant en ces temps d’ignorance et de dictature du présent. Ne pas oublier que Le Bris parvint à rétablir le texte original de très nombreux ouvrages de Robert Louis Stevenson, qu’il publia ses essais magnifiques, sa correspondance avec Henry James, deux recueils de nouvelles et qu’il nous fit connaître MOONFLEET, le roman qui inspira à Lange LES CONTREBANDIERS DE MOONFLEET, adapté avec une désinvolture étonnante. Jeremy Fox n’existe pratiquement pas dans le livre. On doit aussi à Michel le festival Étonnants Voyageurs que je ne manquais pour rien au monde. C’était un ami cher qui laisse un vide immense.
Je relis avec beaucoup de plaisir les romans de Donald Westlake, le cinglant KAWA, HISTOIRE D’ESCROQUERIE CHEZ AMIN DADA, PIERRE QUI ROULE devenu au cinéma THE HOT ROCK, DÉGÂTS DES EAUX… Et ceux d’Elmore Leonard au dialogue si inventif, si incisif et si cocasse : INCONNU 89 et ZIG ZAG MOVIE sont de petites merveilles. Westlake écrivit l’une des meilleures adaptations de Jim Thompson, LES ARNAQUEURS si bien filmé par Stephen Frears et dans les bonus, il déclare que le premier film qui sut saisir l’âme de Thompson était le (je m’excuse) génial COUP DE TORCHON et cette âme était gallique (gauloise ?).
Relu aussi une des trilogies de Manuel Vasquez Montalban (le Seuil – 3 romans MEURTRE AU COMITÉ CENTRAL, TATOUAGES, LES MERS DU SUD) avec le détective gastronome (ses recette font saliver) Pepe Carvalho, ex-trotskiste anarchiste, ayant un moment travaillé avec la CIA, qui brûle les livres de sa bibliothèque en se confrontant aux problèmes sociaux et politiques de l’Espagne post-franquiste.
CINÉMA
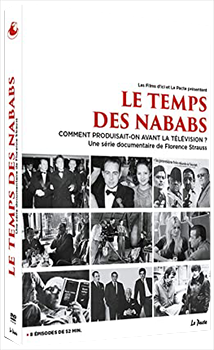 Je voudrais commencer par dire tout le bien que je pense du TEMPS DES NABABS de Florence Strauss sur les producteurs français d’avant la télévision, de son père Jacques Eric, lié aux frères Hakim, d’Alexandre Mnouchkine à Serge Silberman en passant par Raymond Danon et Albina du Bois Rouvray. Il faut entendre Jean-Claude Carrière (j’en profite pour le saluer) parler des producteurs avec une verve éblouissante, racontant comment Deutchmeister (LA TRAVERSÉE DE PARIS, LE ROUGE ET LE NOIR) après lui avoir demandé de lire l’adaptation de ROBINSON CRUSOË qu’il lui avait commandé (il faisait partie des producteur qui exigeait qu’on leur lise) le questionne anxieusement : « Mais Jean-Claude, vous ne trouvez pas que Robinson, il est un peu seul ». Et quand Jean-Claude lui objectait qu’une de ses suggestions n’était pas cartésienne, lançait tout de go : « Cartès ? Qui connaît Cartès aujourd’hui ? » Il trace un portrait haut en couleur de Serge Silberman, producteur de tous les Buñuel postérieurs au JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE, qui vont de BELLE DE JOUR, des CHARMES DISCRETS DE LA BOURGEOISIE à la VOIE LACTÉE en passant par TRISTANA et LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ. Toutes ses œuvres qui continuent un manifeste de Défense de la liberté. Claude Piéplu vient soudainement interrompre la narration en nous présentant un sous officier : « le Sergent a une rêve très intéressant à vous raconter » et hop, on coupe sur le rêve. L’entendre évoquer comment sont nés ces chefs d’œuvre est un régal. L’évocation de Mnouchkine, jamais plus heureux que quant il y avait des problèmes à résoudre dans l’urgence, si loyal dans ses rapports avec ses metteurs en scène, de Christian Jaque à Philippe de Broca, est des plus émouvantes et j’ai même appris des détails passionnants sur la vie de Raymond Danon qui a un peu tendance à zapper ceux qui lui apportent des projets comme Girard et Jean Bolvary qui sont allés le trouver avec le package Sautet, Dabadie, Guimard pour les CHOSES DE LA VIE et MAX ET LES FERRAILLEURS. Mais il évoque de manière touchante le lien d’amitié qui l’unissait à Romy Schneider, produisant la PASSANTE DU SANS SOUCI sans l’assurer.
Je voudrais commencer par dire tout le bien que je pense du TEMPS DES NABABS de Florence Strauss sur les producteurs français d’avant la télévision, de son père Jacques Eric, lié aux frères Hakim, d’Alexandre Mnouchkine à Serge Silberman en passant par Raymond Danon et Albina du Bois Rouvray. Il faut entendre Jean-Claude Carrière (j’en profite pour le saluer) parler des producteurs avec une verve éblouissante, racontant comment Deutchmeister (LA TRAVERSÉE DE PARIS, LE ROUGE ET LE NOIR) après lui avoir demandé de lire l’adaptation de ROBINSON CRUSOË qu’il lui avait commandé (il faisait partie des producteur qui exigeait qu’on leur lise) le questionne anxieusement : « Mais Jean-Claude, vous ne trouvez pas que Robinson, il est un peu seul ». Et quand Jean-Claude lui objectait qu’une de ses suggestions n’était pas cartésienne, lançait tout de go : « Cartès ? Qui connaît Cartès aujourd’hui ? » Il trace un portrait haut en couleur de Serge Silberman, producteur de tous les Buñuel postérieurs au JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE, qui vont de BELLE DE JOUR, des CHARMES DISCRETS DE LA BOURGEOISIE à la VOIE LACTÉE en passant par TRISTANA et LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ. Toutes ses œuvres qui continuent un manifeste de Défense de la liberté. Claude Piéplu vient soudainement interrompre la narration en nous présentant un sous officier : « le Sergent a une rêve très intéressant à vous raconter » et hop, on coupe sur le rêve. L’entendre évoquer comment sont nés ces chefs d’œuvre est un régal. L’évocation de Mnouchkine, jamais plus heureux que quant il y avait des problèmes à résoudre dans l’urgence, si loyal dans ses rapports avec ses metteurs en scène, de Christian Jaque à Philippe de Broca, est des plus émouvantes et j’ai même appris des détails passionnants sur la vie de Raymond Danon qui a un peu tendance à zapper ceux qui lui apportent des projets comme Girard et Jean Bolvary qui sont allés le trouver avec le package Sautet, Dabadie, Guimard pour les CHOSES DE LA VIE et MAX ET LES FERRAILLEURS. Mais il évoque de manière touchante le lien d’amitié qui l’unissait à Romy Schneider, produisant la PASSANTE DU SANS SOUCI sans l’assurer.
HUSTON
Dans les films de John Huston, j’avais oublié de mentionner L’HONNEUR DES PRIZZI qu’adorait Jean-Pierre Melville, œuvre colérique s’en prenant de front à la mythologie élaborée autour de la Mafia, décrite ici comme un monde où triomphe la corruption, le machisme, le mensonge, la vulgarité la plus crasse. Tout ce que selon certains intervenants dans ce blog, on accole sous des dehors luxueux aux films de Coppola. A mon avis Huston s’en prend surtout au premier volet. Mais je passais aussi sous silence les recherches formelles de MOULIN ROUGE, revu dans une copie restaurée, qui restent éblouissantes. La photo géniale d’Oswald Morris a trente ans d’avance sur celle des films français contemporains, notamment dans l’utilisation des sources de lumière, des zones d’ombre. Et en regard des autres biographies de l’époque, le film de Huston reste d’une dureté de ton confondante.
COMÉDIES MUSICALES
 J’ai revu récemment un certain nombre de comédies musicales dont GIVE A GIRL A BREAK, qui est un pur délice. Partant d’un argument ultra classique (3 candidates désirent le même rôle), Stanley Donen dont c’est la première mise en scène en solo, respecte en apparence ce classicisme tout en le renouvelant de l’intérieur par le biais d’une chorégraphie moderne, intimiste, généralement des numéros à deux, le plus souvent sur une musique jazzy, dont le chef d’œuvre est sans doute la merveilleuse danse sur une terrasse entre Bob Fosse et Debbie Reynolds qui jette toutes les bases du musical moderne. Le premier numéro de Marge et Gower Champion est tout aussi euphorisant et les pitreries de Kurt Kaznar sont amusantes Voilà une œuvre revigorante, stimulante.
J’ai revu récemment un certain nombre de comédies musicales dont GIVE A GIRL A BREAK, qui est un pur délice. Partant d’un argument ultra classique (3 candidates désirent le même rôle), Stanley Donen dont c’est la première mise en scène en solo, respecte en apparence ce classicisme tout en le renouvelant de l’intérieur par le biais d’une chorégraphie moderne, intimiste, généralement des numéros à deux, le plus souvent sur une musique jazzy, dont le chef d’œuvre est sans doute la merveilleuse danse sur une terrasse entre Bob Fosse et Debbie Reynolds qui jette toutes les bases du musical moderne. Le premier numéro de Marge et Gower Champion est tout aussi euphorisant et les pitreries de Kurt Kaznar sont amusantes Voilà une œuvre revigorante, stimulante.
 KISS ME KATE est l’une des très rares comédies musicales qui lors de son adaptation au cinéma ait conservé toutes les chansons écrites par Cole Porter et qui sont toutes des merveilles tant en ce qui concerne la partition très variée, très inventive que les lyrics. Il s’agit là de variations très astucieuses autour d’une représentation de la MÉGÈRE APPRIVOISÉE dont les comédiens reproduisent quand ils la jouent sur scène, les quiproquos, les disputes, les ruptures de la pièce originale dans une astucieuse construction gigogne. Quelques lyrics ont été expurgés dans le film (allusion au Kinsey Report) étant donné la pruderie de la MGM et de la Censure. Plusieurs sont devenues des standards de jazz (je pense à « So In Love » par Milt Jackson). L’une des plus savoureuses est sans conteste « Brush up your Shakespeare », variation hilarante sur les titres, les vers des pièces shakespeariennes chantées par James Whitmore et Keennan Wynn qui jouent les deux mafiosi en charge de récupérer l’argent que doit le promoteur de la pièce. George Sidney a même rajouté un titre qui avait été coupé à Broadway, la version du très rythmé « Too Darn Hot » superbement chantée par Ann Miller. Tous les numéros avec Miller sont exceptionnels qu’elle danse avec Tommy Rall ou dans « Tom Dick and Harry », autre triomphe jazzistique de Porter avec Bobby Van, Rall et Fosse. Même si Hermes Pan est crédité pour la danse très sensuelle entre Carol Haney et Bob Fosse sur « From This Moment On », elle fut en fait chorégraphiée par Fosse qui exécute un incroyable salto arrière. C’est à partir de ce film qu’on le remarqua. Les costumes sont parfois submergées par une surabondance de couleurs kitsch mais les décors, souvent très beaux, évoquent les toiles de Chirico. Leur quasi abstraction met en valeur les prouesses chorégraphique de Tommy Rall, Bob Fosse.
KISS ME KATE est l’une des très rares comédies musicales qui lors de son adaptation au cinéma ait conservé toutes les chansons écrites par Cole Porter et qui sont toutes des merveilles tant en ce qui concerne la partition très variée, très inventive que les lyrics. Il s’agit là de variations très astucieuses autour d’une représentation de la MÉGÈRE APPRIVOISÉE dont les comédiens reproduisent quand ils la jouent sur scène, les quiproquos, les disputes, les ruptures de la pièce originale dans une astucieuse construction gigogne. Quelques lyrics ont été expurgés dans le film (allusion au Kinsey Report) étant donné la pruderie de la MGM et de la Censure. Plusieurs sont devenues des standards de jazz (je pense à « So In Love » par Milt Jackson). L’une des plus savoureuses est sans conteste « Brush up your Shakespeare », variation hilarante sur les titres, les vers des pièces shakespeariennes chantées par James Whitmore et Keennan Wynn qui jouent les deux mafiosi en charge de récupérer l’argent que doit le promoteur de la pièce. George Sidney a même rajouté un titre qui avait été coupé à Broadway, la version du très rythmé « Too Darn Hot » superbement chantée par Ann Miller. Tous les numéros avec Miller sont exceptionnels qu’elle danse avec Tommy Rall ou dans « Tom Dick and Harry », autre triomphe jazzistique de Porter avec Bobby Van, Rall et Fosse. Même si Hermes Pan est crédité pour la danse très sensuelle entre Carol Haney et Bob Fosse sur « From This Moment On », elle fut en fait chorégraphiée par Fosse qui exécute un incroyable salto arrière. C’est à partir de ce film qu’on le remarqua. Les costumes sont parfois submergées par une surabondance de couleurs kitsch mais les décors, souvent très beaux, évoquent les toiles de Chirico. Leur quasi abstraction met en valeur les prouesses chorégraphique de Tommy Rall, Bob Fosse.
 Je n’avais jamais vu THE KING AND I, l’une des comédies musicales favorites de Jane Birkin, étant un peu refroidi par les mises en scène impersonnelles de Walter Lang. Mais là, il bénéficie d’une chorégraphie de Jérôme Robbins et de l’apport considérable du chef opérateur Leon Shamroy qui transforme chaque tableau en un univers monochrome extrêmement plaisant. Déborah Kerr est délicieuse et Yul Brynner tout à fait plaisant en monarque tyrannique cherchant à s’occidentaliser.
Je n’avais jamais vu THE KING AND I, l’une des comédies musicales favorites de Jane Birkin, étant un peu refroidi par les mises en scène impersonnelles de Walter Lang. Mais là, il bénéficie d’une chorégraphie de Jérôme Robbins et de l’apport considérable du chef opérateur Leon Shamroy qui transforme chaque tableau en un univers monochrome extrêmement plaisant. Déborah Kerr est délicieuse et Yul Brynner tout à fait plaisant en monarque tyrannique cherchant à s’occidentaliser.
 Le sujet et les dialogues de THE AFFAIR OF DOBBIE GILLIS de Don Weis ne volent pas très haut, recyclant avec lourdeur un grand nombre de clichés qui donnent une image assez consternante de l’Université et de ce que l’on y enseigne. Mais le film est sauvé par ses interprètes qui tous, Bobby Van, Bob Fosse, Debbie Reynolds, débordent d’énergie et d’invention. On y entend plusieurs fois « All I Do is Dream of you » qu’on entendait dans CHANTON SOUS LA PLUIE et qui est repris dans une version délicieuse, sur un tempo de ballade par Bobby Van, la révélation du film qui le chante avec Debbie Reynolds tout en jouant de l’ukulélé dans un canoë. Cette composition d’Arthur Freed et Nacio Herb Brown est chantée plusieurs fois tout au long de l’histoire. Bobby Van triomphe dans « I am thru with Love ». Tout compte fait une plaisante surprise si on oublie le sujet.
Le sujet et les dialogues de THE AFFAIR OF DOBBIE GILLIS de Don Weis ne volent pas très haut, recyclant avec lourdeur un grand nombre de clichés qui donnent une image assez consternante de l’Université et de ce que l’on y enseigne. Mais le film est sauvé par ses interprètes qui tous, Bobby Van, Bob Fosse, Debbie Reynolds, débordent d’énergie et d’invention. On y entend plusieurs fois « All I Do is Dream of you » qu’on entendait dans CHANTON SOUS LA PLUIE et qui est repris dans une version délicieuse, sur un tempo de ballade par Bobby Van, la révélation du film qui le chante avec Debbie Reynolds tout en jouant de l’ukulélé dans un canoë. Cette composition d’Arthur Freed et Nacio Herb Brown est chantée plusieurs fois tout au long de l’histoire. Bobby Van triomphe dans « I am thru with Love ». Tout compte fait une plaisante surprise si on oublie le sujet.
 J’ai enfin pu revoir en zone 1 LES AVENTURES DE HADJI BABA, toujours de Don Weis, un de ces contes orientaux dont raffolait le producteur Walter Wanger (« tits and sand »). Avec le scénariste Richard Collins, un des tenant de la ligne la plus dure, la plus dogmatique dans le Parti Communiste Américain (il sermonna violemment Albert Maltz et Polonsky entre autres) avant de devenir un mouchard, ils conçoivent un scénario détendu, moqueur (tongue in cheek) qui faillit devenir un projet de George Cukor. On retrouve au générique deux des concepteurs visuels les plus importants d’UNE ETOILE EST NÉE et de l’œuvre de Cukor en général, Gene Allen et George Hoyningen-Huene que l’on doit davantage créditer du raffinement visuel du film que le chef opérateur très ordinaire qu’est Harold Lipstein. Le pré-générique de la VF dont nous connaissions les dialogues par cœur se terminaient par : « J’exerce peut être le métier de barbier mais j’ai les désirs d’un prince » avant que d’enchainer sur une « complainte perse » (sic) chantée par Nat King Cole sur une musique de Dimitri Tiomkin que nous connaissions aussi par cœur. Ceci à l’attention de Pascal Minette. La version originale fut réclamée pendant des années sur le cahier du studio Parnasse par les néo-macmahonniens et Jean-Louis Cheray finit par écrire : « Cessez vos gamineries. » Le film ne manque pas de charme surtout quand il oppose Elaine Stewart, princesse capricieuse et gâtée et cruelle et John Derek plus à l’aise avec ce personnage en carton pâte qu’en héros de Nicholas Ray. Leurs affrontements qui se transforment en scène d’amour quand ils sont attachés par les Amazones ne manque ni de piquant, ni d’audace. Par ailleurs, Richard Collins écrivit le scénario des RÉVOLTÉS DE LA CELLULE 11 inspiré par la peine de prison que dut subir Wanger pour avoir tiré sur l’amant de Joan Bennett, Jennings Lang, futur dirigeant d’Universal qui finança MADIGAN, PLAY MISTY FOR ME, WILLIE BOY, LES PROIES, CHARLEY WARRICK, AIRPORT et plusieurs films catastrophe que vient de ressortir Sidonis en Blu-ray.
J’ai enfin pu revoir en zone 1 LES AVENTURES DE HADJI BABA, toujours de Don Weis, un de ces contes orientaux dont raffolait le producteur Walter Wanger (« tits and sand »). Avec le scénariste Richard Collins, un des tenant de la ligne la plus dure, la plus dogmatique dans le Parti Communiste Américain (il sermonna violemment Albert Maltz et Polonsky entre autres) avant de devenir un mouchard, ils conçoivent un scénario détendu, moqueur (tongue in cheek) qui faillit devenir un projet de George Cukor. On retrouve au générique deux des concepteurs visuels les plus importants d’UNE ETOILE EST NÉE et de l’œuvre de Cukor en général, Gene Allen et George Hoyningen-Huene que l’on doit davantage créditer du raffinement visuel du film que le chef opérateur très ordinaire qu’est Harold Lipstein. Le pré-générique de la VF dont nous connaissions les dialogues par cœur se terminaient par : « J’exerce peut être le métier de barbier mais j’ai les désirs d’un prince » avant que d’enchainer sur une « complainte perse » (sic) chantée par Nat King Cole sur une musique de Dimitri Tiomkin que nous connaissions aussi par cœur. Ceci à l’attention de Pascal Minette. La version originale fut réclamée pendant des années sur le cahier du studio Parnasse par les néo-macmahonniens et Jean-Louis Cheray finit par écrire : « Cessez vos gamineries. » Le film ne manque pas de charme surtout quand il oppose Elaine Stewart, princesse capricieuse et gâtée et cruelle et John Derek plus à l’aise avec ce personnage en carton pâte qu’en héros de Nicholas Ray. Leurs affrontements qui se transforment en scène d’amour quand ils sont attachés par les Amazones ne manque ni de piquant, ni d’audace. Par ailleurs, Richard Collins écrivit le scénario des RÉVOLTÉS DE LA CELLULE 11 inspiré par la peine de prison que dut subir Wanger pour avoir tiré sur l’amant de Joan Bennett, Jennings Lang, futur dirigeant d’Universal qui finança MADIGAN, PLAY MISTY FOR ME, WILLIE BOY, LES PROIES, CHARLEY WARRICK, AIRPORT et plusieurs films catastrophe que vient de ressortir Sidonis en Blu-ray.
FILMS ITALIENS
 Artus vient de sortir dans une copie magnifiquement restaurée, LES CENT CAVALIERS de mon grand ami Vittorio Cottafavi et cette nouvelle vision m’a comblée. Cette épopée prosaïque, aux multiples changements de ton, se déroule pendant l’An Mil et oppose les Maures, les Chrétiens et chez ces derniers, les propriétaires la plupart avides et impitoyables, les paysans, les brigands, les femmes. Quelle splendide utilisation de l’espace, des couleurs avec le bleu des Maures tranchant sur les costumes bigarrés des Chrétiens. Quelle originalité dans le ton adopté où l’on sent en effet l’influence de Brecht lors de la scène d’ouverture où un peintre qui termine une fresque interpelle un interlocuteur invisible, le public. Le procédé est repris de manière drolatique dans la conclusion. Deux moments coupés dans les copies précédentes. Je n’avais jamais oublié un plan où l’on voyait s’approcher un cavalier suivi peut-être de deux ou trois autres. Tout à coup, il se déployaient en une ligne horizontale et on découvrait qu’ils étaient beaucoup plus nombreux, effet saisissant. La mémoire jouant parfois des tours, je pensais qu’il s’agissait des cavaliers Maures mais c’étaient en fait les Chrétiens. Extraordinaire séquence de bataille qui vire au noir et blanc pour que l’on identifie moins les camps respectifs (sur le net un crétin pense que c’est une erreur technique ou dû au faible budget, deux contresens). Les protagonistes meurent dans l’anonymat comme dans Shakespeare et l’on s’attarde seulement sur la mort des deux chefs : le sheikh qui marche en sentant la mort l’envahir, plan sublime ; Arnoldo Foa, le père du héros qui se relève en demandant si on a gagné, trouve qu’il fait sombre et dit « Mais je meurs, je meurs », passage que que j’ai revu trois fois de suite. Bon bonus de François de la Bretèque surtout quand il analyse le contexte historique de l’époque et la vision qu’en a Cottafavi. Plus discutable quand il met dans le même sac Freda, Bava et Cottafavi. Ce dernier voulait faire des films néoréalistes mais fut exclu du mouvement du fait que la FLAMME QUI NE S’ÉTEINT PAS exaltait le courage d’un carabinier. C’était un fait authentique que 60 ou 70 critiques bornés, staliniens refusèrent de prendre en compte alors que Cottafavi était plutôt marxiste modéré et pour vivre il dut se rabattre sur le mélodrame et le film de cape et d’épée avec de vraies réussites signalées dans ce blog : FILLE D’AMOUR (en VO chez René Château), MILADY ET LES MOUSQUETAIRES. Freda au contraire haïssait le néoréalisme et ne voulait se plonger que dans le film d’aventures ou le mélodrame. Bava lui débuta quand il n’était plus question du néoréalisme. D’autre part, de la Bretèque oublie qu’avant moi, Truffaut défendit FILLE D’AMOUR, que contrairement à ce qu’il dit les Cahiers publièrent un éloge des LÉGIONS DE CLÉOPÂTRE et que le rôle des néo-macmahonniens, Lourcelles, Mourlet a été prépondérant. La première revue à se passionner pour Cottafavi est Présence du cinéma avec le célèbre article Du côté de Racine.
Artus vient de sortir dans une copie magnifiquement restaurée, LES CENT CAVALIERS de mon grand ami Vittorio Cottafavi et cette nouvelle vision m’a comblée. Cette épopée prosaïque, aux multiples changements de ton, se déroule pendant l’An Mil et oppose les Maures, les Chrétiens et chez ces derniers, les propriétaires la plupart avides et impitoyables, les paysans, les brigands, les femmes. Quelle splendide utilisation de l’espace, des couleurs avec le bleu des Maures tranchant sur les costumes bigarrés des Chrétiens. Quelle originalité dans le ton adopté où l’on sent en effet l’influence de Brecht lors de la scène d’ouverture où un peintre qui termine une fresque interpelle un interlocuteur invisible, le public. Le procédé est repris de manière drolatique dans la conclusion. Deux moments coupés dans les copies précédentes. Je n’avais jamais oublié un plan où l’on voyait s’approcher un cavalier suivi peut-être de deux ou trois autres. Tout à coup, il se déployaient en une ligne horizontale et on découvrait qu’ils étaient beaucoup plus nombreux, effet saisissant. La mémoire jouant parfois des tours, je pensais qu’il s’agissait des cavaliers Maures mais c’étaient en fait les Chrétiens. Extraordinaire séquence de bataille qui vire au noir et blanc pour que l’on identifie moins les camps respectifs (sur le net un crétin pense que c’est une erreur technique ou dû au faible budget, deux contresens). Les protagonistes meurent dans l’anonymat comme dans Shakespeare et l’on s’attarde seulement sur la mort des deux chefs : le sheikh qui marche en sentant la mort l’envahir, plan sublime ; Arnoldo Foa, le père du héros qui se relève en demandant si on a gagné, trouve qu’il fait sombre et dit « Mais je meurs, je meurs », passage que que j’ai revu trois fois de suite. Bon bonus de François de la Bretèque surtout quand il analyse le contexte historique de l’époque et la vision qu’en a Cottafavi. Plus discutable quand il met dans le même sac Freda, Bava et Cottafavi. Ce dernier voulait faire des films néoréalistes mais fut exclu du mouvement du fait que la FLAMME QUI NE S’ÉTEINT PAS exaltait le courage d’un carabinier. C’était un fait authentique que 60 ou 70 critiques bornés, staliniens refusèrent de prendre en compte alors que Cottafavi était plutôt marxiste modéré et pour vivre il dut se rabattre sur le mélodrame et le film de cape et d’épée avec de vraies réussites signalées dans ce blog : FILLE D’AMOUR (en VO chez René Château), MILADY ET LES MOUSQUETAIRES. Freda au contraire haïssait le néoréalisme et ne voulait se plonger que dans le film d’aventures ou le mélodrame. Bava lui débuta quand il n’était plus question du néoréalisme. D’autre part, de la Bretèque oublie qu’avant moi, Truffaut défendit FILLE D’AMOUR, que contrairement à ce qu’il dit les Cahiers publièrent un éloge des LÉGIONS DE CLÉOPÂTRE et que le rôle des néo-macmahonniens, Lourcelles, Mourlet a été prépondérant. La première revue à se passionner pour Cottafavi est Présence du cinéma avec le célèbre article Du côté de Racine.
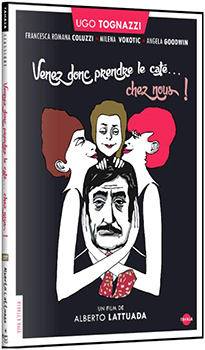 Parmi les grands cinéastes italiens, Alberto Lattuada est l’un des plus méconnus. On devrait ajouter une méconnaissance à éclipse car durant les années 50 plusieurs de ses réalisations furent louées par la critique, je pense à SANS PITIÉ, invisible depuis longtemps, au BANDIT qui a été heureusement réédité où néoréalisme et film noir coexistaient dans un mélange assez détonant. J’avais ici même défendu MAFIOSO, chef d’œuvre décapant traité dans un style dépouillé, sec, sans éclats lyriques (on pense à un conte moral du XVIIIème) sur les pratiques de la Mafia qui transbahute un contremaitre sicilien travaillant dans le Nord, lors de ses vacances en Sicile, en Amérique pour commettre un crime dont on ne peut le soupçonner. Une des plus grands rôles de Sordi que Tamasa eut la bonne idée de sortir. Ils ajoutent maintenant VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ… CHEZ NOUS ! Comme l’écrit Philippe Paul sur DVDClassik : « Pour ce film, Lattuada s’inspire d’un roman de Piero Chiara, La Spartizione – Le Trigame en version française – dont il transporte le récit des années 30 aux années 70. VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ… CHEZ NOUS ! suit le destin d’un petit fonctionnaire un peu falot, Emerenziano Paronzini, qui, encouragé par les valeurs patriarcales de l’Italie de l’époque et par son statut de petit bourgeois, va entreprendre de séduire une des sœurs Tettamanzi, trois vieilles filles enfermées dans leurs frustrations par les barrières morales imposées par la religion et la société. Son plan va fonctionner au-delà de ses espérances puisque les trois femmes deviendront ses amantes, satisfaisant plus que largement à ses besoins qu’il définissait en début de film, les « trois C : caresses, chaleur, commodité. » Crédité à Adriano Baracco, Tullio Kezich ainsi qu’à Alberto Lattuada et au romancier Pietro Chiara lui-même, le scénario se focalise sur l’argument principal du récit, en se détachant presque totalement de toute autre considération sociale ou politique, produisant ainsi un film déconnecté de la réalité italienne de l’époque, hormis évidemment pour la question morale de la sexualité et de la polygamie inhérente au sujet. » La sexualité a toujours été l’un des grands sujets abordés par Lattuada jusque dans son sketch amusant mais un peu facile d’AMORE IN CITA, des ITALIENS SE RETOURNENT en passant par LA NOVICE que j’aimerais revoir. L’autre versant de l’oeuvre de Lattuada est imprégnée de l’influence, de l’admiration pour la littérature russe : LA STEPPE, CŒUR DE CHIEN, LA FILLE DU CAPITAINE.
Parmi les grands cinéastes italiens, Alberto Lattuada est l’un des plus méconnus. On devrait ajouter une méconnaissance à éclipse car durant les années 50 plusieurs de ses réalisations furent louées par la critique, je pense à SANS PITIÉ, invisible depuis longtemps, au BANDIT qui a été heureusement réédité où néoréalisme et film noir coexistaient dans un mélange assez détonant. J’avais ici même défendu MAFIOSO, chef d’œuvre décapant traité dans un style dépouillé, sec, sans éclats lyriques (on pense à un conte moral du XVIIIème) sur les pratiques de la Mafia qui transbahute un contremaitre sicilien travaillant dans le Nord, lors de ses vacances en Sicile, en Amérique pour commettre un crime dont on ne peut le soupçonner. Une des plus grands rôles de Sordi que Tamasa eut la bonne idée de sortir. Ils ajoutent maintenant VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ… CHEZ NOUS ! Comme l’écrit Philippe Paul sur DVDClassik : « Pour ce film, Lattuada s’inspire d’un roman de Piero Chiara, La Spartizione – Le Trigame en version française – dont il transporte le récit des années 30 aux années 70. VENEZ DONC PRENDRE LE CAFÉ… CHEZ NOUS ! suit le destin d’un petit fonctionnaire un peu falot, Emerenziano Paronzini, qui, encouragé par les valeurs patriarcales de l’Italie de l’époque et par son statut de petit bourgeois, va entreprendre de séduire une des sœurs Tettamanzi, trois vieilles filles enfermées dans leurs frustrations par les barrières morales imposées par la religion et la société. Son plan va fonctionner au-delà de ses espérances puisque les trois femmes deviendront ses amantes, satisfaisant plus que largement à ses besoins qu’il définissait en début de film, les « trois C : caresses, chaleur, commodité. » Crédité à Adriano Baracco, Tullio Kezich ainsi qu’à Alberto Lattuada et au romancier Pietro Chiara lui-même, le scénario se focalise sur l’argument principal du récit, en se détachant presque totalement de toute autre considération sociale ou politique, produisant ainsi un film déconnecté de la réalité italienne de l’époque, hormis évidemment pour la question morale de la sexualité et de la polygamie inhérente au sujet. » La sexualité a toujours été l’un des grands sujets abordés par Lattuada jusque dans son sketch amusant mais un peu facile d’AMORE IN CITA, des ITALIENS SE RETOURNENT en passant par LA NOVICE que j’aimerais revoir. L’autre versant de l’oeuvre de Lattuada est imprégnée de l’influence, de l’admiration pour la littérature russe : LA STEPPE, CŒUR DE CHIEN, LA FILLE DU CAPITAINE.
LES ADOLESCENTES reste un chef d’œuvre de sensibilité, d’intelligence. Point de romantisme ni d’effusion mais un ton précis à fleur de peau que l’on dirait sorti d’une nouvelle du XVIIIème pour évoquer la journée où la délicieuse Catherine Spaak va perdre sa virginité. Belle musique de Piero Piccioni. Je n’ai jamais oublié les sifflements qu’on entend quand la voiture de Christian Marquand longe les barrières, les poteaux jalonnant l’autoroute.
CARLO LIZZANI
 Je viens de découvrir un film qui m’a enchanté, ému et qui devrait vous passionner. Il s’agit de CELLULOID, traduit en français par « REMAKE » ROME VILLE OUVERTE, titre idiot. Il s’agit d’un film de fiction sur les aléas insensés du tournage de ROME VILLE OUVERTE avec les rapports passionnés et orageux entre Rossellini et son volcanique scénariste Sergio Amidei qui fulmine et claque la porte à la moindre apparence de concession. Je ne savais pas que le film après avoir subi l’arrogance des producteurs, des distributeurs, avait été si honteusement traité par la critique lors de sa sortie en Italie et qu’il avait été sauvé par la sortie à New York et à Paris. C’est un film de Carlo Lizzani que j’ai voulu voir après avoir découvert ACHTUNG BANDITI, l’un de ses premiers, peut-être le meilleur film de partisans, une chronique sans héros, sans personnage principal (l’équivalent français serait le méconnu JERICHO de Henri Calf) avec des plans généraux d’une beauté à couper la souffle. On voit des foules manifester dans la plaine, affronter la police et c’est filmé avec une ampleur incroyable. Le propos complexe montre divers types de collaboration et de résistance avec des personnages troubles pris entre les maquisards et les allemands Deux films à découvrir et à faire connaitre aux étudiants de cinéma.
Je viens de découvrir un film qui m’a enchanté, ému et qui devrait vous passionner. Il s’agit de CELLULOID, traduit en français par « REMAKE » ROME VILLE OUVERTE, titre idiot. Il s’agit d’un film de fiction sur les aléas insensés du tournage de ROME VILLE OUVERTE avec les rapports passionnés et orageux entre Rossellini et son volcanique scénariste Sergio Amidei qui fulmine et claque la porte à la moindre apparence de concession. Je ne savais pas que le film après avoir subi l’arrogance des producteurs, des distributeurs, avait été si honteusement traité par la critique lors de sa sortie en Italie et qu’il avait été sauvé par la sortie à New York et à Paris. C’est un film de Carlo Lizzani que j’ai voulu voir après avoir découvert ACHTUNG BANDITI, l’un de ses premiers, peut-être le meilleur film de partisans, une chronique sans héros, sans personnage principal (l’équivalent français serait le méconnu JERICHO de Henri Calf) avec des plans généraux d’une beauté à couper la souffle. On voit des foules manifester dans la plaine, affronter la police et c’est filmé avec une ampleur incroyable. Le propos complexe montre divers types de collaboration et de résistance avec des personnages troubles pris entre les maquisards et les allemands Deux films à découvrir et à faire connaitre aux étudiants de cinéma.
LA CHRONIQUE DES PAUVRES AMANTS est une émouvante chronique unanimiste sur la manière dont un quartier de Florence bascule peu à peu dans le fascisme.
FILMS ANGLAIS
 LA MER CRUELLE me plait toujours autant à chaque vision. Il s’agit à coup sûr du chef d’œuvre de Charles Fren, réalisateur attentif, consciencieux, humaniste. Là, il se montre inspiré par le beau scénario d’Eric Ambler (LA FLAMME POURPRE) d’après le roman très autobiographique de Nicholas Monsarrat.
LA MER CRUELLE me plait toujours autant à chaque vision. Il s’agit à coup sûr du chef d’œuvre de Charles Fren, réalisateur attentif, consciencieux, humaniste. Là, il se montre inspiré par le beau scénario d’Eric Ambler (LA FLAMME POURPRE) d’après le roman très autobiographique de Nicholas Monsarrat.
PINK STRING AND SEALING WAX : splendide étude criminelle de Robert Hamer, un des films les plus radicaux et violents jamais tournés à cette époque en Angleterre. Sur les rapports parents-enfants, maris et femmes. Sur l’absence de droits des femmes, les violences conjugales, Goggie Withers, l’actrice fétiche du réalisateur qui la dirigea dans le remarquable IL PLEUT TOUJOURS LE DIMANCHE, est extraordinaire notamment quand Hamer la filme dans un très long gros plan. Seul léger bémol : le studio imposé par Balcon qui dénature parfois le son (Dvd Optimum). Il faut le sortir ainsi que THE SPIDER AND THE FLY et THE LONG MEMORY.
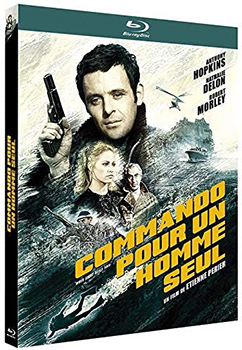 Revu avec plaisir COMMANDO POUR UN HOMME SEUL d’Etienne Périer (Rimini), transcription française idiote de WHEN 8 BELLS TOLL : un commando composé d’un seul homme ou qui ne doit s’occuper que d’un seul homme ne paraît guère prometteur en termes d’action. De plus, les trois-quarts de ses films français m’ont paru ternes, alourdis par des scénarios de whodunit ineptes : on peut éviter MEURTRE EN 45 TOURS, en dépit de Darrieux, et UN MEURTRE EST UN MEURTRE. Dans mon souvenir, je sauverai UN JOLI PETIT VILLAGE où Carmet était excellent. Ce COMMANDO écrit par Alistair McLean (LES CANONS DE NAVARONE, QUAND LES AIGLES ATTAQUENT, ICE STATION ZEBRA, BREAKHEART PASS qui devint l’intéressant et violent LE SOLITAIRE DE FORT HUMBOLDT de Tom Gries avec Bronson) d’après son roman est donc une plaisante surprise, bénéficiant de beaux extérieurs écossais, de la présence d’Anthony Hopkins que j’ai rarement vu aussi jeune. Il dégage un charme fou et trouve en Robert Morley, chef de l’espionnage obsédé par la bouffe. un partenaire de choix. Selon Jean Claude Missiaen, LE MERCENAIRE et LE PONT VERS LE SOLEIL sont deux réussites parmi lesquelles on ne peut pas compter ZEPPELIN. Etienne Perier qui fut le conseiller technique de Cocteau (!!!) pour LE TESTAMENT D’ORPHÉE, était un des fondateurs de Plan film qui a produit et/ou distribué ses films mais aussi L’INVITATION de Claude Goretta (à revoir absolument), ATLANTIC CITY de Louis Malle, COUP DE TORCHON, distribué LA MORT EN DIRECT et DADDY NOSTALGIE.
Revu avec plaisir COMMANDO POUR UN HOMME SEUL d’Etienne Périer (Rimini), transcription française idiote de WHEN 8 BELLS TOLL : un commando composé d’un seul homme ou qui ne doit s’occuper que d’un seul homme ne paraît guère prometteur en termes d’action. De plus, les trois-quarts de ses films français m’ont paru ternes, alourdis par des scénarios de whodunit ineptes : on peut éviter MEURTRE EN 45 TOURS, en dépit de Darrieux, et UN MEURTRE EST UN MEURTRE. Dans mon souvenir, je sauverai UN JOLI PETIT VILLAGE où Carmet était excellent. Ce COMMANDO écrit par Alistair McLean (LES CANONS DE NAVARONE, QUAND LES AIGLES ATTAQUENT, ICE STATION ZEBRA, BREAKHEART PASS qui devint l’intéressant et violent LE SOLITAIRE DE FORT HUMBOLDT de Tom Gries avec Bronson) d’après son roman est donc une plaisante surprise, bénéficiant de beaux extérieurs écossais, de la présence d’Anthony Hopkins que j’ai rarement vu aussi jeune. Il dégage un charme fou et trouve en Robert Morley, chef de l’espionnage obsédé par la bouffe. un partenaire de choix. Selon Jean Claude Missiaen, LE MERCENAIRE et LE PONT VERS LE SOLEIL sont deux réussites parmi lesquelles on ne peut pas compter ZEPPELIN. Etienne Perier qui fut le conseiller technique de Cocteau (!!!) pour LE TESTAMENT D’ORPHÉE, était un des fondateurs de Plan film qui a produit et/ou distribué ses films mais aussi L’INVITATION de Claude Goretta (à revoir absolument), ATLANTIC CITY de Louis Malle, COUP DE TORCHON, distribué LA MORT EN DIRECT et DADDY NOSTALGIE.